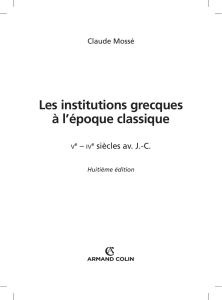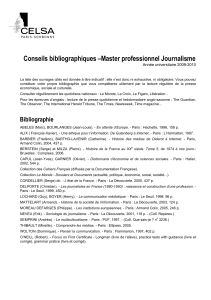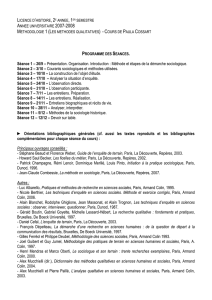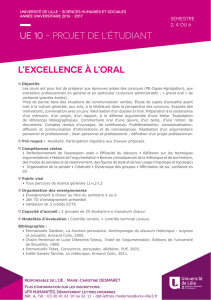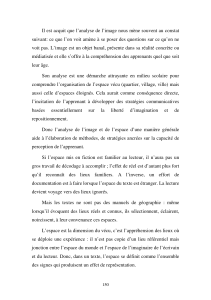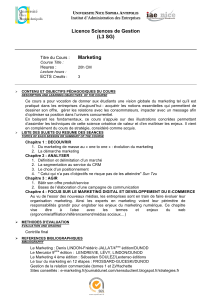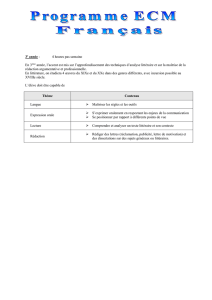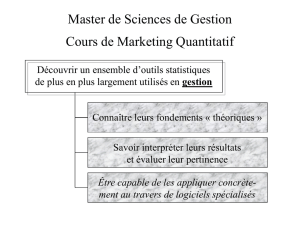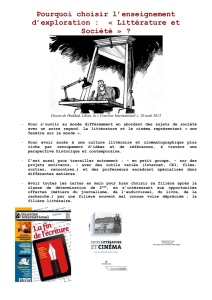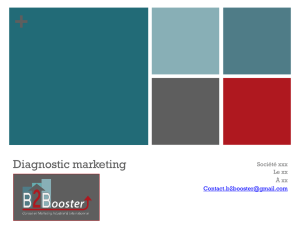Formalisme et lecteurs réels dans l'enseignement de la littérature
Telechargé par
ram011said

SORTIR DU FORMALISME, ACCUEILLIR LES LECTEURS RÉELS
Gérard Langlade
Armand Colin / Dunod | Le français aujourd'hui
2004/2 - n° 145
pages 85 à 96
ISSN 0184-7732
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2004-2-page-85.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Langlade Gérard,« Sortir du formalisme, accueillir les lecteurs réels »,
Le français aujourd'hui, 2004/2 n° 145, p. 85-96. DOI : 10.3917/lfa.145.0085
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Armand Colin / Dunod.
© Armand Colin / Dunod. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod

SORTIR DU FORMALISME,
ACCUEILLIR LES LECTEURS RÉELS
Par Gérard UNGI.ADE
Le constat s'impose avec une douloureuse évidence : l'enseignement
actuel de la littérature dans le second degré est victime de formalisme et
de technicisme'. Linfluence de la linguistique textuelle et des courants
structuralistes qui se sont développés en France voici une quarantaine
d'années n'est certainement pas étrangère à cette situation. Cependant,
I'approche formaliste perdure alors que ses fondements scientifiques
sont aujourd'hui largement contestés - notamment Par une linguis-
tique désormais attentive à la parole et aux discours, et qui accorde une
importance décisive à I'analyse des actes de langage et des situations
concrètes de communication. Les causes des dérives technicistes doivent
donc être recherchées ailleurs que dans la simple survivance d'un héri-
tage scientifique obsolète.
Plusieurs traia majeurs de l'enseignement de la limérature méritent d'être
interrogés: la permanence du modèle dit n lansonien, qui recommande
une analyse objective des textes linéraires à fabri de I'implication des lec-
teurs réels, les représentations de la litérature qui l'appréhendent comme
un monument langagier clos sur lui-même, la reconfiguration actuelle de la
discipline autour de la notion de discours qui, mdgré ses intérêts, produit
une dilution préjudiciable de la singularité du rapport ar.rx textes littéraires,
la primauté accordée à la distance andytique qui génère une approche rhé-
torique et au bout du compte formelle de la lecrure.
En contrepoint de I'analyse critique de ces divers éléments, il convient
de montrer tout I'intérêt didactique, dans la persPective d'un renouvelle-
ment des pratiques scolaires de la littérature, de la prise en compte du dis-
cours singulier que chaque lecteur, élève ou enseignant, élabore lorsquil
s'implique en tant que sujet dans la lecture d'une æuvre.
l.Par formalisrne j'entends une attention quasi exclusive portée à la dimension formelle
d'une ceuvre, hors de toute véritable perspective interpréative. On aura compris que je ne
vise pas ici directement le formalisme en tant que méthode d'analyse mais bien plutôt ce
qu'il-advient de cette méthode lorsqu'elle est immergée dans I'enseignement secondaire.
Pat technicisme j'entends I'utilisation d'instrumens d'analyse linguistique, sémiotique,
narratologique, etc., pour erx-mêmes, coûtme une ûn en soi.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod

86 Le Français aujourd'hui no 145, n Le littéraire et le sociai r
Aux origines du formalisme: la littérature
en taût qrt'objet de description
Pour manifestes et actives qu elles soient actuellement, les approches sco-
laires de la littérature qui reposent sur une observation qui se veut minu-
tieuse, objective, voire savante, des rextes, ne datent pas d'aujourd'hui.
Antoine Compagnon, enrre aurres, a mis en évidence le rôle joué par le
courant positiviste à la fin du xlx', avec norarnment la critique scienti-
fique de F. de Brunetière et la critique historique de G. Lansôn, dans la
mise hors jeu du lecteur dans les études littéraires. < Pour Brunetière et
Lanson, chacun à sa manière, il s'agit d'échapper au lecteur et à ses
caprices, non pas d'annuler, mais d'encadrer ses impressions par la disci-
pline, d'atteindre I'objectivité par Ie traitement de l'æuvre elle-même ,
(4. Compagnon, 1998). On sait que G. Lanson entend faire émerger
un jugement objectif - ( une connaissance impersonnelle vérifiée,
(G. l,anson, 1965), selon ses termes - et doter les élèves de rigueur analy-
tique en renouvelant l'explication de rexte et l'histoire littéraire.
ks divers courants formalistes et strucruralistes des années 1960 se
réfèrent à des modèles d'analyse et à des théories de la littérature rrès
différents de ceux qu'a installés la tradition lansonienne. Cependant, au
bout du compte, par un apparent paradoxe, ils vont alimentei un rapporr
semblable arlx textes littéraires.
On se souvient de la contestation de I'histoire linéraire traditionnelle
- I'homme et l'æuvre - au profit d'une histoire des formes et des genres,
conduite par R. Barthes et G. Genette. La critique de R. Barthes vise à la
fois le principe d'organisation des études littéraires et le mode d'accès aux
æuvres : u c'est une suite de monographies, dont chacune, à peu de
choses près, enclôt un auteur et l'étudie pour lui-même ; l'histoire riest ici
que succession d'hommes seuls, (R. Barthes, 1963). G. Genette monrre
tout I'intérêt d'une hisroire des formes liréraires : il convient de s'intéres-
ser à u une histoire de la littérature prise en elle-même (et non dans ses
circonstances extérieures) et pour elle-même (et non comme document
historique) considérée non plus comme documenr, mais comme monu-
ment ). Il émet une hypothèse qui va profondémenr marquer l'évolution
de I'enseignement de la littérature jusqdà aujourd'hui: u il me semble
qu en littérature, I'objet historique, iest-à-dire à la fois durable et
variable, ce n'est pas l'æuvre : ce sont ces éléments transcendants aux
æuvres et constitutifs du jeu littéraire que I'on appellera pour aller vite les
formes : par exemple, les codes rhétoriques, les techniques narratives, les
structures poétiques, etc. o (G. Generre, 1972).
De nombreuses préfaces de manuels montrent I'incidence de cette orien-
tation dans les anthologies littéraires, des années 1970 à nos jours. Ainsi,
par exemple, H. Mittérand refonde I'histoire littéraire sur ( une histoire des
formes littéraires, retrouvant pour la régénérer, la grande tradition de la rhé-
toriqud o. Il propose qu u à la présentation chronologique, siècle par siècle,
des grands auteurs, selon le schéma "l'homme et l'æuvre", lon]-substitue
2. Exuait de l'< Avant-Propos > des Tèxta fançais a histoires littéraires, Éditions Fernand
Nathan, nouvelle édition augmentée, p. 5.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod

Sortir du formalisme. accueillir les lecteurs réels
une disribution des textes fondée sur la distinction des genres : le théâtre,
la poésie, le roman, le conte, I'essai3 ,. On le voit : le cadre didactique dans
lequel s'inscrivent les programmes et les pratiques acnrels est, dès cette
époque, clairement mis en place.
Dans le même temps, loin de prendre en compte les constructions
interprétatives de lecteurs empiriques, la u science de la littérature , s'inté-
resse aux o règles et contraintes d'élaboration , des significations : u On
s'efforcera d'établir l'acceptabilité des æuvres, non leur sens , (R Barthes,
1966). Ce formalisme renvoie à la fois à une théorie de la littérature et à
une méthode d'analyse des æuvres. u Ce qui nous caractérise [...], c'est
le désir de créer une science littéraire autonome à partir des qualités
intrinsèques des matériaux littéraires , (B.Eikhenbaum, 1965). En
conséquence, les textes sont volontiers abordés en eux-mêmes et pour
etx-mêmes, et I'on privilégie pour leur étude des problématiques stricte-
ment texnralistes: étude des formes, des types de texte, des modes de
fonctionnement narratif, etc. Dans les manuels les plus novateurs de cette
époque, on retrouve cette même ambition de I'analyse du u fonctionne-
ment ) textuel. u Nous laisserons de côté l'étude psychologique des pas-
sions et des modvations, pour nous intéresser à des questions différentes :
non plus : "pourquoi Rodrigue a-t-il tué le Comte ?", mais : "quels rôles
Rodrigue joue-t-il ? quels sont les programmes actantiels dans lesquels il
joue un rôle ?" D, annonce par exemple A.-M. Mediavilla dans son
manuel pour la classe de secondea.
Le formalisme est clairement revendiqué comme méthode de lecture
dans les programmes de la fin des années 1980 qui créent la notion de
n lecture méthodique o. Rappelons que cette dernière se fonde sur u l'ob-
servation objective, précise, nuancée des formes ou des systèmes de
formes (grammaire, morphologie et syntaxe; lexique, champ lexical,
champ sémantique ; énoncé et énonciation; image, métaphore et méto-
nymie; modalités d'expression, effets stylistiques : stuctures apparentes
et structures profondes) > et sur o I'analyse de l'organisation de ces formes
et la perception de leur dynamisme au sein du texte (convergence et
divergence)5 o. Lanalyse de nombreux manuels, I'observation de certaines
pratiques, dites aujourd'hui de u lecture analytique ,, permettent de
mesurer, sur le terrain, les effets de grilles de lecture formelies constituées
à partir d'un tel bric-à-brac de notions venues d'horizons divers. < Thès
souvent, souligne, par exemple, R. Michel, la oconstruction" du sens par
les élèves relève de I'insensé: la compréhension du texte se dilue et se
réduit à une collection de faits, linguistiques, stylistiques ou narratolo-
giques, épars et parcellaires, selon des protocoles de "recherche" automa-
tisés, répétitifs et peu créatifs o (R. Michel, 1998).
En fait, I'utilisation des savoirs issus de la linguistique et de la narratolo-
gie ne change rien aux exercices anciens auxquels ils fournissent simplement
3. On retrouve dans un manuel en deux parties : n [æs thèmes r, o Les genres, (Bordas,
L977), drrgé par Pierre Brunel, ce même positionnement théorique et didactique dans
I'approche des textes littéraires.
4. Méthodts a Pratiques, p. 227.
5. Programmes da lyde, 1989, p. 17-18.
B7
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod

88 Le Français aujourd'hui n" 145, < Le littéraire et le social n
quelques contenus nouveaux. La boutade d'A. Compagnon - ( un candi
dat de concours qui ne saurait pas dire si le bout de texte qu il a sous les
yeux est "homo-" ou "hétérodiégétique", "singulatif" ou "itératif", à
"focdisation interne" ou "externe", ne sera pas reçu, comme jadis il fallait
reconnaitre une anacoluthe d'une hypallage, et savoir la date de naissance
de Montesquieu. n (A. Compagnon, 1998) - fait mouche. À condition
toutefois de ne pas interpréter ces propos comme la manifestation d'un
scepticisme désabusé à l'égard de toute ambition théorique, mais comme
la stigmatisation d'un formalisme toujours aussi vain dans le rapport aux
æuvres. Il s'agit moins ici des démons de la théorie que de ceux de la
didactique.
La littérature définie comrne autoréférencée
TLès largement, programmes, manuels et pratiques d'enseignement se
réêrent à une conception de la littérature qui voit celle-ci se prendre elle-
même comme objet et comme sujet. Dès l'école primaire, cette radicale
intransitivité attribuée aux æurrres littéraires, ceme conception d'une limé-
rature autoréférencée et presque exclusivement alimentée par son retour-
nement réflexif, se retrouvent noramment dans l'utilisation à la fois
réductrice et systématique de la nodon d'intertextualité6. Prise dans son
sens le plus général de liaison de tout texte avec un aurre, cette notion
conduit à considérer toute æuvre littéraire comme se référant à d'aurres
æuvres, la connaissance de celles-ci étant indispensable pour lire celleJà.
De façon fort significative, les Docurnents d application des programmes
litthature du rycle 3 s'ouvrent sur une définition de la culture littéraire qui
fait la part belle aux références intertextuelles :
o Une culture littéraire [...] suppose une mémoire des texres, mais aussi
de leur langue, une capacité à retrouver, chaque fois quon lit, les réso-
nances qui relient les æuvres entre elles. Elle est un réseau de référence
autour desquelles s'agrègent les nouvelles lectures. Bre[, quil s'agisse de
comprendre, d'expliquer ou d'interpréter, le véritable lecteur vient sans
cesse puiser dans les matériaux riches et variés quil a structur& dans sa
mémoire, et qui sont, à proprement parler, sa culture. u (Desco, MEN,
CNDB 2002, p.5)
Une telle approche, dès le primaire, de la lecture liréraire est pofteuse
d'une conception on ne peut plus claire de la littérature dans I'espace sco-
laire: la littérature parle en priorité de la linérature et lire une æuvre
consiste à percevoir un réseau de références intertextuelles. Lintérêt d'un
texte ne peut donc apparaitre que dans la référence de celui-ci à d'autres
textes. lJne telle approche laisse quelque peu songeur si on se souvient que
ces programmes s'adressent à de très jeunes lecteurs dont la caractéristique
première est précisément de riavoir pas lu grand chose, voire rien du tout.
Ceftes, css Docurnmts d'application, loin de s'en tenir au cadre étroit dCI
relations interto<tuelles comme seul espace d'appropriation des æuvres, font
6. Il ne s'agit pas, bien entendu, de contester I'intérêt pour l'érude des æuvres et de la
linérature de cette notion fondamentale, mù de s'interroger sur la pertinence de son uti-
lisation précoce en didactique de la littérature.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 105.128.203.241 - 24/04/2015 17h25. © Armand Colin / Dunod
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%