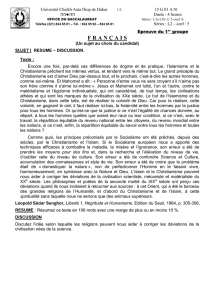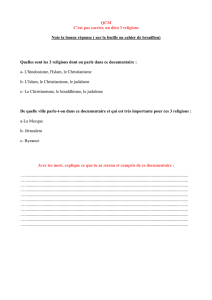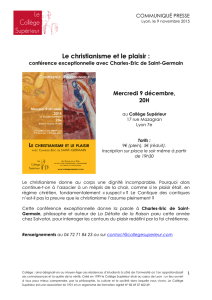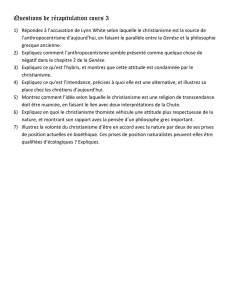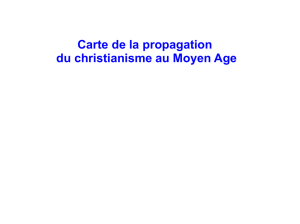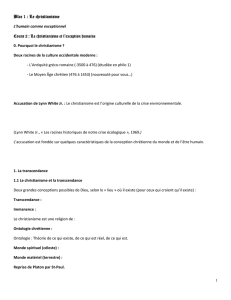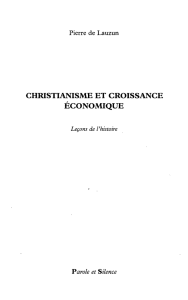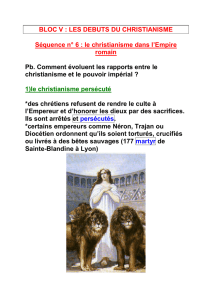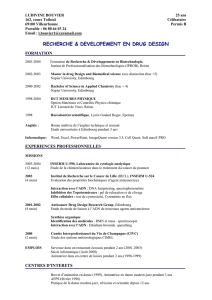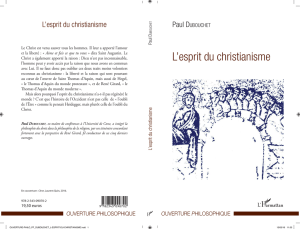L’ABSENCE VIRTUELLE DE L’AFRIQUE A EDINBURGH
Lors de la tristement célèbre Conférence de Berlin, (1884-1885), les « maîtres » du monde de
l’époque décidèrent du destin de l’Afrique sans la consulter, sans que celle-ci ne soit présente.
Ce qui s’est passé à Berlin sur le plan politico-économique semble s’être répété sur le plan
religieux et missionnaire vingt-cinq ans plus tard lors de la Conférence missionnaire
d’Edimbourg en 1910 ! Edimbourg confirme la main mise des occidentaux sur le reste du
monde et témoigne des liens existant entre les missions protestantes et la volonté de
domination occidentale. Comme le souligne l’historien Brian Stanley, « l’image d’une
harmonie grandissante entre les missions et les gouvernements n’était pas en fait dénuée de
fondement […] les missions n’étaient plus désormais perçues comme une menace mais bien
comme faisant partie intégrante d’un vaste programme civilisateur pour l’Afrique ».
Certes, la Conférence s’est intéressée aux rapports entre sociétés missionnaires et
gouvernements, mais elle ne s’est pas du tout préoccupés du déséquilibre des forces entre
monde occidental et monde non occidental. Les organisateurs étaient pourtant conscients du
privilège que leur conférait leur pouvoir financier ! Mais leur objectif était de se servir de
celui-ci pour réaliser l’évangélisation du monde.
La Conférence d’Edinburgh se prétendait « mondiale ». Mais, elle n’était représentative ni sur
le plan œcuménique, ni sur le plan géographique de l’état de la chrétienté en 1910. Sur les
1215 délégués, seuls dix-neuf venaient du monde non occidental. Parmi eux, un seul venait
d’Afrique : Mark C. Hayford du Ghana, pasteur et docteur en théologie, qui enseignait en
Europe et aux Etats-Unis tout en collectant des fonds pour la construction de l’Eglise dans son
pays. Probablement invité tardivement, son nom n’apparaît pas sur les listes initiales des
délégués. D’ailleurs, les historiens ont longtemps affirmé qu’aucun délégué né en Afrique
n’était présent à Edimbourg. Selon B. Stanley, la voix du christianisme africain n’a pas été
entendue à Edimbourg : « Même lorsqu’ils étaient chrétiens, les habitants de l’Afrique étaient
considérés, comme des primitifs, encore dans l’enfance ; situés tout en bas de l’échelle de
l’évolution humaine, ils semblaient de peu d’importance pour le développement futur de
l’Eglise à travers le monde ».
Pourtant, l’Afrique comptait en 1910 des responsables chrétiens (dont des femmes sans doute)
suffisamment éduqués pour représenter dignement leur continent, et pour s’exprimer au nom
d’un christianisme africain dont Samuel A. Crowther, premier évêque anglican africain
(1807-1891), avait été l’initiateur et le promoteur le plus célèbre. (voir encadré)
Mais en quoi ce christianisme africain se distinguait-il de celui de l’Occident ?
L’accent sur l’éducation : la première stratégie d’évangélisation de S. A. Crowther était
l’éducation des enfants. Grâce à celle-ci, c’est toute l’Afrique qu’il espérait évangéliser, tout
en combattant superstition et idolâtrie.
La création d’une élite africaine : Crowther a eu le mérite d’associer très tôt les Africains à
l’œuvre d’évangélisation de leur continent. Ces derniers étaient également responsables (avec
des fortunes diverses) de l’administration des communautés créées. Cette nouvelle élite
africaine serait appelée à prendre le relais des missionnaires blancs.
La promotion de la culture locale : Crowther s’est attelé à la traduction de la Bible en
langues locales afin de rapprocher la Parole de Dieu des peuples évangélisés. Il a ainsi
contribué à la promotion de la culture locale mais également d’un christianisme «inculturé»,
fortement enraciné cette culture, tout en restant critique à l’égard celle-ci, et s’opposant à
certaines pratiques comme la polygamie.
L’autonomie financière : Crowther a encouragé le développement du commerce afin de
permettre le développement économique de la région, mais aussi et surtout l’indépendance

financière des ouvriers de la mission et des communautés religieuses. C’était là un principe
cher à Henry Venn, secrétaire général de la CMS. Bien que très critiqué sur ce point,
Crowther obtint pourtant des résultats probants.
Le dialogue interreligieux : Crowther a fait la promotion d’un christianisme prêchant la
coexistence pacifique et respectueuse des différentes religions. Avec l’historien écossais
Andrew Walls, on peut dire que Crowther a développé une approche originale du « dialogue
interreligieux » entre l’islam et le christianisme, deux religions « condamnées » à coexister
sur le continent.
C’est ce christianisme naissant, mais néanmoins dynamique et original, que les organisateurs
de la Conférence d’Edimbourg ont ignoré. S’attachant à l’image d’une Afrique continent «
vierge » à christianiser, voire conquérir, ils se privaient d’une chance unique : faire
connaissance du christianisme africain ! Leur refus de reconnaître la valeur du pastorat
africain, symbolisé par le rejet de Crowther et de son œuvre, est à l’origine d’un changement
radical dans le développement des Eglises en Afrique. Ces événements ont en effet donné
naissance aux « Eglises indépendantes africaines », lesquelles rejetant la tutelle, voire la
collaboration avec les missionnaires blancs, ont favorisé une radicalisation de
l’ « éthiopianisme », mouvement en faveur d’un christianisme africain.
Ainsi donc l’Afrique n’a pas été absente d’Edimbourg parce que « primitive »,
insuffisamment chrétienne etc... mais parce que certaines âmes (sûrement bien intentionnées),
en ont décidé ainsi. Une fois de plus, d’autres ont décidé pour l’Afrique. L’Afrique est-elle
condamnée à subir les décisions de l’occident ? Samuel Désiré JOHNSON
Figures du christianisme africain à l’heure d’Edimbourg
Dandeson Crowther (1844-1938) : à la suite de son père, S. A. Crowther, de la Church
Missionary Society (CMS), D. Crowther entreprit une œuvre missionnaire autonome dans le
Delta du Niger (Afrique de l’Ouest) qui donna naissance à une Eglise séparée de la mission.
Cette œuvre se propagea rapidement sous sa direction.
John Jabavu Tengo (1859-1921) : enseignant, journaliste, éditeur et prédicateur de
l’Evangile, originaire d’Afrique du Sud. Il fit partie de la délégation qui se rendit à Londres en
1909 afin de protester contre le « South African Act », un projet du Parlement britannique
visant à créer une union de ses colonies en Afrique du Sud. Il fut plus tard choisi pour
participer au Congrès universel des Races à Londres en 1911.
James E. K. Aggrey (1875-1927) : enseignant et pasteur, docteur en théologie, connu comme
un partisan d’une coopération entre Noirs et Blancs. Né et éduqué au Ghana, il poursuivit des
études aux Etats-Unis où il s’installa. Revenu dans son pays natal, il y fonda le célèbre
Achimota College. Grand défenseur de l’éducation des filles - « à travers une jeune fille que
l’on formait, c’est toute une famille que l’on éduque »-, on le désigne comme le «père de
l’éducation africaine ».
STANLEY, B.: The World Missionary Conference, Edinburgh 1910 Studies in the History of Christian
Missions, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, UK, 2009, p.265.

STANLEY, B.: Op.cit, pp.12-13 & 91-131.
HALIBURTON, G.M.: A non-success Story, in: Journal of Religion in Africa, Leiden, 1981, vol. 12, Nr.1,
pp.20-37.
WALLS, A.: Crowther, Samuel Ajayi, 1807-1891, Anglican Nigeria, in: Dictionary of African Christian
Biography.
WEBSTER, J. B.: The African churches among the Yoruba, Oxford Clarendon Press, 1964.
TASIE: Christian Missionary Enterprise in the Niger Delta : 1864-1918; HANCILES, J. J.: Dandeson Coates
Crowther and the Niger Delta Pastorate… in: International Bulletin of Missionary Research 18, Nr. 4, 1994.
OOSTHUIZEN, G. C., Jabavu John Tengo 1859-1921, in: Biographical Dictionary of Christian Missions, G.
A. Anderson, W. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids 1998.
1
/
3
100%