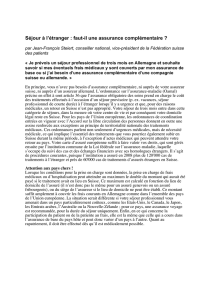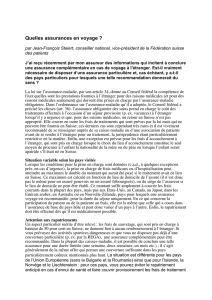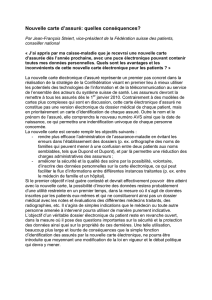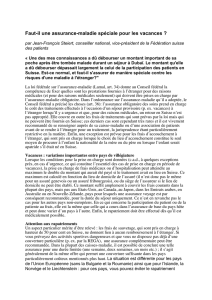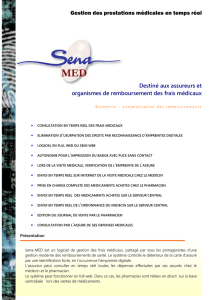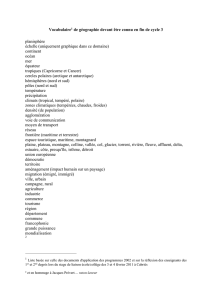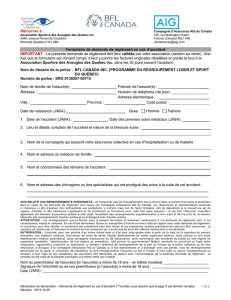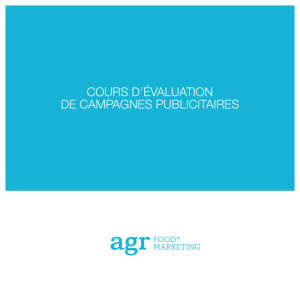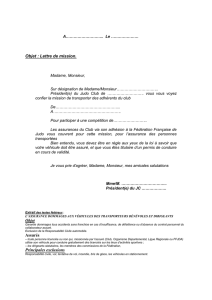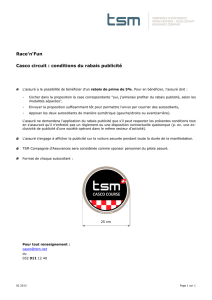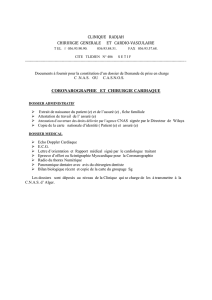COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME
PROFESSEUR BOLO IRIE
1
CHAPITRE I : LES ASSURANCES : GENERALITES
I- HISTORIQUES ET OBJET
Si l’on remonte dans le temps, c’est l’ordonnance de la mairie en 1681 sous Louis XIV en
France, qui vient cerner la notion d’assurance et donc celle de la couverture des risques en
transport maritime. Cette ordonnance connue sous le nom de son principal rédacteur
(Colbert) vient poser les jalons de ce qui est devenu par la suite l’assurance transport.
L’ordonnance de Colbert aura par la suite un écho retentissant dans les autres pays à tradition
maritime à l’époque : hollande, grande Bretagne, Belgique, Norvège. Beaucoup plus tard,
soit en 1806, une autre notion assez proche de l’assurance voyait le jour sous le nom de
« prêt à la grosse » ou encore « nauticum foenus ». Ce prêt à la grosse serait d’après certains
doctrinaires l’ancêtre de l’assurance maritime. Il s’agissait d’un contrat aléatoire au terme
duquel un capitaliste mettait de l’argent dans une expédition maritime avec l’espoir, en cas
de succès de l’expédition, d’être remboursé de son avoir initial et des intérêts. Il faut
véritablement attendre la mise en œuvre du code de commerce de 1808 pour qu’en France
l’assurance maritime, soit régie par un texte de loi. Le transport, bien intermédiaire
intervient dans tous les domaines de l’économie. D’une façon générale qu’il s’agisse des
sociétés ou des services, tous intègrent dans leurs composantes le transport qui est alors
considéré comme facteur de production. Au sein de l’entreprise, le transport est un vecteur
essentiel, primordial. A cet effet, les paramètres du transport sont déterminants à un triple
niveau :
*Au niveau commercial, le transport influe sur le prix de vente à destination. Il détermine
légalement les délais de livraison et soigne l’image de marque de l’entreprise.
*Au niveau technique, les choix opérés en matière de transport de transport peuvent avoir des
implications sur purement technique.
*Au niveau administratif, et mode et les modalités de transport peuvent avoir des
implications sur le régime douanier ainsi que sur les modes de paiement. En conséquence, le
choix en matière de transport conditionne les performances de l’entreprise sur le marché. Or
quelque soit le mode de transport déterminé, la marchandise est soumise, pendant l’acte de
transport, à de très nombreux risques (vol, perte, manquant avarie due à la rouille ou à
l’humidité, chate,…) plus ou moins importants. En fait les risques courus par les
marchandises bien qu’ils soient le fait même du transport, ne sont pas inéluctable ils peuvent
être sinon supprimés du moins, peut on prendre les mesures visant à les maîtriser en réalisant
leur couverture:
*en adaptant les emballages (des produits des marchandises) aux conditions du transport
*en souscrivant une assurance transport. C’est l’objet de notre étude.
II- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ASSURANCE
1- Définition
On définit donc l’assurance comme une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait
promettre moyennant une rémunération la prime, une prestation par une autre partie
l’assureur en cas de réalisation d’un risque. Cette définition présente l’inconvénient en
n’envisageant que le contrat de négliger l’aspect technique de l’opération à savoir la
mutualité qui est nécessairement à la base de toute entreprise d’assurance. En effet, il ne peut

COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME
PROFESSEUR BOLO IRIE
2
y avoir d’assurance à l’état isolé limité à un seul risque dans les rapports d’un seul assuré et
d’un assureur. Ce serait de la part de ce dernier une opération de spéculation lors de jeu.
L’assurance suppose par essence une réunion de personnes qui, pour faire à un même risque
susceptibles de les atteindre décident de contribuer toutes au règlement des sinistres au profit
des membres atteints par le sort. On peut ainsi définir l’assurance comme : « une opération
par laquelle une partie l’assuré, sa fait promettre moyennant une rémunération, la prime, pour
lui ou pour un tiers en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie,
l’assureur qui prenant en charge un ensemble de risque les compense conformément aux lois
de la statistique ». Cette dernière définition, en mettant l’accent sur le caractère scientifique
et organisé de l’entreprise d’assurance du mérite de s’appliquer à toutes les variétés
d’assurance et de mettre en valeur les 3 éléments essentiels de l’assurances à savoir : la prime
et la prestation.
2- Les composantes de l’assurance
a- Le risque
Il est l’élément fondamental de l’assurance. Il se définit comme un événement incertain et
qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, spécialement de celle de l’assuré.
- Evénement incertain
Le risque implique l’idée d’éventualité : l’assurance porte sur des faits indéterminés qui
comportent un certain incertain. Elle repose sur l’aléa.
L’incertitude peut être de deux sortes :
Celle qui porte sur la réalisation même de l’événement en usage
Celle qui porte sur le moment de réalisation d’un événement qui se produira
nécessairement. Ainsi au sens de l’assurance, il y a risque quand on ne sait pas si
cet événement se réalisera ou quand il se réalisera
- Evénement ne dépendant pas de la volonté exclusive des parties
L’événement incertain ne peut faire l’objet d’une assurance que dans la mesure où se
réalisation suppose l’intervention au moins partielle du hasard : s’il dépend de la volonté
exclusive d’une des parties de celle de l’assuré, l’aléa est supprimé, le risque n’existe plus.
Par contre sont considéré incontestablement comme des risques les événements qui se
réalisent sans aucune participation de l’homme ou plus exactement de l’assuré. Cependant on
note que certain événements bien que réunissant la double condition d’être incertain et de ne
pas dépendre de la volonté exclusive d’une des parties ne sont pas assurables. Enfin
signalons les cas de risque qui ont été signalés par la jurisprudence, inassurables en raison du
caractère immoral, illicite de l’opération (assurance des opérations de contrebande,
prostitution, assurance contre les risques de loterie).
b- La prime
Elle constitue le prix de l’assurance ; c’est la rémunération que l’assuré doit à l’assureur en
contre partie du risque pris en charge. Elle est la représentation pécuniaire du risque.
La prime dénommée prime chargée ou prime commerciale est composée de la prime pure ou
théorique et du chargement.

COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME
PROFESSEUR BOLO IRIE
3
- La prime pure
C’est la valeur du risque, elle est la couverture théorique du risque elle est fonction:
Du risque
De la somme assuré
De la durée de l’assurance, en principe une année
Du taux d’intérêt.
- Le chargement de la prime
Il s’agit des frais généraux de l’entreprise. Il se compose de :
De la rémunération du capital
Des frais d’acquisition des contrats
Des frais d’encaissement des primes
Des frais de gestion ou d’administration
D’impôts
c- La prestation de l’assureur
Elle représente la contre partie de la prestation de l’assuré à savoir la prime
Cette prestation consiste suivant les cas à indemniser l’assuré (assurance de dommage) ou à
verser une somme déterminée dans la police (assurance de personne). On dit que l’obligation
de l’assureur est à terme lorsque le risque couvert se réalisera certainement mais à une
époque incertaine ; elle est conditionnelle lorsque le risque couvert est un événement
incertain, en soi.
3- Le rôle de l’assurance
L’assurance a pour rôle fondamental de conférer aux clients la sécurité dont ils ont besoin.
Elle leur apporte la confiance dans l’avenir. Les assurés sont ainsi protégés contre les risques
du hasard (eux ou leur patrimoine)
4- Constitution de capitaux
Par l’accumulation des primes, l’assurance permet la constitution de capitaux. En effet,
l’assurance permet que de petite somme, qui autrement auraient été consommées, soit réuni
au sein de l’entreprise, conservé, placé jusqu’au jour ou elles doivent servir au règlement des
sinistres.
5- Moyen de crédit
L’assurance est un moyen de crédit pour l’assuré, en effet elle facilite son crédit en
renforçant les garanties qu’il offre à ses créanciers. Elle permet également à l’assuré de
consentir du crédit à ses clients.
III- CLASSIFICATION DES ASSURANCES

COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME
PROFESSEUR BOLO IRIE
4
L’assurance a un domaine très vaste et ses applications sont en quelque sorte illimitée. Il
existe cependant certaines classifications qu’il est important de connaître. Les assurances
peuvent être classées selon la nature des risques pris en charge ou plus exactement suivant
l’élément naturel ou les risques se situent.
Dans le domaine des transports, l’on intervient du point de vue juridique sur la quasi-totalité
des éléments du transport : code de route, tarification, droits et obligation du transporteur,
type d’engin à utiliser, assurance…
En matière d’assurance, très peu de textes ont été élaborés ; cependant, les domaines couverts
sont nombreux et importants soit du fait de la nature des risques pris en charge qu’on y
rencontre ou encore de la gravité des dommages éventuels que peut subit l’assuré, soit du fait
de l’importance financière de ce type de dommages. Ainsi, il est fait obligation d’assurance
pour :
Les véhicules terrestres à moteur et leur remorque ;
Les corps de navires maritimes et aériens
Les biens et marchandises de toute nature à l’importation
Les assurances transport sont un aspect des différentes formes d’assurance. Il existe de très
nombreuses formes d’assurance que l’on regroupe souvent selon «l’élément naturel » au
niveau duquel se situent les risques. On les regroupe souvent sous deux rubriques
essentielles :
1- Les assurances maritimes
Son but est de couvrir le risque de mer, c à d le risque qui peut survenir au cours d’une
expédition maritime soit au navire et ou aux tiers soit aux marchandises. Cette assurance ne
couvre que les dommages causés aux biens et ne garanti pas les personnes exposés à ce
risque. Notons que :
- L’assurance fluviale qui couvre les risques de transport sur flouves, canaux et rivières
susceptibles d’atteindre les bateaux est calquée sur l’assurance maritime
- Il faut faire une mention spéciale, en égard à l’élément dans lequel se trouve le risque, à
l’assurance transport aérien dont l’objet est de couvrir les risques auxquels l’aéromel et les
marchandises transportées sont exposés durant un transport aérien. Par définition, elle n’est
pas une assurance terrestre. Cependant, les règles de la loi du contrat d’assurance non
maritime peuvent lui être appliquées.
2- Les assurances de personne et de dommages
Elles se subdivisent en :
Assurance sociale : elle vise à garantir l’individu contre les risques inhérents à la
condition humaine (maladie, invalidité, vieillesse, décès…). Elles se caractérisent par le
fait que d’autres personnes que l’assuré (employeurs, état) participent au paiement des
cotisations
Assurance privée : elle se compose des assurances de personnes et des assurances
de dommages.
a- Les assurances de personne
Elles sont également appelées assurance de capitaux. Leur objet est la personne
humaine : c’est la personne de l’assuré qui est prise en considération : elle est protégée

COURS DES AUSSURANCES ET EXPERTISE MARITIME
PROFESSEUR BOLO IRIE
5
contre les risques qui la menacent dans son existence, son intégrité. Sa santé ou sa
vigueur (vie, mort, accident, maladie…). Ces assurances comportent des prestations
indépendantes du dommage pouvant résulter de l réalisation du risque couvert. Ces
prestations n’ont pas un caractère indemnitaire ; elles n’ont pas pour but de réparer un
préjudice.
b- L’assurance de dommage
Elles ont pour objet la réparation d’un préjudice subi par l’assuré, soit directement en raison
de la disparition d’un bien faisant partie de son patrimoine, soit raison l’obligation dans
laquelle il pense retrouvé de réparer le préjudice subi par un tiers. On distingue deux types
d’assurance de dommages :
Les assurances de choses : elles ont pout but d’indemniser l’assuré des pertes
matérielles qu’il subit directement dans la perte ou l’altération de ce matériel. Elle est
destinée à réparer le dommage causé aux biens lui appartement.
Les assurances de responsabilité : leur but est de garantir l’assuré contre les recours
exercés envers lui par des tiers en raison du préjudice qu’il a pu leur causer et qui engage sa
responsabilité. Les assurances relatives au transport des marchandises, quel soit le mode de
transport sont classées dans le groupe des assurances des dommages que l’on appelle
également assurance d’intérêts qui ont pour objectif de garantir l’assuré contre les
conséquences d’un événement pouvant causer un dommage à son patrimoine. Des risque
couverts par l’assurance dommage, ou distingue : les risques survenant à la marchandise et
ceux relatifs aux véhicules ; on parle alors du point de vue des assurances d’une assurance de
choses dans un cas et d’une assurance de responsabilité dans l’autre. Dans certain cas
l’assurance relative au secteur des transports est à la fois une assurance de choses et une
assurance de responsabilité. C’est le cas dans le domaine maritime de l’assurance corps.
3- Assurance à prime fixe et assurance mutuelle
On dit que l’assurance est à prime fixé lorsque l’entreprise revêt la forme d’une société par
action plus exactement d’une société anonyme. L’assurance est dite mutuelle lorsqu’un
certain nombre de personnes exposées à des risques similaires décident de mettre ce risque
en commun.
IV- REASSURANCE ET COASSURANCE
1- La réassurance
Elle se définit comme l’assurance par un assureur de l’indemnité d’assurance. En souscrivant
ainsi auprès d’un autre assureur la couverture de risque assuré, l’assureur minimise sa charge
quant aux risques assuré. Sauf stipulation contraire, l’assuré ne peut avoir un intérêt assurable
dans la réassurance. Dans la pratique, un traité matérialise la réassurance. Ce traité peut
pendre trois formes :
a- le traite de partage ou en participation
L’assureur propose à un réassureur, la prise en charge de la moitié ou du ¼ du risque. La
réassurance peut être automatique entre certaines compagnies.
b- le traité de trop-plein ou en excédent de perte
L’assureur dans ce cas fait prendre en change automatiquement par un réassureur des risques
des que ceux-ci atteignent un montant bien déterminé dans le traité.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%