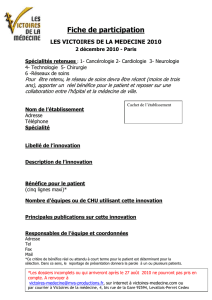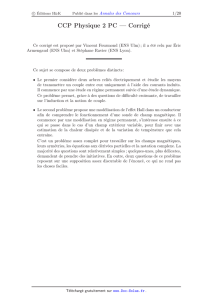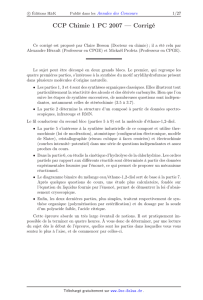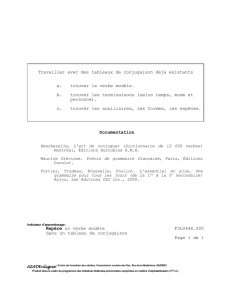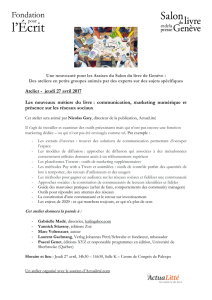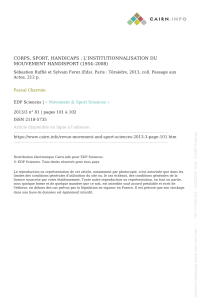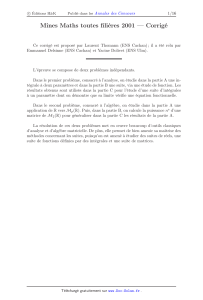Communication & Développement Durable : Paradoxe & Enthousiasme
Telechargé par
manudu13fr

COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : PARADOXE ET
ENTHOUSIASME
Gilles Berhault, Alain Chauveau et Monica Fossati
Victoires éditions | « Vraiment durable »
2012/1 n° 1 | pages 153 à 162
ISSN 2260-2895
ISBN 9782351131299
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-vraiment-durable-2012-1-page-153.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Victoires éditions.
© Victoires éditions. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions

Communication et
développement durable :
paradoxe et enthousiasme
Gilles Berhault, Alain Chauveau, Monica Fossati Acidd – Observatoire de la communication
et du marketing responsables
Résumé
La 9e Université d’été de la communication pour le développement durable,
organisée par Acidd et le Comité 21, a clôturé ses travaux le 31 août 2011 dans
le Luberon, sur un constat difficile, mais avec un enthousiasme partagé par
toutes les parties prenantes de la communication, pour l’essentiel regroupées
au sein de l’Observatoire de la communication et du marketing responsables.
Tour d’horizon de ces échanges et des conclusions d’études.
Abstract
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions

2 VRAIMENT DURABLE - Décembre 2011
PENSER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Consommer ? Posséder ? Prospérer ? Trois mots suivis de points
d’interrogation… Comment la communication et le marketing peuvent-ils,
doivent-ils, évoluer pour permettre de sortir de l’hyper-consommation,
de la « cage de fer » du consumérisme, selon l’expression de Tim Jackson
1,
et aller vers une consommation durable ? Ainsi peut être défini le paradoxe
auquel sont confrontés aujourd’hui les communicants à la recherche
d’une nouvelle prise de parole sur la responsabilité sociétale
des entreprises qu’ils représentent.
pléter : « Le couple “être et avoir“ structure
toute la réflexion philosophique depuis l’An-
tiquité. Nous sommes dans un nécessaire
renouveau de ce couple. La réflexion entre
l’être et l’avoir se pose différemment et de
façon cruciale à l’ère de la rareté – d’autant
plus si nous passons de 7 à 9 milliards d’in-
dividus. Cet avoir peut devenir une condition
de survie de l’humanité. Nous persistons à
confondre le progrès humain avec l’expan-
sion, alors que nous devons préserver des
espaces pour la nature et n’avons désormais
plus d’extension possible. »
La crise actuelle est-elle le signe annoncia-
teur de la disparition du monde que nous
avons connu ? Patrick Viveret, citant Antonio
Gramsci – « La crise se produit lorsque le
vieux monde tarde à disparaître » –, insiste
sur la force des mots qui donnent sens à
nos vies : « Le mot “valeur“ signifie force
de vie. Qu’est-ce qui est force de puissance
créatrice aujourd’hui ? La vraie valeur, la vraie
richesse, ce n’est pas l’argent. À quoi me
sert-il si je n’ai pas d’eau, si l’air est pollué ?
La richesse est ce qui donne de la force de
vie, ce qui fait que pour une communauté
humaine, la vie a un sens. »
« Amour, bonheur, sens » : trois mots forts
à l’occasion de cette Université d’été de la
communication pour le développement du-
Les acteurs de la filière communication voient
désormais leur responsabilité élargie, ce
qu’il convient d’accueillir comme une am-
bition nouvelle, comme le souligne Gilles
Berhault, président du Comité 21 et d’Acidd :
« Le développement durable est une nouvelle
opportunité créative et de valorisation de
tous les métiers de la communication, de
l’information et du marketing. C’est aussi
un pas déterminant vers l’apprentissage de
la capacité collective. »
Le monde de la communication a plus que
jamais besoin de se ressourcer, de se re-
nouveler, en écoutant des philosophes, des
scientifiques, des intellectuels qui les aident
à comprendre et à appréhender ce monde
de crises sociales, financières, écologiques
à l’échelle mondiale. Le contexte actuel est
particulièrement complexe : pour la première
fois, l’humanité entière est confrontée à des
enjeux communs que Patrick Viveret
2 résume
ainsi : « Nous sommes dans un état de si-
dération… C’est le temps de la résilience au
niveau sociétal. Nous avons traité des symp-
tômes de la crise de 2008, sans en traiter la
cause. Il n’y a plus de possibilité d’arrêter
l’emballement. De la résistance au déses-
poir, l’humanité doit aujourd’hui influer sa
route du fait des limites environnementales,
culturelles et sociales ». Et Bettina Laville,
présidente d’honneur du Comité 21, de com-
1 Tim Jackson, Prospérité sans croissance – La transition vers une économie durable, De Boeck éditions, collection « Planète en
jeu », avril 2010.
2 Patrick Viveret est philosophe, préfacier du livre Prospérité sans croissance de Tim Jackson, auteur notamment de Reconsidérer la
richesse (Éditions de l’Aube, réédition mai 2010).
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions

Décembre 2011 VRAIMENT DURABLE 3
COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : PARADOXE ET ENTHOUSIASME
rable, à revisiter totalement selon Patrick
Viveret. Un éclairage riche pour un monde
de communication(s), dont la réponse se
trouve dans l’attitude et les actions.
Déclin du développement durable
dans les médias ?
Reflet de nos sociétés, la communication est
un indicateur des courants de pensée qui
l’animent. Comment traduire, à l’occasion
de ce temps de réflexion, la perception de
ce monde en profonde mutation ?
La période 2008-2009 a été témoin d’une forte
montée des thématiques liées au développe-
ment durable dans les médias. Les sujets tour-
naient principalement autour de trois axes :
- l’état de la planète (ses ressources, la
biodiversité, le changement climatique…)
a été largement développé dans tous les
supports d’information, avec un contexte
anxiogène lié à une visibilité accrue des
problématiques, sans être accompagné
de solutions en réponse. D’où le succès
des films Une Vérité qui dérange, Home...
- le deuxième axe a concerné la prise de
conscience politique autour des grands en-
jeux nationaux et internationaux (Grenelle
Environnement, Conférence des Parties…).
- enfin, le troisième, adressé au « consom’ac-
teur », l’a engagé avec enthousiasme à mieux
consommer, à consommer « vert », à adopter
une éco-attitude. La communication et les
médias, portés par ce vent frais et optimiste,
se sont « emballés », voyant tout en « bio » et
en « vert », avec parfois un manque de recul
patent comme leur engouement pour les
biocarburants censés mettre « des fleurs dans
nos moteurs »… mais qui deviendront plus
tard les nécro-carburants dans les mêmes
rubriques.
La période 2010-2011 s’est caractérisée, en
revanche, par un « reflux », nourri par la prise
de parole de quelques climato-sceptiques
et une démobilisation marquée sur fond de
crise, la préoccupation individuelle redeve-
nant prioritaire face aux enjeux collectifs et
de long terme. S’y est ajouté le goût amer et
inquiet de la déception politique, provoquée
par l’échec des négociations de la Conférence
des Parties de Copenhague (décembre 2009)
qui a montré l’incapacité de l’humanité à
s’unir pour lutter contre un enjeu global, mais
aussi par le Grenelle Environnement, dont
la mise en œuvre, moins collective qu’elle
n’avait été annoncée, a accentué la perte
de crédibilité et de confiance. Tout cela a
contribué à faire monter la peur de la ma-
nipulation, la suspicion et la dénonciation
du greenwashing. C’est donc dès la fin de
2009 que s’est amorcé le déclin régulier de
l’intérêt des Français pour l’environnement,
mitigé d’un sentiment d’impuissance face
à un courant permanent d’alertes en même
temps qu’une prise de conscience des liens
entre dimensions environnementales, éco-
nomiques et sociales.
La grande méfiance
Probable effet collatéral de ce désintérêt, le
niveau de confiance accordé aux entreprises
à travers leur communication n’a jamais été
aussi faible, selon l’Edelman Trust Barometer
(2011). Dans certains pays, la chute est même
vertigineuse, mais c’est en France que ce
niveau est le plus bas. Culturellement, il
existe une défiance très marquée, typique-
ment française, envers les entreprises et le
monde des affaires. Leur communication
sur le développement durable, considérée
comme trop souvent basée sur la « langue
de bois » et le manque de transparence,
laisse les Français sceptiques. Un scepti-
cisme renforcé par le déploiement, notam-
ment dans les blogs, d’une information
plus scrutatrice et exigeante, plus neutre et
désintéressée, mais aussi par la vigilance
d’associations à but non lucratif, qui dé-
noncent les abus des messages et agissent
en vrai garde-fou du greenwashing. Cette
défiance est confirmée par l’Observatoire
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions

4 VRAIMENT DURABLE - Décembre 2011
PENSER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
de l’authenticité
3 : un Français sur deux ne
croit pas ce qui est véhiculé par les entrepri-
ses dans leurs discours institutionnels. Un
positionnement encore plus critique quand
on aborde des sujets sensibles comme le
développement durable. D’après « Les Fran-
çais et la consommation responsable »
4 et
« Les Français et le green marketing, après
la crise »
5, 80 % des personnes interrogées
ne font pas confiance aux discours envi-
ronnementaux des entreprises (90 % des
18-24 ans) et auraient une mauvaise image
d’une entreprise qui abuserait de l’argument
environnemental.
La publicité : entre publiphobie
et « fatigue verte »
Omniprésente, la publicité est depuis long-
temps sujette à controverse, mais le dé-
samour s’affirme aujourd’hui : 80 % des
Français pensent qu’elle est une source
d’ennui, 48 % n’y prêtent pas attention et
34 % se considèrent comme publiphobes
selon l’étude « Publicité et Société »
6. Côté
messages environnementaux, l’année 2010
a marqué un recul du thème dans la publi-
cité, après le boom des messages verts qui
a culminé en 2009. En effet, selon le « Bilan
publicité et environnement »
7
, le taux de vi-
suels pertinents évoquant de près ou de loin
la nature parmi le total des visuels analysés
est passé de 12 % en 2009 à 6 % en 2010. La
leçon du greenwashing commence à être
comprise, car le taux de manquement aux
règles déontologiques professionnelles en
matière de publicités utilisant des arguments
environnementaux s’établit à seulement 3 %,
après avoir culminé à 6 % les deux années
précédentes. Seuls des secteurs comme le
bâtiment – qui a pourtant largement évolué
sur la même période avec force réglemen-
tations et labels – ou encore les producteurs
d’équipements ou de produits de nettoyage,
restent à « surveiller »... Cette vague verte,
même si elle semble refluer, a manifeste-
ment très vite fatigué les consommateurs.
Dans « Les Français et le greenwashing »
8,
ils sont même 52 % à trouver qu’il y a trop de
publicités « vertes » et 83 % des personnes
interrogées pensent que ces publicités de-
vraient être mieux contrôlées.
Tous les indicateurs de sensibili-
sation sont... au vert !
Malgré un recul des préoccupations pour le
développement durable, plus d’un Français
sur deux se dit plus concerné par l’environ-
nement que par l’économie. Pour l’Obser-
vatoire du marketing écologique
9, ce sont
deux tiers des Français qui se préoccupent
de l’écologie et une grande majorité estime
même que l’on n’en fait pas assez pour l’en-
vironnement. Les Français sont presque tous
convaincus que « si l’on n’agit pas mainte-
nant en faveur de la planète, les générations
futures sont réellement menacées », et les
trois quarts pensent que « ce que chacun fait
individuellement contribue vraiment à proté-
ger l’environnement », selon l’Observatoire
du développement durable
10. D’après « Les
Français et le greenwashing », ce sont même
85 % des Français pour qui les questions
3 Makheia Groupe – Occurrence, septembre 2010.
4 Baromètre Ethicity, mars 2011.
5 Emerit Consulting, juin 2011.
6 Australie-TNS Sofres, octobre 2010.
7 ARPP-DEME, décembre 2010.
8 WWF, l’Alliance pour la planète, l’Observatoire indépendant de la publicité, en partenariat avec l’Ifop, juin 2011.
9 Ipsos, juin-novembre 2010, Comment être visible et crédible sur la question écologique ?
10 Ifop, 2010.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions
Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 109.205.4.97 - 24/02/2020 15:26 - © Victoires éditions
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%