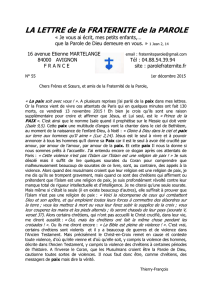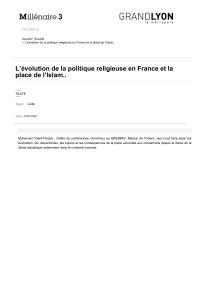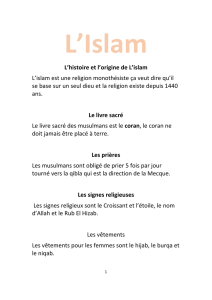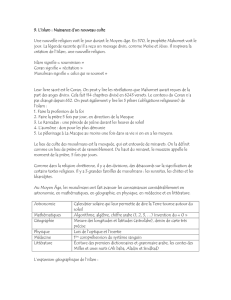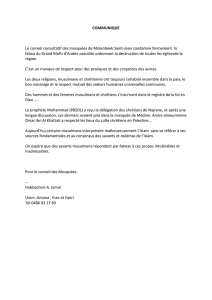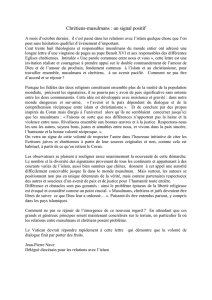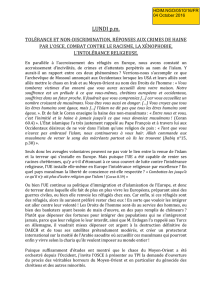l'intolérance religieuse
L 'l'intolérance religieuse est le discrimination une personne ou un groupe de personnes, en
fonction de leur religion [1] [2].
index
1 Les causes de l'intolérance religieuse
o 1.1 La religion de l'État
2 L'intolérance dans le monde contemporain
3 les organisations internationales pour la défense de la liberté religieuse
o 3.1 Nations unies
o 3.2 Union européenne
3.2.1 Parlement européen
3.2.2 Conseil européen
4 la législation nationale
o 4.1 Italie
o 4.2 D'autres pays
5 notes
6 bibliographie
7 Articles connexes
Les causes de l'intolérance religieuse
en religions polythéistes Il ne se produit pas le phénomène de 'intolérance [3] pour la multitude
des dieux, cela signifie qu'il ya la divinité vraie et unique et tous sont à craindre [4].
L'intolérance se manifeste chez les anciens quand il y a une caste sacerdotale qui veut
maintenir ses privilèges. Donc, il n'a pas été, par exemple, dans la politique religieuse de l'État
romain adressée généralement à accueillir dans panthéon dieux étrangers nationaux qui
peuvent être l'objet d'un culte à l'intérieur de ses frontières, mais en dehors de son territoire
sacré, ou de faire des cultes officiels du dieu ennemi qui deviennent ainsi les nouveaux
protecteurs du peuple victorieux. [5]
Intolérance peuples anciens se manifeste plutôt contre ceux qui sont accusés d'introduire de
nouveaux dieux, comme les philosophes qui seront déclarés coupables godlessness ou
athéisme, comme dans le cas de Socrate, sur des accusations de vouloir répandre les principes
qui portent atteinte à la moralité publique et religion nationale:
« [...] Cela a la signature et le serment d'Apple Orchard Pommeraie, Pitthée contre Socrate
Sophronisque, Alopecense. Socrate est coupable de ne pas reconnaître comme des dieux
traditionnels de la ville, mais d'introduire une nouvelle Divinité; et il est également coupable de
corrompre la jeunesse. Peine: mort [6] »
Ainsi, le sénatus Rome prohibant bacchanales et supervise les cultes étrangers, se justifie non
pas comme une volonté de défendre la religion de l'État, mais plutôt l'ordre moral et public

garanti par la religion nationale, celui qui est pratiqué par des personnes laissé libre dans ses
choix.
L'intolérance est plutôt liée à la orthodoxie contenant des principes absolus et inviolables,
dogmes révélé à partir d'une seule divinité et stocké de façon permanente dans les textes
sacrés inaltérables et gardés par une caste sacerdotale.
Tomber dans ces caractéristiques des religions supranationales et caractéristique universelle
d'un église qui s'adresse aux personnes de toute race ou de nationalité, mais en même
considérés dans leur individualité, qui est promis le salut, compris comme la libération du mal
et de l'erreur. Ces religions ont l'origine d'un fondateur historique qui est présenté comme
novateur par rapport aux croyances antérieures:
« Orthodoxie est un concept étranger aux religions naturelles et nationales parce que naturel. , Il
est à la place des religions bien fondée. Ce qui, comme ils sont originaires de l'œuvre d'un
fondateur, ils portent de la naissance les germes d'un développement conforme à leur nature; Et
quand ils ont été formés par la séparation et de protestation contre une autre religion, ainsi que
dans leur développement qui accentuent leur génie séparatiste et « protestant »; et ainsi donner
lieu par la suite à jamais de nouvelles formations (sept) du même type (par opposition à une autre
dans la doctrine et dans le culte), selon une division progressive et processus subdivision - à
savoir la différenciation progressive -, à travers laquelle il intensifie de plus en plus l'esprit
original d'exclusivité et le séparatisme, et donc de l'intolérance et l'intransigeance [7]. »
Ce phénomène d'intolérance est cependant pas eu lieu dans les religions fondées par un
caractère mythique Elle a fait référence à un ensemble de doctrines mythologiques non
catalogués dans les textes sacrés. Un exemple de ces religions était celle de mystères qui se
propagent dans le monde grec ancien et Moyen Orient, avec un développement particulier
hellénistique et par la suite époque romaine. Je suis retourné dans les mystères des religions
nationales parce que dans leur fidèle manquait une attitude exclusiviste et séparatiste.
Lorsque vers la fin du monde antique, même en l'absence d'une orthodoxie dans la religion
syncrétique Roman, en particulier contre la Christianisme Il manifeste une certaine
intolérance religieuse nature populaire justifiée par l'assimilation de la religion chrétienne à un
crime contre l'Etat avec la condamnation conséquente des nouveaux croyants de religion qui
refusent de reconnaître la divinité de l'empereur. Parmi les persécuteurs du début
historiographique chrétienne comptés Flavio Claudio Giuliano (Quels chrétiens ont appelé
Julien l'Apostat), le dernier empereur païen de Rome, qui, avec une politique religieuse » ...
visant à la restauration du paganisme, a commencé par des actes de neutralité et a pris fin avec
l'intolérance anti-chrétienne.[8]» [9] En fait, Giuliano priver seulement les chrétiens du droit
d'enseigner la littérature (Homère, Virgilio, etc., ou mythologie polythéisme) parce que ces
mythes se sont opposés frontalement. L'attitude chrétienne envers la religion antique avait
aussi tourner à la violence si un élément de conflit entre eux et l'empereur Julien a été
condamné à payer pour la reconstruction d'un temple païen sur le feu par les chrétiens[10][11].

De l’intolérance, de la discrimination et de la violence fondées sur
la religion ou la conviction
Le Conseil de l’Union européenne a publié le 21 février 2011 des
conclusions sur la promotion et la protection de la liberté de
religion ou de conviction sans aucune discrimination. Le Conseil
est le principal centre de décision politique de l’Union européenne
Le Conseil a adopté les conclusions suivantes : "Le Conseil réaffirme que l’Union
européenne est résolument attachée à la promotion et à la protection de la liberté de religion
ou de conviction sans aucune discrimination, et rappelle les conclusions générales qu’il a
adoptées à cet égard le 16 novembre 2009.
Le Conseil exprime sa profonde préoccupation concernant le nombre croissant de
manifestations d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion, dont témoignent les
violences et les actes de terrorisme perpétrés récemment, dans différents pays, contre des
chrétiens et leurs lieux de culte, des pèlerins musulmans et d’autres communautés religieuses,
actes qu’il condamne fermement. Aucune région du monde n’est hélas épargnée par le fléau
de l’intolérance religieuse.
Le Conseil adresse ses condoléances et exprime sa solidarité aux pays concernés et aux
victimes de ces actes et rend hommage aux pays pour leur détermination à prévenir de tels
actes.
La liberté de religion ou de conviction est un droit de l’homme universel, qui doit être protégé
partout et pour tous. Les États ont pour premier devoir de protéger leurs citoyens, y compris
les personnes appartenant à des minorités religieuses, ainsi que toutes les personnes relevant
de leur juridiction, et de préserver leurs droits. Toutes les personnes appartenant à des
communautés et à des minorités religieuses devraient pouvoir pratiquer leur religion et leur
culte librement, individuellement ou en communauté, sans craindre d’être la cible de
manifestations d’intolérance ou d’attaques.
La liberté de religion ou de conviction est intrinsèquement liée à la liberté d’opinion et
d’expression, ainsi qu’à d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales, qui, ensemble,
contribuent à la mise en place de sociétés pluralistes et démocratiques. La communauté
internationale doit être plus ferme dans la manière dont elle réagit face à ceux qui veulent
utiliser la religion comme instrument de division, alimentant ainsi l’extrémisme et la
violence.
Dans le cadre d’un renforcement des efforts déployés par l’UE dans l’action bilatérale et
multilatérale qu’elle mène en faveur de la liberté de religion ou de conviction, l’UE et ses
États membres restent attachés à la concrétisation de la liberté de religion ou de conviction
dans toutes les régions du monde ; ce thème sera traité dans les rapports annuels de l’UE sur
les droits de l’homme. L’UE continuera de nouer le dialogue avec les pays partenaires et de
proposer sa coopération pour promouvoir la tolérance religieuse et protéger les droits de
l’homme. Elle jouera un rôle plus actif dans les enceintes multilatérales, en particulier l’ONU,
afin que la lutte contre l’intolérance religieuse recueille un soutien vigoureux provenant de

toutes les régions.
L’UE et ses États membres continueront de soutenir des initiatives dans le domaine du
dialogue interculturel et interreligieux dans un esprit d’ouverture, de main tendue et de
compréhension mutuelle, y compris les initiatives émanant de l’Alliance des civilisations des
Nations unies, de l’UNESCO et de la Fondation Anna Lindh.
Le Conseil se félicite des efforts déployés actuellement pour renforcer l’action menée par
l’UE afin de promouvoir et de protéger la liberté de religion ou de conviction à la suite des
conclusions du Conseil de 2009. Le Conseil invite la Haute Représentante à rendre compte
des mesures prises et des propositions concrètes faites pour renforcer encore l’action de l’UE
en la matière."
Violence, intolérance, y a-t-il une spécificité de l'islam?
Depuis qu’il n’a plus été possible à l’Occident d’ignorer la violence et les atrocités commises au nom
de l’islam – disons, par commodité, depuis les attentats du 11 septembre 2001 – il n’a jamais manqué

de bon esprits pour s’improviser théologiens, au débotté, et pour nous expliquer que, bien
évidemment, ceux qui tuent et oppriment au nom de l’islam n’ont rien compris à la religion de
Mahomet, qui est fondamentalement pacifique et tolérante, ou à tout le moins ni plus intolérante ni
plus violente que les autres religions monothéistes.
Ce discours désormais bien rodé se fait bien sûr particulièrement entendre lorsque se produit quelque
attentat, ou bien que l’Occident se décide à combattre timidement des jihadistes devenus trop
entreprenants – comme en ce moment.
Dans ce contexte, je me suis donc dit qu’il ne serait pas malvenu de vous présenter cet article qui
rappelle utilement quelques faits élémentaires que nos théologiens en herbe devraient connaître –
s’ils se souciaient réellement de théologie, et de vérité.
Bonne lecture !
Are judaism and christianity as violent as islam?
Par Raymond Ibrahim, Middle East Quarterly, summer 2009
« Il y a bien plus de violence dans la Bible que dans le Coran ; l’idée que l’islam se serait imposé par
l’épée est une fiction occidentale inventée durant le temps des croisades, lorsque c’étaient
précisément les chrétiens occidentaux qui se livraient à une guerre sainte brutale contre
l’islam
1
[1]. » Ainsi parle Karen Armstrong, une ancienne nonne qui se décrit comme une
« monothéiste freelance ». Cette citation résume le plus influent de tous les arguments qui servent
aujourd’hui à réfuter l’accusation selon laquelle l’islam serait violent et intolérant par nature : toutes
les religions monothéistes, disent ceux qui avancent cet argument, et pas seulement l’islam, ne sont
pas avares de textes violents et intolérants ainsi que d’évènements sanglants tout au long de leur
histoire. Ainsi, lorsque les textes sacrés de l’islam – en premier lieu le Coran, suivi par les dits et faits
de Mahomet (les hadiths) – sont mis en avant pour démontrer le caractère fondamentalement
belliqueux de cette religion, la réponse immédiate sera que les autres livres sacrés, et notamment
ceux du christianisme et du judaïsme, regorgent eux aussi de passages violents.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%