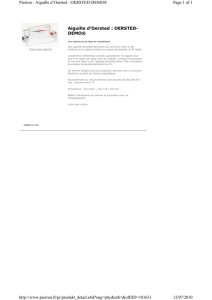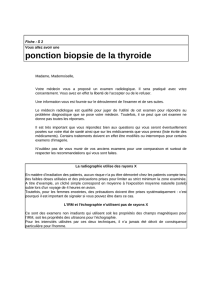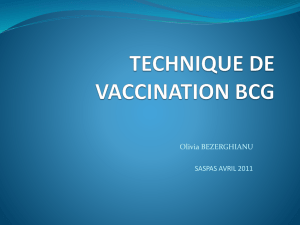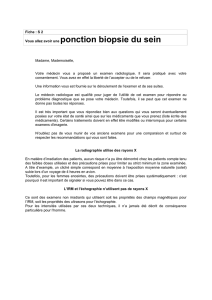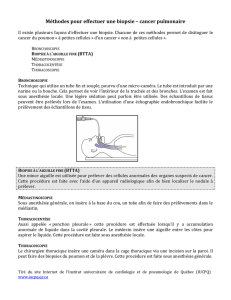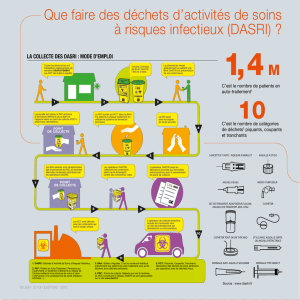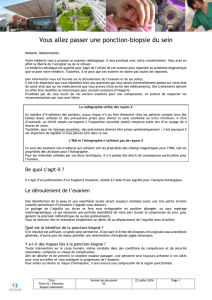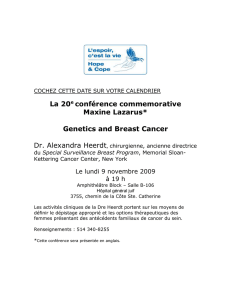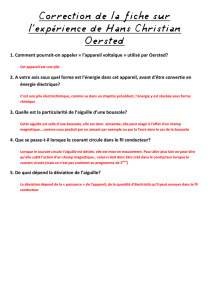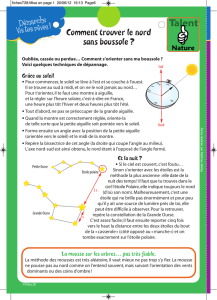34-800-A-13
Échographie
interventionnelle
du
sein
B.D.
Fornage
Parce
que
l’échographie
est
la
seule
méthode
d’imagerie
en
coupes
en
temps
réel,
elle
est
devenue
au
cours
des
deux
dernières
décennies
la
méthode
de
choix
pour
toutes
les
techniques
interventionnelles
liées
au
diagnostic
–
et
parfois
même
au
traitement
–
des
masses
du
sein,
depuis
les
ponctions
à
l’aiguille
fine
jusqu’aux
récentes
techniques
d’ablation
percutanée.
Après
la
description
des
techniques
de
base
du
guidage
échographique
des
aiguilles
et
des
instruments
utilisés
dans
les
interventions
échoguidées
du
sein,
les
techniques
de
ponctions
percutanées
échoguidées
(cytoponctions,
drainages
de
kystes
et
collections
liquidiennes,
microbiopsies
et
macrobiopsies)
sont
décrites
et
leurs
indications
respectives
discutées.
Les
différentes
techniques
de
repérage
préopératoire
des
lésions
non
palpables
utilisant
les
hamec¸ons
métalliques,
les
colorants
ou
les
substances
radioactives
sont
également
décrites
ainsi
que
la
technique
simple
d’échographie
peropératoire.
Enfin,
les
techniques
d’ablation
percutanée
échoguidées
des
masses
du
sein
qui
suscitent
beaucoup
d’intérêt
aujourd’hui
sont
présentées
avec
leurs
limitations
et
les
interrogations
qu’elles
soulèvent.
©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
Mots-clés
:
Échographie
;
Sein
;
Interventions
échoguidées
;
Biopsies
;
Marquage
préopératoire
;
Ablation
percutanée
Plan
■Introduction
1
■Ponctions–biopsies
échoguidées
des
masses
du
sein
1
Considérations
générales
1
Guidage
échographique
2
Cytoponctions
(ponctions
à
l’aiguille
fine)
4
Microbiopsies
8
Macrobiopsies
10
Quelle
technique
de
biopsie
choisir
:
cytoponction,
micro-
ou
macrobiopsie
?
11
Mise
en
place
de
marqueurs
biopsiques
12
Complications
des
ponctions
à
l’aiguille
percutanées
13
Clés
du
succès
des
biopsies
échoguidées
13
■Techniques
de
localisation
des
masses
non
palpables
du
sein
14
Repérage
à
l’aide
d’«
hamec¸ons
»
métalliques
14
Marquage
par
injection
échoguidée
de
substances
colorantes
14
Repérage
à
l’aide
de
substances
radioactives
15
Repérage
échographique
peropératoire
15
■Autres
techniques
interventionnelles
échoguidées
16
Galactographie
percutanée
antégrade
16
Injection
de
radiotraceur
en
zone
péritumorale
pour
lymphoscintigraphie
16
Mise
en
place
des
dispositifs
de
curiethérapie
dans
la
cavité
postopératoire
après
tumorectomie
16
■Ablation
percutanée
des
tumeurs
du
sein
17
Thermothérapie
17
Cryothérapie
17
Électroporation
irréversible
17
Limitations
des
techniques
d’ablation
percutanée
des
tumeurs
du
sein
17
Introduction
L’échographie
du
sein
est
devenue
le
complément
essentiel
de
l’examen
clinique
du
sein
et
de
la
mammographie
en
permettant
non
seulement
de
distinguer
les
kystes
des
masses
solides,
mais
aussi
de
caractériser
ces
masses
solides
et
de
distinguer
les
masses
bénignes
des
tumeurs
malignes [1].
Grâce
à
l’amélioration
constante
de
la
résolution
des
images
obtenues
avec
les
sondes
de
fréquences
de
plus
en
plus
élevées,
à
l’emploi
de
systèmes
Doppler
énergie
de
plus
en
plus
performants
et
à
l’obtention
de
cartographies
vasculaires
de
plus
en
plus
pré-
cises,
l’échographie
a
fondamentalement
changé
l’approche
des
masses
du
sein
«
indéterminées
».
Cependant,
de
l’amélioration
des
techniques
de
dépistage,
que
ce
soit
par
mammographie
ou
imagerie
par
résonance
magnétique
(IRM),
a
résulté
un
nombre
croissant
de
ces
masses
indéterminées
dont
la
majorité
doit
être
vérifiée
par
biopsie
percutanée.
Parce
que
l’échographie
est
la
seule
méthode
d’imagerie
en
coupes
en
temps
réel,
elle
est
devenue
au
cours
des
deux
dernières
décennies
la
méthode
de
choix
pour
toutes
les
techniques
interventionnelles
liées
au
diagnostic
–et
parfois
même
au
traitement
–
des
masses
du
sein,
depuis
les
ponc-
tions
à
l’aiguille
fine
jusqu’aux
récentes
techniques
d’ablation
percutanée.
Ponctions–biopsies
échoguidées
des
masses
du
sein
Considérations
générales
Le
but
des
ponctions–biopsies
à
l’aiguille
percutanées
des
masses
non
palpables
du
sein
est
d’obtenir
un
diagnostic
fiable
à
EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
génito-urinaire
-
gynéco-obstétricale
-
mammaire 1
Volume
9
>
n◦3
>
juillet
2014
http://dx.doi.org/10.1016/S1879-8543(14)49420-5
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/11/2014 par CERIST ALGERIE (353213)

34-800-A-13 Échographie
interventionnelle
du
sein
100
%
afin
de
réduire
le
nombre
de
biopsies
chirurgicales
inutiles
réalisées
pour
des
masses
bénignes.
En
cas
de
masse
suspecte
ou
indéterminée,
l’obtention
d’un
diagnostic
fiable
de
cancer
permet
à
la
patiente
et
à
l’équipe
multidisciplinaire
de
discuter
le
traite-
ment
le
plus
approprié
sans
que
la
patiente
ne
doive
attendre
les
résultats
d’une
biopsie–exérèse
chirurgicale,
et
en
lui
assurant
les
chances
d’un
traitement
néoadjuvant.
Il
est
important
de
garder
constamment
à
l’esprit
que
l’échographie
ne
peut
pas
visualiser
les
cancers
qui
apparaissent
à
la
mammographie
sous
la
forme
de
microcalcifications
sans
masse
associée.
En
revanche,
la
majorité
des
masses
décelées
à
la
mammographie
et
d’une
taille
supérieure
à
4
ou
5
mm
de
dia-
mètre
sont
visibles
en
échographie
si
l’examen
est
réalisé
par
un
opérateur
entraîné,
utilisant
un
appareillage
de
qualité,
et
sur-
tout
après
l’examen
méticuleux
des
mammographies
(et/ou
de
toute
autre
imagerie
corrélative)
afin
d’avoir
une
notion
précise
de
la
localisation
de
la
lésion
en
trois
dimensions
dans
le
sein
avant
de
commencer
l’examen
échographique.
Toutefois,
chaque
fois
qu’il
existe
une
suspicion
ou
des
antécédents
de
cancer
du
sein,
il
est
important
de
réaliser
un
examen
complet
du
sein
et
des
gîtes
ganglionnaires.
L’examen
complet
du
sein
est
également
indispensable
en
cas
de
seins
denses
à
la
mammographie
Dans
toute
ponction
à
l’aiguille
percutanée
et
quelle
que
soit
la
technique
de
guidage
utilisée,
il
existe
trois
étapes
indépen-
dantes
et
critiques
qui
doivent
être
remplies
pour
le
succès
de
la
biopsie.
D’abord,
l’opérateur
doit
atteindre
la
cible
et
s’assurer
que
l’extrémité
de
l’aiguille
de
biopsie
est
visible
dans
la
cible
en
cas
de
cytoponction
ou
la
traverse
en
cas
de
microbiopsie.
La
seconde
étape
–la
plus
importante
– consiste
à
extraire
le
spéci-
men
de
la
lésion
cible,
ce
spécimen
devant
être
satisfaisant
pour
l’anatomopathologiste
aussi
bien
quantitativement
que
qualita-
tivement.
Enfin,
il
est
indispensable
que
l’anatomopathologiste
soit
familiarisé
avec
la
pathologie
mammaire
et
possède
une
expérience
suffisante
avec
les
différents
types
de
prélèvements.
Par
exemple,
si
le
pathologiste
n’est
pas
formé
en
cytolo-
gie,
le
sénologue
sera
réduit
à
utiliser
des
microbiopsies
pour
obtenir
un
diagnostic
de
n’importe
quelle
masse
solide.
Tout
facteur
compromettant
le
succès
de
chacune
de
ces
trois
étapes
compromet
le
succès
final
de
la
biopsie [2].
“
Point
important
Les
trois
étapes
constituant
une
biopsie
percutanée
d’une
lésion
non
palpable
du
sein
:
•le
radiologiste
doit
atteindre
la
lésion
cible
;
•il
doit
échantillonner
la
masse,
extraire
un
spécimen
adéquat
et
le
poser
sous
le
microscope
;
•le
cytopathologiste
ou
pathologiste
spécialisé
en
patho-
logie
mammaire
doit
être
capable
d’établir
un
diagnostic.
Guidage
échographique
Pratiquement,
toute
lésion
qui
est
clairement
visualisée
à
l’échographie
peut
être
biopsiée
sous
guidage
échographique
avec
une
précision
extrême,
ce
qui
se
traduit
par
une
sécurité
totale
dans
des
mains
entraînées.
Quelles
machines,
quels
réglages
pour
les
biopsies
échoguidées
?
L’examen
échographique
doit
être
réalisé
avec
une
machine
de
bonne
qualité,
c’est-à-dire
comprenant
des
sondes
de
haute
résolution,
mais
pas
nécessairement
de
très
haute
fréquence.
La
fréquence
de
la
sonde
à
utiliser
est
conditionnée
par
la
profon-
deur
de
la
lésion
à
atteindre,
et
il
n’est
pas
exceptionnel,
pour
des
masses
situées
très
profondément
dans
des
seins
volumineux,
d’avoir
recours
à
des
sondes
linéaires
de
moyenne
fréquence,
c’est-
à-dire
une
fréquence
centrale
de
7
MHz,
voire
5
MHz,
ou
même
à
Figure
1.
Examen
du
creux
sus-claviculaire
montrant
trois
petits
gan-
glions
métastatiques
de
cancer
du
sein
(flèches)
proches
de
la
veine
jugulaire
interne
et
de
la
carotide.
Le
Doppler
couleur
permet
de
déter-
miner
la
trajectoire
la
plus
sûre
de
l’aiguille
de
cytoponction.
une
sonde
curvilinéaire
à
usage
abdominal.
Le
point
important
est
que
le
choix
de
la
sonde
la
plus
appropriée,
tant
en
ce
qui
concerne
sa
fréquence
que
la
géométrie
de
son
champ
de
vision
et
son
encombrement,
doit
être
fait
pour
une
visibilité
optimale
de
la
lésion
cible.
L’utilisation
de
l’imagerie
Doppler
énergie
est
très
importante
car
elle
permet
d’apprécier
la
vascularisation
de
la
masse
indéter-
minée,
mais
aussi
d’identifier
des
vaisseaux
de
taille
importante
qui
peuvent
se
trouver
sur
la
trajectoire
des
aiguilles
de
biopsies
et
qui
nécessiteront
un
changement
d’approche [3] (Fig.
1).
Un
certain
nombre
de
procédés
décrits
dans
l’espoir
d’améliorer
l’image
échographique
en
général
et
parfois
celle
des
aiguilles
de
ponction
ne
sont
pas
utiles
en
pratique.
Dans
notre
expé-
rience,
l’imagerie
harmonique
est
une
option
qui
ne
sert
qu’à
améliorer
l’imagerie
ultrasonore
de
certains
kystes,
mais
n’a
pas
d’application
pour
les
ponctions
échoguidées.
En
outre,
elle
limite
considérablement
la
pénétration
ultrasonore
et
réduit
donc
consi-
dérablement
la
profondeur
du
champ
de
vision,
de
sorte
qu’elle
ne
peut
être
appliquée
à
des
lésions
profondes.
Dans
notre
expé-
rience,
l’imagerie
en
speckle
reduction
n’apporte
aucun
bénéfice
à
l’imagerie
ultrasonore
et
n’est
d’aucune
utilisation
en
échographie
interventionnelle [4].
Le
balayage
composé
en
temps
réel
(real-time
compound
scan-
ning)
non
seulement
n’améliore
pas
la
qualité
de
l’image
en
raison
du
flou
induit,
mais
supprime
les
artefacts
qui
aident
au
diagnostic
échographique
(renforcement
postérieur,
ombre
acoustique,
arte-
fact
en
queue
de
comète)
et
peut
de
ce
fait
engendrer
des
erreurs
diagnostiques.
Ce
balayage
composé
nuit
en
pratique
à
la
visi-
bilité
des
aiguilles
de
ponction
et
doit
être
abandonné.
Nous
ne
l’utilisons
pas
dans
notre
institution.
L’élastographie
a
été
l’objet
d’une
certaine
mode
pendant
la
dernière
décennie.
Ses
performances
diagnostiques
ne
justifient
pas
son
emploi
pour
l’imagerie
du
sein.
Beaucoup
plus
grave
:
quelques
auteurs
particulièrement
enthousiastes
sur
l’utilisation
de
cette
technique
ont
suggéré
qu’elle
pouvait
éviter
des
biopsies
de
lésions
du
sein.
Il
est
inconcevable
aujourd’hui,
vu
le
manque
de
précision
diagnostique
de
cette
technique,
de
se
fonder
sur
la
seule
information
élastographique
pour
ne
pas
réaliser
la
biopsie
d’une
masse
indéterminée [5].
Nous
n’utilisons
pas
l’élastographie
dans
notre
institution.
2EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
génito-urinaire
-
gynéco-obstétricale
-
mammaire
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/11/2014 par CERIST ALGERIE (353213)

Échographie
interventionnelle
du
sein 34-800-A-13
En
fait,
dans
l’immense
majorité
des
cas,
il
n’est
pas
néces-
saire
d’utiliser
une
machine
de
très
haut
de
gamme
pour
effectuer
un
geste
interventionnel
guidé
par
échographie.
Aujourd’hui,
des
appareils
portables
de
milieu
de
gamme
ont
tous
les
atouts
néces-
saires
pour
fournir
une
imagerie
de
qualité
suffisante
et
visualiser
clairement
à
la
fois
la
cible
à
atteindre
et
l’aiguille
de
biopsie.
Sélection
de
la
cible
Parce
que
l’échographie,
la
mammographie
et
l’IRM
sont
fon-
dées
sur
des
principes
physiques
différents
et
sont
réalisées
avec
la
patiente
placée
dans
des
positions
différentes,
il
est
impératif
que
toute
biopsie
échoguidée
ne
soit
réalisée
qu’après
une
revue
méti-
culeuse
des
mammographies
et
des
autres
examens
d’imagerie
(IRM,
scintimammographie
ou
tomographie
à
émission
de
posi-
trons
[TEP])
pour
affirmer
que
la
lésion
ciblée
en
échographie
est
sans
le
moindre
doute
la
même
que
la
lésion
qui
a
été
détec-
tée
avec
les
autres
techniques
d’imagerie.
La
taille
de
la
lésion,
sa
forme,
sa
position
(position
sur
le
cadran
horaire
et
distance
à
partir
du
mamelon),
ainsi
que
son
environnement
tissulaire
(graisse
ou
tissu
glandulaire)
doivent
être
identiques
sur
les
images
échographiques
et
sur
les
images
obtenues
avec
les
autres
modali-
tés,
tout
en
sachant
que
des
différences
minimes
de
taille
(moins
de
10
%)
liées
à
l’agrandissement
mammographique
et
des
dif-
férences
légères
(moins
de
deux
heures)
concernant
la
position
sur
le
cadran
horaire
liées
à
la
différence
de
position
du
sein
et
de
compression
entre
les
différents
types
d’imageries
sont
accep-
tables.
Bien
entendu,
la
nécessité
d’une
telle
corrélation
ne
s’applique
pas
au
cas
où
la
biopsie
est
pratiquée
sur
une
lésion
détectée
uni-
quement
à
l’échographie.
En
principe,
une
biopsie
échoguidée
ne
devrait
être
réalisée
qu’une
fois
l’imagerie
complète
du
sein
terminée,
qu’il
s’agisse
de
clichés
mammographiques
additionnels
(clichés
localisés
avec
compression,
agrandissements,
autres
incidences,
etc.),
d’IRM,
ou
de
TEP,
afin
d’éviter
le
risque
d’hématome
qui
perturbe-
rait
l’interprétation
des
autres
examens.
En
pratique,
il
n’est
cependant
pas
rare
de
réaliser
les
biopsies
nécessaires
de
masses
suspectes
sans
attendre
la
réalisation
d’une
IRM
dont
le
délai
pour-
rait,
dans
certains
cas,
retarder
les
décisions
thérapeutiques
d’une
ou
de
plusieurs
semaines.
Technique
d’échoguidage
de
l’aiguille
de
biopsie
Même
si
presque
tous
les
constructeurs
commercialisent
un
«
guide
à
ponction
»
qui
consiste
en
une
attache
destinée
à
main-
tenir
l’aiguille
alignée
avec
le
plan
de
coupe
et
qui
s’accroche
et
se
décroche
facilement
de
la
sonde,
ces
guides
ne
sont
pratiquement
jamais
utilisés.
L’immense
majorité
des
sénologues
préfèrent
utiliser
la
tech-
nique
dite
à
mains
libres
qui
implique
que
l’insertion
et
l’orientation
de
l’aiguille
sont
effectuées
sans
aucun
guide
et
que
le
placement
correct
de
l’aiguille
est
obtenu
grâce
à
la
constante
réorientation
de
l’aiguille
et
de
la
sonde,
manipulées
respectivement
par
chacune
des
deux
mains
de
l’opérateur [6].
Indiscutablement,
cette
technique
à
mains
libres
requiert
un
mini-
mum
d’expérience
de
la
part
de
l’opérateur,
alors
que
l’utilisation
d’un
guide
assure
pratiquement
à
tout
coup
de
voir
l’aiguille
suivre
sur
l’écran
la
trajectoire
théorique
balisée
sur
le
moniteur
par
une
ou
deux
lignes
électroniques [7].
Parmi
les
inconvénients
de
l’utilisation
d’un
guide
qui
ont
certainement
freiné
leur
emploi
figurent
la
nécessité
d’acquérir
l’adaptateur-guide
(encore
que
la
plupart
des
compagnies
fournissent
ces
guides
à
titre
gracieux
lors
de
l’achat
des
machines),
le
maintien
de
sa
stérilité
ou
l’emploi
de
dispositifs
jetables
à
usage
unique,
et
le
fait
qu’une
fois
l’aiguille
introduite
dans
le
guide
il
n’est
généralement
pas
possible
d’en
modifier
la
direction,
ce
qui
limite
l’échantillonnage
de
la
lésion.
D’autres
systèmes
de
guidage
faisant
appel
à
des
guidages
électro-
niques
sophistiqués
trop
complexes
et
coûteux
sont
restés
sans
succès [8,
9].
Quelle
que
soit
la
technique
de
ponction–biopsie
utilisée
(cyto-
ponction,
micro-
ou
macrobiopsie),
le
critère
de
base
pour
la
meilleure
visibilité
de
l’aiguille
sur
l’écran
est
son
alignement
parfait
avec
le
plan
de
coupe
échographique
(Fig.
2).
Il
est
indis-
pensable
de
parvenir
à
cette
visibilité
optimale
de
l’aiguille,
dans
Figure
2.
Technique
de
cytoponction
échoguidée.
1.
Sonde
échogra-
phique
;
2.
masse.
A.
L’inclinaison
de
l’aiguille
dépend
de
la
profondeur
de
la
cible.
B.
Vue
du
dessus
montrant
l’alignement
de
l’aiguille
et
du
plan
de
coupe.
ou
à
travers
la
cible,
pour
n’importe
quelle
technique
de
biopsie
guidée
par
échographie.
En
effet,
si
l’aiguille
est
mal
ou
partiel-
lement
visible
pendant
l’extraction
du
spécimen,
la
biopsie
doit
être
considérée
comme
un
échec,
même
si
l’aiguille
a
ramené
un
spécimen
bénin
à
l’anatomopathologie,
à
cause
du
risque
d’avoir
manqué
la
cible,
même
de
1
ou
2
mm.
Il
est
donc
primordial
pour
l’opérateur
de
certifier
une
image
montrant
l’extrémité
de
l’aiguille
dans
la
lésion
s’il
s’agit
d’une
cytoponction
ou
sa
sec-
tion
à
travers
la
lésion
en
cas
de
micro-
ou
de
macrobiopsie.
Pour
la
cytoponction,
il
est
également
primordial
de
montrer
la
présence
de
l’aiguille
dans
la
cible
pendant
la
totalité
de
l’échantillonnage
et
non
seulement
pendant
une
fraction
de
seconde
avant
que
l’opérateur
n’engage
le
processus
d’échantillonnage.
Dans
ce
der-
nier
cas
en
effet,
il
est
possible
que
l’aiguille
ait
quitté
la
cible
et
que
l’échantillonnage
ait
manqué
la
cible.
Pour
les
microbiopsies,
la
confirmation
minimale
implique
de
prendre
plusieurs
clichés
montrant
la
position
de
l’aiguille
avant,
pendant
et
après
la
biop-
sie [2].
La
technique
idéale
de
contrôle
des
biopsies
échoguidées
est
l’enregistrement
vidéo
qui
était
réalisé
il
y
a
quelques
années
à
l’aide
de
magnétoscopes
et
de
cassettes
vidéo
et
qui
est
aujourd’hui
réalisé
plus
facilement
à
l’aide
des
systèmes
d’enregistrement
digital
(vidéoclip
ou
ciné-loop)
incorporés
dans
la
majorité
des
échographes
actuels.
Depuis
que
la
technique
de
biopsie
à
l’aiguille
échoguidée
est
devenue
un
standard
pour
les
biopsies
de
masses
du
sein,
relativement
peu
de
cours
de
formation
ont
été
développés
en
France.
Il
faut
toutefois
rappeler
que
les
gestes
interventionnels
EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
génito-urinaire
-
gynéco-obstétricale
-
mammaire 3
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/11/2014 par CERIST ALGERIE (353213)

34-800-A-13 Échographie
interventionnelle
du
sein
échoguidés
sont
encore
plus
dépendants
de
l’opérateur
que
ne
l’est
l’échographie
elle-même.
Une
excellente
coordination
œil/main
et
la
capacité
de
naviguer
dans
l’espace
tridimension-
nel
à
partir
d’images
bidimensionnelles
sont
indispensables
pour
obtenir
les
résultats
espérés
avec
la
technique
de
guidage
à
mains
libres.
Les
prédispositions
individuelles
de
chaque
opérateur
doivent
être
développées
par
un
entraînement
et
maintenues
par
une
pratique
soutenue
à
une
fréquence
suffisante
pour
accumu-
ler
l’expérience
nécessaire.
Autrement
dit,
un
nombre
important
de
biopsies
est
requis
pour
acquérir
les
deux
qualités
majeures
indispensables
pour
que
les
gestes
soient
efficaces
et
bien
accep-
tés
par
les
patientes
:
la
précision
et
la
rapidité.
Comme
toute
technique
interventionnelle
ou
chirurgicale,
il
est
important
de
garder
à
l’esprit
qu’il
y
aura
toujours
des
variations
de
compé-
tences
individuelles,
et
qu’une
masse
de
2
cm
de
diamètre
dans
un
gros
sein
en
involution
adipeuse
sera
bien
plus
facile
à
biop-
sier
par
un
débutant
que
la
microbiopsie
d’une
lésion
de
4
mm
située
en
profondeur
dans
un
petit
sein
dense,
qui
ne
devra
être
tentée
que
par
un
opérateur
entraîné.
Cytoponctions
(ponctions
à
l’aiguille
fine)
Pendant
des
décennies,
la
cytoponction
a
été
utilisée
avec
succès
dans
le
diagnostic
des
masses
palpables
du
sein.
La
ponc-
tion
à
l’aiguille
fine
des
masses
non
palpables
du
sein
sous
guidage
échographique
a
été
rapportée
au
milieu
des
années
1980 [6].
Équipement
et
technique
de
réalisation
Nous
utilisons
des
aiguilles
hypodermiques
standards
de
20
gauge
(20G)
et
3,8
cm
de
long
(Becton-Dickinson,
Franklin
Lakes,
New
Jersey).
Une
aiguille
plus
longue
de
5
cm
de
longueur
et
21G
est
utilisée
pour
la
cytoponction
de
lésions
plus
profondes.
Si
un
guide
à
ponction
est
utilisé,
une
aiguille
plus
longue
(aiguille
à
ponction
lombaire)
doit
être
utilisée
pour
compenser
la
longueur
du
trajet
à
travers
le
guide.
La
sonde
est
nettoyée
et
sa
surface
de
contact
immergée
dans
une
solution
d’alcool
isopropylique
à
70
%
pendant
une
minute
avant
l’examen.
Le
consentement
écrit
de
la
patiente
est
obtenu
après
un
interrogatoire
concernant
la
prise
de
médicaments,
notamment
d’anticoagulants,
et
après
que
les
complications
pos-
sibles
du
geste
interventionnel
aient
été
expliquées
en
détail.
Il
s’agit
essentiellement
de
douleur,
d’hématome,
d’infection
et
de
lésion
de
la
prothèse
en
cas
d’implant.
Un
traitement
continu
à
l’aspirine
n’est
pas
une
contre-indication
pour
la
cytoponction.
Une
patiente
sous
anticoagulant
sera
en
général
reconvoquée
après
la
suspension
du
traitement
en
sachant
que
si
l’arrêt
tem-
poraire
de
ce
traitement
est
trop
risqué,
la
cytoponction
ou
la
microbiopsie
seront
réalisées
quand
même
si
les
bénéfices
escomp-
tés
dépassent
les
risques
d’hématome
local.
La
peau
est
nettoyée
avec
de
l’alcool
isopropylique
à
70
%.
L’alcool
sert
à
la
fois
de
désinfectant
et
d’agent
de
couplage
acous-
tique,
de
sorte
qu’il
n’est
pas
nécessaire
d’utiliser
de
gel
stérile.
Il
faut
garder
à
l’esprit
que
la
préparation
décrite
ici
pour
une
cytoponction
est
semi-stérile
et
non
pas
stérile.
En
fonction
de
la
localisation
de
la
tumeur,
la
patiente
sera
pla-
cée
en
décubitus
dorsal
strict
ou
en
position
oblique
de
manière
à
étaler
le
sein
sur
la
paroi
thoracique,
réduisant
ainsi
l’épaisseur
du
sein
et
par
conséquent
la
longueur
du
trajet
de
l’aiguille
de
cyto-
ponction.
Une
anesthésie
locale
n’est
pas
indispensable
avant
une
cytoponction.
Après
le
repérage
de
la
lésion
à
ponctionner,
le
point
d’insertion
de
l’aiguille
est
déterminé
de
manière
à
ce
que,
dans
la
mesure
du
possible,
le
trajet
de
l’aiguille
se
situe
dans
la
graisse
sous-cutanée
plutôt
que
dans
le
tissu
glandulaire,
qui
est
plus
sensible.
Une
fois
que
le
point
d’insertion
a
été
déterminé
et
que
la
position
de
la
sonde
et
celle
de
la
patiente
ont
été
choisies
afin
que
la
trajectoire
de
l’aiguille
soit
la
plus
courte
et
la
position
de
la
patiente
la
plus
confortable,
l’aiguille
est
introduite
avec
un
angle
qui
dépend
de
la
profondeur
de
la
lésion
mais
qui
est
habituellement
compris
entre
45
et
60◦par
rapport
au
faisceau
ultrasonore
(Fig.
2).
Il
est
conseillé
d’introduire
l’aiguille
avec
le
biseau
orienté
vers
la
sonde
car
sa
concavité
le
rend
plus
échogène.
Si
un
guide
à
ponction
est
Figure
3.
Cytoponction.
L’aiguille
montée
sur
la
seringue
est
introduite
à
une
distance
de
0,5
à
1
cm
de
l’extrémité
de
la
sonde
et
alignée
avec
le
plan
de
coupe.
Une
dépression
de
1
ou
2
cm3est
appliquée
de
manière
continue
pendant
le
mouvement
de
l’aiguille
à
l’intérieur
de
la
masse.
utilisé,
la
plupart
des
constructeurs
ont
incorporé
une
ou
deux
lignes
électroniques
sur
le
moniteur
indiquant
la
trajectoire
théo-
rique
de
l’aiguille.
Lorsque
l’extrémité
de
l’aiguille
a
été
identifiée
à
l’intérieur
de
la
lésion,
l’aspiration
peut
commencer.
Un
point
important
de
la
technique
est
l’aspiration
à
l’aide
d’une
seule
main,
tandis
que
l’autre
main
maintient
la
sonde
en
place
pour
le
contrôle
continu
en
temps
réel
de
la
ponction.
Une
alternative
est
de
demander
à
un
assistant
de
réaliser
l’aspiration
en
manipulant
la
seringue
qui
est
reliée
à
l’aiguille
par
une
tubulure.
L’avantage
de
cette
technique
est
que
l’aspiration
par
l’assistant
peut
être
vigoureuse
jusqu’à
20
cm3de
pression
négative.
Dans
notre
expérience,
cette
tech-
nique
n’est
pas
nécessaire
et
une
aspiration
négative
de
1
ou
2
ml
réalisée
en
tirant
sur
le
piston
de
la
seringue
à
l’aide
de
trois
doigts
(le
pouce,
l’index
et
le
médius)
de
la
main
qui
tient
la
seringue
est
suffisante
pour
extraire
assez
de
matériel
d’une
masse
solide
en
20
à
30
secondes,
ce
qui
est
la
durée
habituelle
d’une
cytoponc-
tion
(Fig.
3).
D’autres
systèmes
destinés
à
faciliter
la
technique
d’aspiration
ont
été
décrits.
Le
système
d’aspiration
Cameco
est
encombrant,
déséquilibré
et
n’est
pas
adapté
à
l’aspiration
écho-
guidée
de
petites
lésions.
La
technique
de
prélèvement
à
l’aiguille
fine
sans
aspiration
qui
consiste
à
effectuer
des
mouvements
de
va-et-vient
à
l’intérieur
de
la
masse
en
laissant
le
matériel
cel-
lulaire
monter
dans
l’aiguille
par
capillarité
ne
fonctionne
que
dans
les
tumeurs
à
densité
cellulaire
très
élevée
et
nous
l’avons
abandonnée.
Il
est
important
de
souligner
la
nécessité
d’une
collaboration
étroite
avec
un
cytopathologiste
expérimenté
afin
de
tirer
le
maxi-
mum
d’informations
de
la
cytoponction.
Si
l’équipe
ne
dispose
pas
d’un
tel
spécialiste
il
est
préférable
de
s’abstenir
de
pratiquer
des
cytoponctions,
à
l’exception
peut-être
des
ponctions
de
gan-
glions,
qui
sont
en
général
de
lecture
cytologique
facile.
Aspiration
des
kystes
et
collections
liquidiennes
L’aspiration
de
collections
liquidiennes
est
facile
à
réaliser
avec
une
seule
main
puisque
le
liquide
n’oppose
guère
de
résistance
au
mouvement
du
piston.
L’emploi
de
tube
de
type
Vacutainer®(Becton-Dickinson,
Frank-
lin
Lakes,
New
Jersey)
a
été
décrit
pour
aspirer
facilement
d’une
seule
main
des
collections
liquidiennes,
mais
n’est
pas
utilisé
en
pratique [10].
Les
kystes
ne
sont
aspirés
que
s’ils
sont
symptomatiques
(dou-
loureux
et/ou
palpables)
ou
s’ils
sont
à
l’origine
d’une
anomalie
mammographique
qui
doit
être
clarifiée.
Dans
ce
dernier
cas,
la
corrélation
entre
le
kyste
vu
en
échographie
et
l’anomalie
mam-
mographique
est
confirmée
par
une
pneumokystographie
réalisée
par
l’injection
d’un
volume
d’air
légèrement
inférieur
au
volume
de
liquide
aspiré.
4EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
génito-urinaire
-
gynéco-obstétricale
-
mammaire
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/11/2014 par CERIST ALGERIE (353213)

Échographie
interventionnelle
du
sein 34-800-A-13
Une
alternative
consiste
à
répéter
des
clichés
mammogra-
phiques
après
l’aspiration
pour
confirmer
la
disparition
de
la
densité
en
question.
Si
le
contenu
du
kyste
est
visqueux
ou
très
épais,
l’aspiration
à
l’aide
d’une
aiguille
de
20
ou
21G
peut
se
révéler
impossible
;
dans
ce
cas,
il
faut
avoir
recours
à
une
aiguille
de
18G,
pour
pouvoir
aspirer
en
partie
ou
en
totalité
le
contenu
du
kyste.
La
possibilité
d’un
cancer
de
type
mucineux
qui
peut
lui
aussi
contenir
une
substance
épaisse
très
difficile
à
aspirer
doit
être
gardée
à
l’esprit.
La
ponction–aspiration
échoguidée
permet
de
drainer
la
plu-
part
des
collections
liquidiennes
rencontrées
dans
le
sein,
qu’il
s’agisse
d’hématomes
liquéfiés
ou
d’abcès,
de
collections
postopé-
ratoires,
de
collections
autour
d’un
matériel
prothétique
ou
de
lymphocèles.
Comme
pour
les
kystes
vieillis,
l’aspiration
d’un
abcès
peut
être
rendue
difficile
par
la
viscosité
du
contenu,
et
une
aiguille
de
gros
diamètre
peut
être
nécessaire,
ainsi
que
des
irrigations
au
sérum
physiologique
suivies
d’injections
d’antibiotiques
dans
la
cavité
abcédée.
Les
kystes
huileux
de
cytostéatonécrose
ont
un
aspect
et
une
consistance
caractéristiques.
Ils
peuvent
aussi
être
parfois
difficiles
à
aspirer
avec
une
aiguille
trop
fine.
Lorsque
le
liquide
aspiré
est
placé
dans
le
liquide
fixateur,
il
forme
un
surnageant
qui
confirme
sa
nature
huileuse.
Cytoponction
de
masses
solides
L’échantillonnage
d’une
masse
solide
est
réalisé
à
l’aide
de
mou-
vements
de
va-et-vient
et
de
rotation
de
l’aiguille,
à
la
manière
d’un
tire-bouchon,
afin
de
dissocier
le
tissu
à
biopsier
en
combi-
nant
l’action
mécanique
des
mouvements
du
biseau
de
l’aiguille
avec
l’aspiration
modérée
mais
constante
pendant
tout
le
proces-
sus
de
ponction.
Une
dépression
de
1
ou
2
cm3est
généralement
suffisante
pour
faire
apparaître
dans
l’embout
transparent
de
l’aiguille
un
matériel
plus
ou
moins
hémorragique.
Un
avantage
important
de
la
cytoponction
est
de
pouvoir
mobi-
liser
l’aiguille
au
sein
de
la
lésion
«
en
éventail
»
permettant,
lors
d’un
seul
passage
dans
la
lésion,
d’échantillonner
une
grande
par-
tie
du
volume
de
la
cible.
Cette
technique
n’est
possible
qu’avec
le
guidage
à
mains
libres
puisqu’une
aiguille
prisonnière
du
guide
ne
peut
pas
être
réorientée
dans
différentes
directions.
Dans
la
majorité
des
cas,
une
aspiration
de
30
à
40
secondes
per-
met
d’obtenir
ce
résultat.
La
présence
de
matériel
dans
l’embout
garantit
de
facto
la
présence
de
matériel
dans
toute
la
longueur
de
l’aiguille.
L’aiguille
et
la
seringue
sont
alors
retirées
après
avoir
relâché
l’aspiration.
Si
l’aiguille
est
retirée
alors
que
l’aspiration
est
maintenue,
le
matériel
qui
se
trouve
dans
l’aiguille
sera
pro-
jeté
à
l’intérieur
du
corps
de
la
seringue
d’où
il
sera
plus
difficile
de
l’extraire.
L’aiguille
est
ensuite
désolidarisée
de
la
seringue,
le
piston
tiré
au
maximum,
la
seringue
reconnectée
à
l’aiguille
et
le
piston
repoussé
en
avant
de
manière
à
chasser
le
matériel
hors
de
l’aiguille
sur
une
lame,
où
il
est
étalé
avant
d’être
fixé
selon
les
recommandations
du
laboratoire
de
cytopathologie
et
le
type
de
test
à
effectuer.
Une
cytoponction
correcte
doit
ramener
une
quantité
de
maté-
riel
suffisante
pour
couvrir
trois
ou
quatre
lames.
Pour
certaines
masses
de
très
petite
taille,
une
seule
lame
(si
elle
est
de
bonne
qualité)
peut
suffire
pour
un
diagnostic
cytologique
adéquat.
Si
la
ponction
est
hémorragique
et
que
l’opérateur
peut
couvrir
plus
d’une
dizaine
de
lames,
il
est
probable
que
le
résultat
sera
défavorable,
la
présence
excessive
de
sang
rendant
le
diagnos-
tic
cytopathologique
non
seulement
plus
long
mais
également
plus
difficile.
Les
lames
sont
ensuite
colorées
selon
la
technique
de
Papanicolaou
ou
de
Diff-Quik
pour
une
interprétation
rapide
possible
en
15
minutes.
Cytoponction
des
cancers
du
sein
La
cytoponction
des
cancers
du
sein
est
en
général
relativement
facile.
Elle
fournit
des
frottis
de
haute
cellularité
et
le
diagnostic
est
établi
avec
une
seule
aspiration
dans
la
majorité
des
cas
(Fig.
4).
Toutefois,
certaines
tumeurs
squirrheuses
ou
lobulaires,
qui
sont
composées
en
majorité
de
fibrose
et
de
peu
d’éléments
cellulaires,
sont
difficiles
à
aspirer
et,
dans
ces
cas,
la
microbiopsie
est
plus
performante.
Une
tumeur
primitive
doit
être
systématiquement
Figure
4.
Frottis
cytologique
typique
d’un
adénocarcinome
mammaire.
Figure
5.
Frottis
cytologique
typique
de
fibroadénome.
biopsiée
d’emblée
à
l’aide
d’une
microbiopsie.
Cette
microbiopsie
initiale
a
pour
but
de
déterminer
le
caractère
invasif
de
la
tumeur
ainsi
que
le
statut
des
récepteurs
hormonaux
et
des
autres
biomar-
queurs
et
permet
également
de
stocker
du
matériel
tumoral
au
cas
où
un
nouveau
biomarqueur
serait
développé
dans
les
années
à
venir.
Toutefois,
le
statut
des
récepteurs
hormonaux
d’un
cancer,
les
marqueurs
de
prolifération
et
l’expression
du
gène
Her2-neu
peuvent
aussi
être
évalués
par
cytologie
si
nécessaire,
par
exemple
dans
le
cas
de
récidive
locale
ou
ganglionnaire.
Une
simple
cyto-
ponction
peut
alors
confirmer
la
récidive
du
cancer
connu
en
comparant
les
biomarqueurs
de
la
récidive
avec
ceux
de
la
tumeur
primitive.
D’autres
techniques
immunohistochimiques
sont
disponibles
pour
affiner
le
diagnostic
différentiel,
par
exemple
la
coloration
à
l’e-cadhérine
pour
différencier
un
cancer
canalaire
d’un
cancer
lobulaire.
D’autres
types
de
cancers
du
sein
tels
que
les
cancers
médullaires
ou
mucineux,
les
lymphomes
ou
les
métastases
au
sein
de
can-
cers
primitifs
extramammaires
peuvent
aussi
être
diagnostiqués
correctement
par
une
cytoponction.
Lésions
solides
bénignes
Dans
le
cas
de
lésions
bénignes,
à
condition
de
disposer
d’un
matériel
adéquat
en
quantité
et
en
qualité,
un
cytopathologiste
qualifié
est
capable
non
seulement
d’éliminer
la
présence
de
can-
cer,
mais
également
d’établir
un
certain
nombre
de
diagnostics
définitifs
de
lésions
bénignes,
par
exemple
ceux
de
fibroadénome
(Fig.
5),
de
cytostéatonécrose,
d’adénopathie
intramammaire
bénigne
ou
encore
d’infection
ou
d’inflammation
aiguë.
EMC
-
Radiologie
et
imagerie
médicale
-
génito-urinaire
-
gynéco-obstétricale
-
mammaire 5
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 23/11/2014 par CERIST ALGERIE (353213)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%