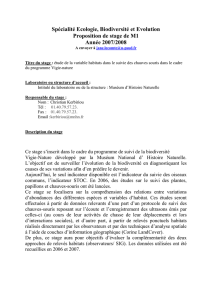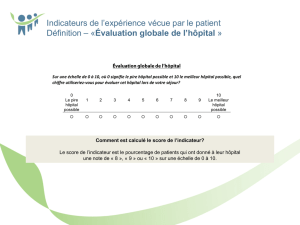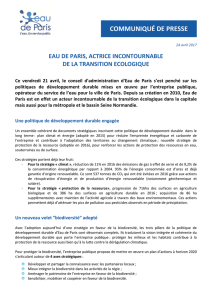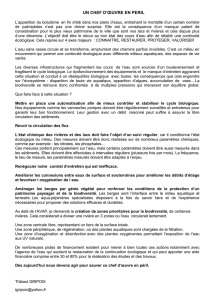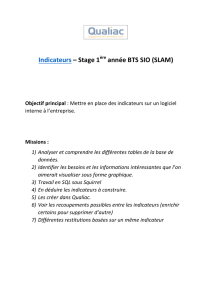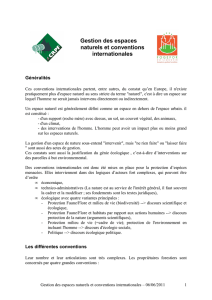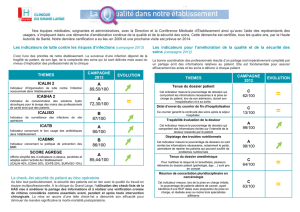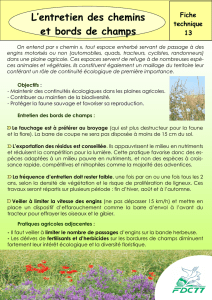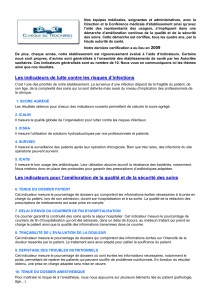Indicateur de vulnérabilité écologique pour projets linéaires
Telechargé par
mary bel

16/02/2018 Un indicateur global d’évaluation de la vulnérabilité écologique du milieu le long de grandes infrastructures linéaires : Pourquoi ? Comme…
http://journals.openedition.org/cybergeo/26362 1/32
Cybergeo : European
Journal of Geography
Aménagement, Urbanisme
2014
680
Un indicateur global d’évaluation
de la vulnérabilité écologique du
milieu le long de grandes
infrastructures linéaires :
Pourquoi ? Comment ?
L’exemple du canal Seine-Nord Europe
A biodiversity intactness index for main linear infrastructure projects. The exemple of the Seine-North Europe
project
É L-P
Résumés
Français English
La prise en compte des milieux naturels et de la biodiversité par les maîtres d’ouvrage des grands
projets d’infrastructures linéaires est une obligation réglementaire. Cette dernière s’avère souvent
ardue en raison des caractéristiques intrinsèques de ce type de projets, mais également d’un
déficit d’outils opérationnels et notamment d’indicateurs permettant d’évaluer la vulnérabilité
écologique des milieux. Cet article contribue à combler ce déficit en proposant une méthodologie
fondée sur la constitution d’une base de données et d’un indicateur, construits à partir de
l’analyse de l’aire d’étude environnementale du projet Seine-Nord-Europe.
According to the legislation, natural habitat and biodiversity has to be considered for main linear
infrastructure projects. Nevertheless, this requirement is often difficult to fulfill due to the
inherent characteristics of these projects and the lack of efficient tools to evaluate ecological
vulnerability. Based on a database setup and a dedicated monitoring index development for the
areas affected by the Seine-North Europe project, this study puts forward a process which could
reduce t his deficiency.

16/02/2018 Un indicateur global d’évaluation de la vulnérabilité écologique du milieu le long de grandes infrastructures linéaires : Pourquoi ? Comme…
http://journals.openedition.org/cybergeo/26362 2/32
Entrées d’index
Mots-clés : acteurs de l’aménagement, aide à la décision en aménagement, biodiversité, enjeux
environnementaux, évaluation environnementale, indicateurs de développement durable,
indicateur de biodiversité, protection/conservation de la nature, vulnérabilité écologique, zonage
Keywords : land settlement operator, planning decision-making tools, biodiversity,
environmental issues, environmental assessment, sustainable indicator, biodiversity indicator,
environmental conservation, ecological vulnerability, zoning
Texte intégral
Je remercie Matthieu Plantier pour avoir mis à mon service ses compétences
mathématiques et toute sa rigueur scientifique sans lesquelles l’élaboration de cet
indicateur aurait été bien plus laborieuse ! Je remercie également Hélène Chelzen,
Anne Jégou et Pierre Pech pour leurs relectures attentives et leurs remarques d’une
grande justesse qui m’ont permis de faire évoluer cet article et de l’enrichir. Je remercie
également Messieurs Matthieu Kowalski, Jérôme Rayrole, Vincent Hamonet et
Grégoire Goettelman du service PPP-Concessions de Bouygues Construction pour leurs
remarques pertinentes et leurs critiques constructives sur l’indicateur qui ont contribué
à son perfectionnement. Enfin, je remercie la Chaire BEGI de l’Université Paris I et le
Groupe Eiffage qui ont financé mes recherches. Dans un tout autre registre, je remercie
l’équipe des cascadeuses de la crèche du Petit Prince, Alison, Stéphanie, Sarah et Élodie
et leur direction de choc, Laure et Frédérique, sans oublier Mireille et Cécile, pour
m’avoir permis de concilier maternité et poursuite de mes activités de recherche.
Introduction
L’objectif de cet article est de mettre en évidence l’existence de besoins émergents
d’indicateurs de biodiversité, entrant dans la catégorie des indicateurs de
développement durable, au titre de leur intégration aux projets d’aménagement
durable. Il s’agit également d’apporter une contribution, afin de remédier à ce déficit,
en proposant un indicateur opérationnel global permettant d’évaluer la vulnérabilité
écologique des milieux le long de grandes infrastructures linéaires.
1
L’indicateur présenté dans cet article a été conçu dans le cadre d’une recherche
doctorale de géographie. Elle aborde les difficultés nouvelles auxquelles sont
actuellement confrontés les aménageurs de grands projets d’infrastructures linéaires
pour prendre en compte les enjeux environnementaux qui s’imposent à eux,
notamment en termes de préservation des milieux naturels et de la biodiversité, à
différentes échelles, et à faire aboutir leurs projets dans de bonnes conditions.
2
Jusqu’à une période récente, ces enjeux constituaient une préoccupation très
secondaire des maîtres d’ouvrage de ces grands projets et s’apparentaient à une simple
prise en compte, de nature formelle, destinée à répondre à des obligations
réglementaires telles que l’étude d’impact. En effet, ces obligations réglementaires ne
donnaient que rarement lieu, en amont, à un examen minutieux et systématique par
l’autorité administrative en charge d’autoriser la réalisation d’un projet, des
propositions faites par les maîtres d’ouvrage pour s’y conformer. Dans le cas de l’étude
d’impact, cette autorité n’avait que le pouvoir de la valider ou de demander des
compléments d’informations mais en aucun cas de formuler des injonctions nécessitant
une révision de fond du projet et des mesures envisagées. De même, en aval, les
vérifications sur le terrain et les sanctions, en cas de manquements aux engagements
pris, étaient rares et concernaient uniquement des projets relevant de législations
spécifiques telles que la loi sur l’eau ou la loi sur les installations classées, dotées toutes
deux de polices administratives dédiées exerçant des missions de contrôle et disposant
d’un arsenal de sanctions administratives. Dès lors, la principale menace à laquelle
s’exposaient les maîtres d’ouvrage de grands projets d’infrastructures linéaires, en cas
3

16/02/2018 Un indicateur global d’évaluation de la vulnérabilité écologique du milieu le long de grandes infrastructures linéaires : Pourquoi ? Comme…
http://journals.openedition.org/cybergeo/26362 3/32
d’atteintes importantes de leur projet aux milieux naturels liées à une mauvaise prise en
compte des enjeux environnementaux, consistait en des recours et des poursuites
engagés par des associations de protection de l’environnement qui intervenaient en aval
des projets.
Désormais, cette époque est révolue et les préoccupations environnementales sont en
passe de devenir une des préoccupations de tout premier ordre des maîtres d’ouvrage
de grands projets d’infrastructures linéaires. Deux mutations intervenues de manière
concomitante sont à l’origine de cette révolution : d’une part, l’évolution profonde des
modalités de la commande publique liée à l’apparition et à la généralisation de deux
nouveaux types de contrats, les concessions et les contrats de partenariat public-privé,
et d’autre part les évolutions législatives et des pratiques induites par le Grenelle de
l’environnement.
4
En effet, les contrats de partenariat public-privé, CPPP, sont une forme dérogatoire
de la commande publique introduite dans le droit français en 2004 par l’ordonnance
n° 2004-559 en date du 17 juin. Il s’agit de « contrats globaux » (Besson, 2008 ;
Ministère de l’économie, des finances, de l’industrie, 2011), c’est-à-dire de contrats dans
lesquels un opérateur privé se voit confier une mission globale de financement
conjointement avec le maître d’ouvrage public, de construction, d’exploitation et
d’entretien d’infrastructures destinées à une mission de service public. Il peut
également contenir, de manière facultative, tout ou partie de la conception de l’ouvrage
ou d’autres prestations relevant généralement de la compétence de l’opérateur public
(Ministère de l’économie, des finances, de l’industrie, 2011). Ce type de contrat est
destiné à des infrastructures dont l’exploitation ne fait pas l’objet d’un paiement direct
de la part des usagers et dont la rentabilité n’est pas assurée. Les concessions ont été
instituées, en France, dans leur forme contemporaine, par l’ordonnance du n° 2001-273
du 28 mars 2001. Il s’agit de contrats très similaires aux CPPP mais destinés à des
infrastructures présentant une rentabilité assurée par l’existence d’un système de
péage. Ces contrats peuvent donc s’apparenter à une forme de délégation de la maîtrise
d’ouvrage de grands projets d’aménagement du public vers le privé.
5
Or, dans le même temps, le Grenelle de l’environnement a conduit à un durcissement
de la législation française en matière de protection de l’environnement qui s’est
notamment traduit par une réforme de fond des études d’impact. La réforme de cet
instrument, initiée par les articles 230 et 231 de la loi Grenelle II n° 2010-788 du
12 juillet 2010, s’est concrétisée avec la promulgation du décret n° 2011-2019 du
29 décembre 2011 entré en application le 1er juin 2012. Parmi les modifications
introduites par ce texte, deux retiennent particulièrement l’attention des
professionnels. La première modification consiste en l’apparition d’une procédure
d’examen au cas par cas pour certaines catégories de projets pour lesquelles il revient
au maître d’ouvrage de prouver qu’une étude d’impact n’est pas nécessaire. Cette
procédure vient s’ajouter à la liste des projets nécessairement soumis à étude d’impact.
Cette mesure devrait selon certains professionnels conduire à une augmentation du
nombre d’études d’impact en raison du risque important de contestations et de recours
contre lequel les maîtres d’ouvrage chercheront à se prémunir en choisissant de
produire de manière volontaire une étude d’impact (Lémeri, 2010). La seconde
modification consiste en la création d’une police administrative de l’environnement
compétente pour contrôler l’effectivité des mesures prescrites par les études d’impact et
dotée d’un dispositif de sanctions.
6
D’autre part, le Grenelle de l’environnement a également conduit à une évolution des
pratiques des autorités en charge de délivrer les autorisations. En effet, ces autorités
ont désormais tendance à suivre les recommandations délivrées par les instances
consultatives officielles spécialisées dans les questions relatives à la préservation de
l’environnement, et tout particulièrement par le Conseil national de protection de la
nature (CNPN). Ce dernier est en charge d’émettre un avis sur les demandes de
dérogations relatives aux espèces animales ou végétales protégées pour les grands
projets d’aménagement. De ce fait, depuis le Grenelle de l’environnement, des
entreprises privées assurant des missions de maîtrise d’ouvrage de grands projets
d’aménagement à travers des concessions et des contrats de partenariat public-privé
doivent faire face à des situations de blocage, sans cesse plus nombreuses, de leurs
7

16/02/2018 Un indicateur global d’évaluation de la vulnérabilité écologique du milieu le long de grandes infrastructures linéaires : Pourquoi ? Comme…
http://journals.openedition.org/cybergeo/26362 4/32
projets. Ces blocages interviennent juste avant que les projets n’entrent véritablement
dans leur phase opérationnelle, c’est-à-dire juste avant que les premiers travaux de
construction ne débutent. Ils résultent des avis négatifs rendus par le CNPN ou des
autorisations assorties d’une réévaluation à la hausse, très conséquente, des mesures de
compensation pour la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Ces
décisions sanctionnent les carences des études d’impact de l’avant-Grenelle. Face à
cette situation nouvelle, de plus en plus de procédures d’attribution de contrats de
partenariat public-privé ne parviennent pas à aboutir et restent bloquées au stade de la
phase de dialogue compétitif : les entreprises privées soucieuses de ne pas encourir de
risques financiers et de réputation exigent des garanties et posent des conditions de
plus en plus nombreuses aux maîtres d’ouvrage publics qui peinent à les satisfaire.
Enfin, ces évolutions initiées par le Grenelle de l’environnement viennent confirmer et
prendre acte de l’affirmation de nouvelles attentes sociales en matière de préservation
de l’environnement dont les entreprises ont pris conscience et qu’elles souhaitent
valoriser au travers de la Responsabilité sociale de l’entreprise. Ce concept né dans les
années 1950 peut être défini comme « l’ensemble des obligations légales ou volontaires,
qu’une entreprise doit assumer afin de passer pour un modèle imitable de bonne
citoyenneté dans un milieu donné » (Pasquero, 2005). Il conduit un nombre croissant
d’entreprises à s’engager dans des domaines et des activités qui excèdent leurs champs
d’action et leurs responsabilités économiques traditionnels, notamment dans le
domaine de la protection de l’environnement. L’objectif est double : il s’agit d’une part
de s’intéresser à la protection de l’environnement autrement qu’en termes de
contraintes, en dépassant la biodiversité « réglementaire » (Vandevelde, 2013) afin de
valoriser leur image, et d’autre part de mettre en place des pratiques durables
susceptibles de constituer à l’avenir « un levier de prévention et de maîtrise des
risques » (Eiffage, 2012).
Dans ce contexte de transition, les objectifs poursuivis par cet indicateur sont donc
pluriels. Si de manière théorique, cet outil a été pensé comme un indicateur
opérationnel global permettant d’évaluer la vulnérabilité écologique du milieu le long
de toutes les grandes infrastructures linéaires et destiné aux aménageurs, il s’adresse
dans la pratique à divers acteurs pour lesquels le rôle qu’il est susceptible de jouer n’est
pas le même. Dans un premier temps, il s’agit d’un outil destiné essentiellement aux
entreprises privées, qui sont engagées dans une procédure de « dialogue compétitif » ou
qui ont fait l’objet d’une délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre de concessions
ou de contrats de partenariat public-privé. Dans le premier cas, l’indicateur constitue
un outil d’aide à la décision qui doit permettre aux entreprises candidates à l’appel
d’offre de juger de la qualité de l’étude d’impact afin de savoir si elles maintiennent leur
candidature. Si elles choisissent de le faire mais que l’indicateur a permis de mettre en
évidence des lacunes de l’étude d’impact, ce dernier peut alors constituer un outil d’aide
à la négociation avec le maître d’ouvrage public porteur du projet afin, par exemple, de
revoir à la hausse sa participation financière.
8
Dans le second cas, l’indicateur doit leur permettre de repérer les zones les plus
problématiques que l’étude d’impact aurait négligées et pour lesquelles le lancement
d’études complémentaires s’avère nécessaire pour proposer de nouvelles mesures de
suppression, de réduction ou de compensation d’impacts. Dès lors, cet indicateur
pourrait aider les entreprises à rendre les projets qu’elles portent « grenello-
compatibles » (David et Lémeri, 2009 ; Francqueville, 2011) en comblant les lacunes
des études d’impact dont elles ont hérité, si possible en amont des demandes
d’autorisations et notamment de l’examen du CNPN, afin d’éviter les risques
opérationnels et de réputation que représente un avis défavorable.
9
À plus long terme, cet indicateur pourrait intéresser les bureaux d’études qui
élaborent les études d’impact de grands projets d’aménagement pour le compte de
maîtres d’ouvrage publics ou les maîtres d’ouvrage publics qui souhaitent vérifier le
travail de ces bureaux d’études. Cet outil pourrait alors s’imposer comme un outil d’aide
à la décision dans le choix du tracé. En effet, la biodiversité constitue un des critères de
l’évaluation environnementale les plus difficiles à appréhender en raison du manque
d’outils destinés à hiérarchiser les enjeux (Vandevelde, 2013). Une fois le tracé choisi, il
pourrait être utilisé comme un outil d’identification des zones les plus vulnérables pour
10

16/02/2018 Un indicateur global d’évaluation de la vulnérabilité écologique du milieu le long de grandes infrastructures linéaires : Pourquoi ? Comme…
http://journals.openedition.org/cybergeo/26362 5/32
lesquelles il convient de lancer des études poussées pour éliminer, réduire ou
compenser les impacts, afin de se conformer aux obligations règlementaires dans des
conditions acceptables de moyens techniques et financiers.
Cet indicateur est donc un outil ambivalent. D’une part, il cherche à évaluer la
vulnérabilité écologique des milieux naturels face à de grands projets d’infrastructures
linéaires perçus comme des risques potentiels pour la biodiversité. À l’inverse, en tant
qu’outil conçu à destination des aménageurs, dans un contexte de durcissement des
exigences sociétales et réglementaires en matière de protection de l’environnement, il
contribue à penser la biodiversité comme un risque à la fois opérationnel, financier,
juridique et de réputation pour ces projets (Vandevelde, 2013).
11
Cet outil s’inscrit donc avant tout dans une « logique instrumentale » dans la mesure
où l’évaluation qu’il propose tend à sécuriser les objectifs des maîtres d’ouvrage de
grands projets d’infrastructures linéaires. Cependant, en tant qu’outil scientifique,
conçu dans le cadre d’une recherche-action menée à la faveur d’un doctorat, il relève
également d’une intentionnalité normative puisqu’il a été initialement conçu comme un
outil dont le but en soi consistait à délivrer une évaluation scientifique opérante. Enfin
il relève aussi d’une intentionnalité substantive car il est susceptible de participer, sur le
long terme, d’une meilleure prise de décision des aménageurs en matière
environnementale (Fiorino, 1989 ; Stirling, 2006 ; Vandevelde, 2013).
12
Le projet Seine-Nord Europe, qui a servi de fondement à l’élaboration de cet
indicateur, constitue un parfait exemple de cette évolution. En effet, ce grand projet
d’infrastructure linéaire est un grand projet d’aménagement de transition. Tout
d’abord, il s’agit d’un projet porté par un maître d’ouvrage public, Voies navigables de
France (VNF), dont l’étude d’impact, réalisée par des bureaux d’études pour le compte
de ce maître d’ouvrage, date de 2006. Il s’agit donc d’une étude d’impact de l’avant-
Grenelle. D’autre part, ce grand projet d’aménagement devait initialement être réalisé
dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé. Une partie de sa conception, sa
construction et sa gestion auraient été déléguées à une entreprise privée. La procédure
de dialogue compétitif, pour laquelle deux candidatures ont été retenues, celle de
l’entreprise Bouygues Construction et celle d’un groupement issu d’un partenariat entre
les entreprises Vinci et Eiffage, aurait dû aboutir à la désignation d’un maître d’ouvrage
délégué en 2011. Cependant, la procédure a récemment été abandonnée en raison
d’incertitudes concernant le bouclage financier de l’opération, qui résultent notamment
des carences de l’étude d’impact et des études de faisabilité financière.
13
Dans le cadre du travail de thèse qui l’a vu naître, l’élaboration de cet indicateur est
intervenue après celle d’une base de données destinée à offrir une meilleure
connaissance de l’aire d’étude environnementale du projet. Initialement, cet outil était
simplement conçu pour permettre un repérage scientifique, c’est-à-dire résultant d’une
analyse et garant d’une forme d’objectivité, des zones écologiquement les plus
vulnérables comprises dans l’aire d’étude environnementale du projet Seine-Nord
Europe. Il s’agissait donc avant tout de construire un indicateur synthétique d’avant-
projet fondé sur la base de données du projet Seine-Nord Europe et destiné à mettre en
évidence de manière efficace les zones comprises dans l’aire d’étude environnementale
du projet, les plus susceptibles d’être impactées par l’infrastructure, pour lesquelles il
existe de forts enjeux de préservation de la biodiversité.
14
En dépit de l’élargissement des objectifs initiaux, cet indicateur est donc pour
l’instant un simple outil théorique construit dans le cadre d’un travail de recherche,
mais qui pourrait être amené à servir d’outil de réflexion aux maîtres d’ouvrage de
grands projets d’infrastructures linéaires en cette période d’incertitudes.
15
Dans cet article, nous dresserons tout d’abord un état de l’art des principaux types
d’indices et d’indicateurs de biodiversité existants. Nous nous attacherons à la
chronologie de leur émergence afin de mettre en évidence le changement de paradigme
qui a présidé à leur évolution. Nous montrerons ensuite qu’il existe des besoins
d’indicateurs de développement durable dans le domaine de l’aménagement. Nous
présenterons brièvement le projet Seine-Nord Europe sur lequel nous nous sommes
appuyés pour concevoir notre indicateur. Enfin, nous présenterons notre indicateur de
développement durable en nous attachant à mettre en évidence la méthode qui a
16
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%