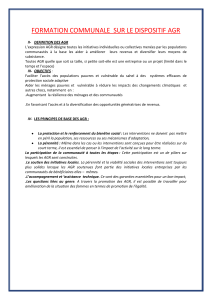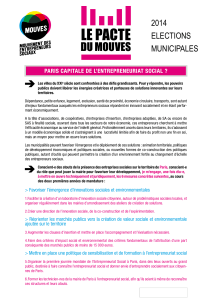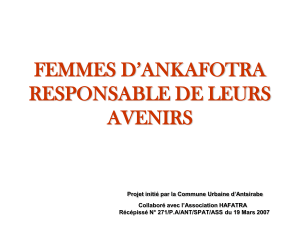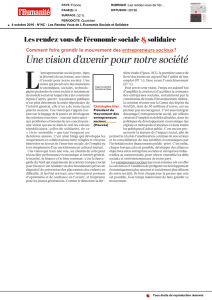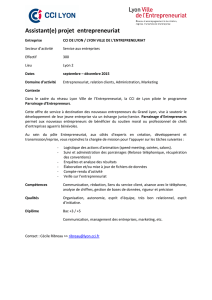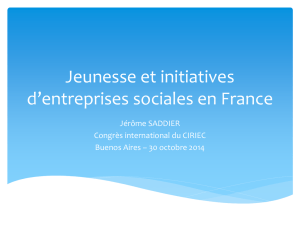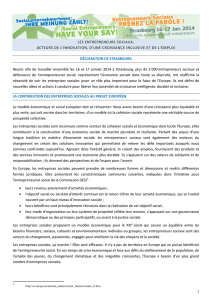Entrepreneuriat socio-économique et développement durable au Maroc
Telechargé par
imanedonc

Etude de la contribution de l’entrepreneuriat socio-
économique au développement durable au Maroc : cas de
l’expérience des Actions Génératrices des Revenus
Khalid BOURMA
Université Ibn Zohr
Agadir, Maroc
Abdelkbir ELOUIDANI
Université Ibn Zohr
Agadir, Maroc
Amina TOURABI
Université Ibn Zohr
Agadir, Maroc
Abstract
The socioeconomic Entrepreneurship major purpose for the promotion of social change and aims to question the
rules of the social economy, by offering innovative solutions that should meet social and economic needs of
increasingly detailed and demanding.
It is in this sense that this exploratory study attempts initially to identify key issues, underlying mechanisms and
prospects for the emergence of socio-economic entrepreneurship in Morocco. Secondly , we will highlight the
significant results of an investigation conducted in the Souss -Massa region in 2013, with a sample to be
representative associations to performing status or cooperatives that were erected in 'Actions income generating
"( AGR ), especially under the leadership of INDH.
Key Words:
socio- economic entrepreneurship, AGR, cooperatives, incentives for the creation / promotion of
SMEs
Résumé
L’entrepreneuriat socio-économique a pour finalité majeure la promotion du changement social et vise à remettre en
cause les règles du jeu de l’économie sociale et solidaire, en proposant des solutions innovantes qui devrait satisfaire
des besoins sociaux et économiques de plus en plus amples et exigeants.
C’est dans ce sens que cette étude exploratoire tente dans un premier temps d’identifier les principaux enjeux,
perspectives et mécanismes sous-jacents à l’émergence de l’entrepreneuriat socio-économique au Maroc. Dans un
second temps, nous mettrons en évidence les résultats significatifs d’une investigation menée, dans la Région du
Souss-Massa en 2013, auprès d’un échantillon censé être représentatif des associations à caractère productif ou
coopératives qui ont été érigées en « Actions Génératrices de Revenus » (AGR), notamment, sous l’impulsion de
l’INDH.
Mots clés :
L’entrepreneuriat socio-économique, AGR,
coopératives, incitations à la
création/promotion des ¨PME
Introduction
L’objet majeur de cet article s’articule autour des nouvelles formes d’organisation qui sont
apparues pour répondre aux nouveaux besoins et enjeux sociaux, les types d’activités dans
lesquelles ces organisations s’investissent, leur emplacements et des défis d’entreprendre en
coopérative et association, à caractère productif. Cette étude traite, en particulier, l’expérience

99
marocaine en matière des Actions Génératrices de Revenus (AGR) qui ont été initiées et
développées au Maroc, en l’occurrence, par l’Initiative Nationale du Développement Humain
(INDH) depuis 2005.
En effet, l’entrepreneuriat social a pour finalité majeure la promotion du changement social et
vise à remettre en cause les règles du jeu de l’économie sociale et solidaire, en proposant
des solutions innovantes qui devrait satisfaire des besoins sociaux de plus en plus pressant et
exigeants. Les combinaisons de ressources apportées par les entrepreneurs sociaux tendent à
privilégier l’impact social par rapport au profit. Aussi, l’émergence de l’Entrepreneur
Social(ES) est étroitement liée à l’idée que les individus sont multidimensionnels. Ils sont
plus que des acteurs économiques qui maximisent le profit. L’émergence de l’ES est porteuse
de multiples promesses.
En fait, les paramètres de mesure adoptés pour la performance et les facteurs clés du succès
entrepreneuriaux se concentrent principalement sur les resultants financiers et commerciaux
d'une entreprise et sa capacité à survivre seule. En règle générale, ces mesures de résultats des
entreprises correspondent aux revenus, la rentabilité, les ventes, et le profit.
C’est dans ce sens que cette étude exploratoire tente dans un premier temps d’identifier les
principaux enjeux, perspectives et mécanismes sous-jacents à l’émergence de
l’entrepreneuriat social au Maroc. Dans un second temps, nous mettrons en évidence les
résultats significatifs d’une investigation menée, dans la Région du Souss- Massa en 2013,
auprès d’un échantillon censé être représentatif des associations à caractère productif ou
coopératives qui ont été érigés en « Actions Génératrices de Revenus » (AGR), notamment,
sous l’impulsion de l’INDH.
1. L’entrepreneuriat social orienté vers le développement durable : cadre
théorique
Ce cadre théorique a pour objectif de montrer dans quelle mesure l’entrepreneuriat social
pourrait contribuer pleinement à répondre aux défis soulevés par le développement durable,
passage obligé pour la promotion d’un changement social et la satisfaction des besoins
sociaux.
1.1. Tentative de définition de l’entrepreneuriat social
L’entrepreneuriat social souffre d’être encore mal connu, mal défini. Il n’a aucun cadre
conceptuel reconnu, car il est par excellence un concept en pleine émergence
1
. Cependant,
une multitude de définitions existe
2
, il en sort un consensus sur la multidimensionalité du
concept et sur la présence d’une double allégeance
3
. En effet, il s’agit d’un concept présentant
un double volet : entrepreneuriat et social
4
.
La première composante du concept est : l’entrepreneuriat. Lorsqu’il est question
d’entrepreneuriat, il fait référence au démarrage de toute entreprise. Il y a également la
création de valeur pour les entrepreneurs. L’entrepreneur utilise l’innovation pour saisir des
occasions d’affaires. Enfin, il y a une mobilisation de ressources pour atteindre les objectifs
visés.
La deuxième composante du concept est : social. Ce mot constitue l’élément central du
concept, puisqu’il précise la mission principale de tout entrepreneuriat, celui-ci doit
nécessairement participer au bien-être de tout un chacun. En fait, sans cette mission, il n’y a
1
Peredo et Mc Lean, 2006
2
Zhara, Gadajlovic, Neubaum et Shulman, 2006
3
Peredo et Mc Lean, 2006; Sullivan Mort, Weerawardena et Carnegie, 23e Colloque annuel du Conseil canadien
des PME et de l’entrepreneuriat, Trois-Rivières, 2006 23rd Annual Conférence of the Canadian Council for
Small Business & Entrepreneurship, Trois-Rivières, 2006 3 2003.
4
Mair et Marti, 2006

100
vraisemblablement pas d’entrepreneuriat social. La mission sociale peut être combinée à une
mission économique. L’organisation sociale joue un rôle d’agent de changement. Ce rôle est
un rôle conscient et non seulement accidentel. La responsabilisation de l’organisation face
aux différents détenteurs d’enjeux est donc omniprésente.
Après avoir tenté de faire une synthèse, l’entrepreneuriat social peut alors se définir comme
les “processus liés à la découverte d’occasions afin de créer de la richesse sociale et les
processus organisationnels développés et utilisés pour atteindre les fins désirés”.
1.2. Le développement durable
Le concept de l’entreprenariat social est considéré par excellence comme prometteur dans
l’atteinte d’objectifs sociaux et de développement économique local. Encore faut il qu’il soit
orienté vers les activités prioritaires comme les coopératives, les associations à caractère
productif, ou vers toute autre activité génératrice de revenus. Les études théoriques qui ont été
faites, soulignent clairement que compte tenu de son émergence, le support aux entrepreneurs
sociaux ne fait pas encore totalement partie des programmes existants afin d’aider ce type
d’entrepreneurs. Il y a donc lieu pour les décideurs institutionnels d’ajouter ce type
d’entrepreneurs dans la liste des entrepreneurs à aider tout en portant une attention particulière
à la spécificité qui leur est propre. La formation en entrepreneuriat social est quasi inexistante
dans la majorité des pays développés, encore moins dans les pays en développement. Il existe
cependant certains programmes de formation continue abordant ce type d’entrepreneuriat. Il y
a lieu de développer l’entrepreneuriat social dans les universités. À titre d’universitaire, les
occasions de recherche dans le domaine sont nombreuses et diversifiées, le champ étant peu
exploité, l’objectif étant d’abord de permettre la compréhension du concept de l’entreprenariat
social et ses impacts dans la société, et puis de ne pas se laisser dépasser par le reste du
monde.
La notion de développement durable est au cœur des préoccupations actuelles et suscite un
véritable engouement aussi bien auprès des chercheurs, que des praticiens et des pouvoirs
publics. Ces derniers sont convaincus que pour arriver au développement durable, il va falloir
lutter contre la pauvreté. Cette lutte ne doit pas se réduire à fournir des services sociaux aux
populations (pistes, eau potable, foyers de jeunes filles, dispensaires,...).
Si ces prestations contribuent à soulager certains maux tels que l’enclavement, la déperdition
scolaire, les problèmes de santé, ils ne peuvent, par contre, assurer un développement durable
et auto-entretenu. Dans ce domaine, les pouvoirs publics veulent adopter, parallèlement à
l’approche sociale, une approche économique en vue de libérer le potentiel des populations.
Par cette approche, ils visent à stimuler des activités susceptibles de créer des richesses et
susciter des effets d’entraînement. Le développement d’activités économiques génératrices de
revenus (AGR) est reconnu comme étant la clé de la relance des zones rurales et urbaines de
tout pays.
D’une part, ces activités permettent de déclencher un dynamisme et un processus de
développement au niveau des localités, d’autre part elles sont un moyen de stimulation de la
motivation et de l’intégration de la population dans les projets de développement. En effet, la
mise en œuvre des actions génératrices de revenus et créatrices d’emplois permet une
adhésion de la population au projet et une implication dans sa réussite. En d’autres termes, la
flexibilité et les modalités de réalisation des AGR permettent de gagner la confiance et
l’adhésion de la population. D’une manière globale l’objectif des AGR est l’amélioration des
conditions de vie socio- économiques des populations. En partant du postulat que les
populations vulnérables prennent ces initiatives de développement, elles vont contribuer à
l’émergence d’une société civile responsable et dynamique capable de définir et de formuler
ses propres orientations et d’utiliser les dispositifs institutionnels existant comme les
communes , les municipalités, les services techniques et les ONG. En l’occurrence, la finalité

101
de toute AGR est le développement local durable économique et social de la population. Ce
développement peut se faire à travers : La constitution des « groupes organisés et/ou groupe
d’intérêts » susceptibles et capables de mettre en place et de gérer collectivement une activité
génératrice de revenus ; La valorisation des ressources économiques à travers la production, la
transformation et la commercialisation des produits (agriculture, élevage, artisanat,
services…) ; Le renforcement des capacités de gestion et d’organisation collective des
groupes concernés à travers le processus de gestion du projet.
Notre objectif ici consiste à mettre en relief la contribution effective d’un phénomène assez
répandu, l’entrepreneuriat social, dédié au service des problématiques socio-économiques
actuelles. Œuvrant pour remédier aux externalités négatives du progrès et de la
mondialisation, l’entrepreneuriat social concourt activement au développement durable, par le
biais de modèles d’activités développés afin de satisfaire des besoins sociaux non encore
explorés par l’Etat et le marché. Compte tenu de la jeunesse des investigations et du champ
d’application en matière d’entrepreneuriat social, il serait judicieux de partir d’une synthèse
de la littérature autour de ce concept afin de mieux l’éclairer, l’appréhender et cerner ses
différentes perspectives théoriques.
2. Enjeux, perspectives et mécanismes associés à l'entrepreneuriat social au
Maroc
2.1. Apparition et développement de l'entrepreneuriat social au Maroc
Depuis son indépendance, le Maroc a vu émerger progressivement, une classe d’hommes
d’affaires qui ont investi dans des secteurs producteurs de richesse tels que le textile,
l’agroalimentaire, l’industrie légère. Toutefois, ces secteurs n’ont pas pu constituer les
fondements d’une économie bien structurée et susceptible de créer la richesse et engager le
pays dans un processus du développement économique et social pérennisé et évolutif.
Cet état de fait est dû essentiellement, entre autre, à la mentalité profonde et dominante du
commerçant marocain, qui se veut prudent et privilégiant une économie de rente sans prise de
risque consistante. Cette situation a perduré, en fait, jusqu’à 1990, date à laquelle des
réformes structurelles ont été instaurées et ont été à l’origine de la croissance économique
relative qu’à connu le Maroc jusqu’à nos jours .Ces réformes ont conduit à des évolutions,
certes fluctuantes mais certaines, qui ont impulsé une réelle dynamique entrepreneuriale.
Cette dynamique a favorisé la genèse et le développement d’un certain nombre de mutations
au niveau de la nouvelle génération d’entreprises et d’entrepreneurs. Au Maroc aujourd’hui,
l’Etat soutient davantage des projets d’innovation au sens institutionnel et administratif afin
de promouvoir et de développer la culture entrepreneuriale.
Dans ce cadre, des types d’entrepreneuriat sont apparus et sont devenus, de plus en plus,
émergents au Maroc. Il s’agit essentiellement et respectivement, des types:
- coopératif et associatif lié à la production ;
- solidaire et activité génératrices de revenus.
2.2. Profil de l’entrepreneur et traits distinctifs de l’entreprenariat social
au Maroc
D’après l’état de l’art de référence, la tendance actuelle des pratiques de l’entrepreneuriat
social au Maroc se caractérise par : les spécificités suivantes :
- adhésion progressive au risque économique et à l’autonomie dans les activités liées à la
production de biens et/ou à la vente.
-Recherche de nouvelles opportunités d’affaires et d’explorations de resources;
- engagement constant dans l’innovation, l’adaptation et la formation ;

102
- pouvoir de décision qui n’est pas nécessairement fondé sur la propriété du capital;
- distribution limitée des profits et quantité minimale du travail rémunéré.
Dans le même sens, le profil tendanciel de l’entrepreneur « marocain » converge vers la
configuration suivante :
- son expérience est limitée au domaine où il entend exercer son activité ;
- le capital nécessaire au démarrage de son affaire porte souvent et principalement sur une
ressource familiale ;
- la création de son entreprise est, principalement, liée à la recherche de l’indépendance et de
la liberté d’action.
- il est en phase avec les grands choix stratégique du Maroc d’aujourd’hui.
Par ailleurs, l’entrepreneuriat social a pour but majeur la promotion du changement social et
vise à remettre en cause les règles du jeu en apportant des propositions innovantes qui
devraient répondre plus favorablement aux besoins sociaux. Aussi, les combinaisons de
ressources créées par les entrepreneurs sociaux privilégient l’impact social par rapport au
profit. L’émergence de l’Entrepreneur Social (ES) est étroitement liée à la conviction que les
individus sont multidimensionnels. Ils sont plus que des acteurs économiques qui maximisent
le profit.
En fait, les paramètres de mesure adoptés pour la performance et les facteurs clés du succès
entrepreneuriaux se concentrent principalement sur les résultats financiers d'une entreprise en
termes de revenus, de rentabilité, des ventes, et des marges commerciales.
En outre, il est bien admis que dans les secteurs à but lucratif, la valeur est mesurée ou définie
principalement en termes financiers et le retour sur investissement (RSI) demeure l'indicateur
le plus sollicité dans ce domaine.
PROFIL TENDANCIEL DE L’ENTREPRENEUR MAROCAIN
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%