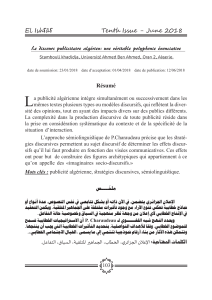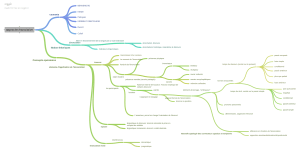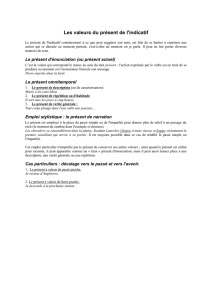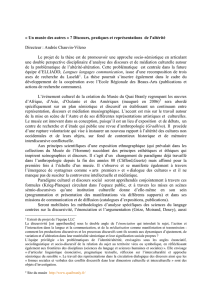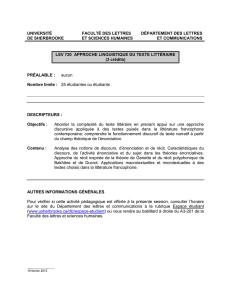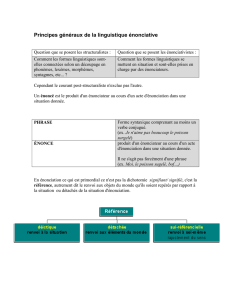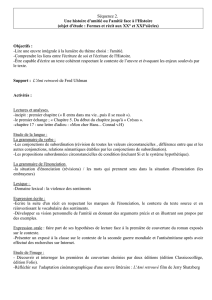Discours publicitaire algérien : analyse sémiolinguistique
Telechargé par
Khadidja Stambouli

ʕãʕ2018
103
Le discours publicitaire algérien: une véritable polyphonie énonciative
Stambouli khadidja, Université Ahmed Ben Ahmed, Oran 2, Algerie.
date de soumission: 23/01/2018 date d’acceptation: 01/04/2018 date de publication: 12/06/2018
Résumé
La publicité algérienne intègre simultanément ou successivement dans les
mêmes textes plusieurs types ou modèles discursifs, qui reètent la diver-
sité des opinions, tout en ayant des impacts divers sur des publics diérents.
La complexité dans la production discursive de toute publicité réside dans
la prise en considération syématique du contexte et de la spécicité de la
situation d’interaction.
L’approche sémiolinguiique de P.Charaudeau précise que les raté-
gies discursives permettent au sujet discursif de déterminer les eets discur-
sifs qu’il lui faut produire en fonction des visées communicatives. Ces eets
ont pour but de conruire des gures archétypiques qui appartiennent à ce
qu’on appelle des «imaginaires socio-discursifs.»
Mots clés : publicité algérienne, ratégies discursives, sémiolinguiique.
P. Charaudeau

ʕãʕ2018
104
Introduction:
Le travail que nous proposons consie à analyser les diérentes raté-
gies du discours mises en texte par l’argumentation publicitaire dans la presse
écrite algérienne francophone. Notre analyse se focalise essentiellement sur
la forme des messages. On s’interroge sur les procédés, les ratégies par
lesquels les textes publicitaires algériens fondent leur ecacité. Nous avons
tenté, à travers le présent article, de mener une expédition dans le domaine
des ratégies discursives, essentiellement les ratégies discursives énoncia-
tives.
Nous nous intéressons à ce dont parle le langage, à travers l’étude
de la manière dont il en parle, c’e-à-dire à la conguration des marques
formelles conformément au principe de convergence ou de répétition cher à
toute démarche yliique.
Pour illurer notre propos, nous nous appuierons sur des exemples
de publicités extraites des deux journaux nationaux ‘Le Quotidien d’Oran’
et ‘El Watan’ pour déterminer comment l’énonciation organise l’univers du
discours en opérations de pensée de type cognitif, et comment se manifee la
dimension argumentative des messages étudiés.
Pour saisir et comprendre la ratégie énonciative polyphonique, nous
adapterons une démarche ructurale qui accorde la priorité aux données tex-
tuelles. L’énonciatif polémique spécie un comportement allocutif centré sur
le sujet deinataire (TUd) ; l’énonciatif situationnel e un comportement élo-
cutif centré sur le sujet énonciateur (JEé) ; l’énonciatif textuel et intertextuel
dénotent tous les deux un comportement délocutif centré sur le propos énoncé
(ILx).
Les ratégies discursives sont la jonction entre le concept de ratégie
et celui de discours. L’assemblage entre les deux concepts renvoie aux pro-
cessus par lesquels les acteurs mettent la production de textes, de discours au
service de leurs désirs. Ces processus conituent de manière générique des
actions symboliques dans la mesure où ils mobilisent des ressources symbo-
liques pour la conruction de cadres de connaissances et d’interprétation. Ils
incarnent ainsi des eorts de projection et d’objectivation de sens social. Le

ʕãʕ2018
105
discours renvoie à la production de textes, d’images, de langages, de récits et
de mythes.
Nous jugeons important d’aborder le concept de ratégie avant de
dénir la notion de ratégie discursive.
Etymologiquement parlant, le mot « ratégie » e issu du grec ratê-
gos « chef d’armée ». En plus, le verbe ratêgein, qui signie « commander
une armée » a donné ratâgêma « manoeuvre de guerre », d’où le latin ra-
tagema « ruse » et particulièrement « ruse de guerre », et d’où aussi dérive le
mot « ratagème ». Selon le Dictionnaire de ratégie, la ruse n’étant qu’un
aspect de la ratégie, le terme de « ratégie » s’e subitué à l’ancienne
expression d’ « art de la guerre » (De Montbrial & Klein 2000, p. 531). La
pensée ratégique a privilégié l’art militaire et son lien avec la politique : «
Le terme ratégie vient de l’art de conduire les opérations d’une armée sur un
terrain d’action (il s’oppose alors à la tactique) au point qu’il a ni par dési-
gner une partie de la science militaire et a pu faire l’objet d’un enseignement
(les cours de ratégie à l’école de guerre). (CHARAUDEAU, MAINGUE-
NEAU, 2002. P.548).
On entend par ratégies de l’énonciation (ou ratégies énonciatives,
ou discursives) les procédés de mise en discours qui y déploient des formes
actorielles, temporelles et spatiales manipulatrices. « L’actorialisation per-
met en particulier de déterminer la place des sujets dans le discours du fait
d’opérations successives de débrayage et d’embrayage actantiel, e le sujet
de l’énonciation ; de quoi il parle e le sujet de l’énoncé. On peut essayer de
dénir le débrayage comme l’opération par laquelle l’inance de l’énoncia-
tion disjoint et projette hors d’elle, lors de l’acte de langage et en vue de la
manifeation, certains termes liés à sa ructure de base pour conituer ainsi
les éléments fondateurs de l’énoncé-discours.»
Si on conçoit, par exemple l’inance de l’énonciation comme un
syncrétisme de “je-ici-maintenant”, le débrayage actantiel consiera, dans un
premier temps, à disjoindre du sujet de l’énonciation et à projeter dans l’énon-
cé un non-je. En partant du sujet de l’énonciation, implicite mais producteur
de l’énoncé, on peut projeter (lors de l’acte de langage ou de son simulacre à

ʕãʕ2018
106
l’intérieur du discours), en les inallant dans le discours, soit des actants de
l’énonciation, soit des actants de l’énoncé. Dans le premier cas, on opère un
débrayage énonciatif, dans le second un débrayage énoncif […] A l’inverse du
débrayage qui e l’expulsion, hors de l’inance de l’énonciation, des termes
catégoriques servant de support à l’énoncé, l’embrayage désigne l’eet de
retour à l’énonciation […] Tout embrayage présuppose donc une opération
de débrayage qui lui e logiquement antérieure […] Tout comme pour le
débrayage, on reconnaîtra déjà une diinction entre l’embrayage énoncif et
l’embrayage énonciatif.»
1. L’énonciatif polémique ou comportement allocutif:
On parle de comportement polémique lorsqu’on rattache générale-
ment le comportement dit allocutif qui implique locuteur et interlocuteur dans
un rapport d’échange verbal. Ce type de comportement se caractérise par trois
attitudes discursives diérentes:
1. L’information sur le rapport d’allocution (JE-TU) dans le processus de
communication.
2. L’information sur le sujet deinataire ayant l’obligation de s’exécuter face
au « contrat d’exécution » (CHARAUDEAU 1984, p.60) établi par le sujet
énonçant.
3. L’information sur le sujet énonçant qui se positionne comme responsable
du discours.
4. Les textes publicitaires algériens mettent en exergue ces trois attitudes
fondamentales caractériiques de l’ énonciatif polémique qu’on peut saisir
à travers des formes yliiques de l’injonction, de la discrimination et de la
sollicitation.
1.a. Les formes énonciatives injonctives:
Dans les textes publicitaires 1, 2, 3, l’énonciateur utilise la marque
récurrente de l’impératif au niveau linguiique, mais qui e renforcé au ni-
veau guratif par les images des produits, accentuant ainsi la monration et
la volition. On a donc un phénomène de double injonction dont l’une gura-
tive véhiculée par le signiant iconique, et l’autre pragmatique véhiculée le

ʕãʕ2018
107
signiant linguiique. Ceci e renforcé par la redondance et l’insiance, le
matraquage énonciatif qui e une ratégie par excellence
(1) : Avec souk mobile de DJEZZY, protez des bonnes aaires. Faites vite,
trouvez le téléphone qui vous correspond.
(2) : Professionnels, gagnez en exibilité. (BNP PARIBAS).
(3) : AFIA…Mangez serein.
Dans d’autres cas, nous avons aaire à des actes « directifs » qui se
dénissent et se singularisent par leur nature volitive dont la ructure nu-
cléaire e de type IMERATIF+2ème PERSONNE. Modalité performative
explicite, l’impératif a ici une force (valeur) illocutoire de promesse quant
à la satisfaction obtenue par l’obtention du produit ou de désir réalisé. Par
l’impératif, le faire du deinataire se manifee sous forme de désir.
Comme le précise R.BARTHES : « c’e la forme impérative qui vous
gène (…) Il y a dans l’impératif une violence qui e encore plus manifee
lorsqu’il vous e adressé ‘pour votre bien’. Quoi qu’on pense, l’impératif e
l’indice d’une main mise, il e un désir de pouvoir » (ORECCHIONI 1983,
p.183).
Dans les publicités (3) et (5), l’injonction e beaucoup plus atténuée,
et se présente sous la forme d’une ructure énonciative délocutive (imperson-
nelle) qui cache mal sa force performative incitative :
(4) : DJEZZY, vos appels garantis, plus de 80°/° d’appels réussis.
(5) : Mobil Art, conruire votre rêve dans les délais.
Par ailleurs, l’injonction peut se présenter sous la forme d’une sug-
geion, qui consie pour le sujet énonçant à proposer au (TUd) l’utilisation
du produit. On trouve cette forme modalisante dans les publicités 6 et 7 Qui
nuancent la forme injonctive de l’impératif pour lui donner une allure de pro-
position faite au consommateur dans une ambiance de non sommation :
(6) : Faites le bon calcul, 1=1.5, rechargez et gagnez un bonus de 50°/°
(7) : Plus qu’un client, devenez membre. De nombreux avantages ! Mais aussi
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%