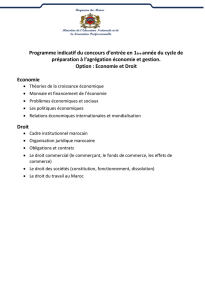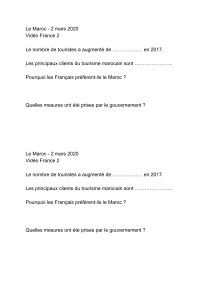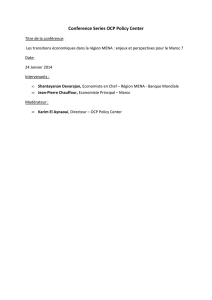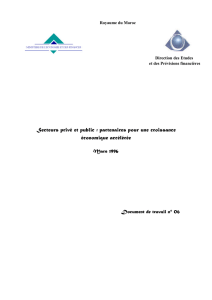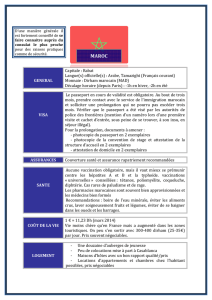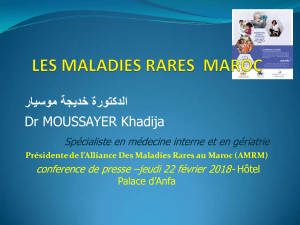Réforme de l'enseignement supérieur au Maroc : Analyse et enjeux
Telechargé par
Achraf Marso

PARIS 8e
48, rue François 1er
Tél. +33 (0)1 53 23 90 96
ZILLI.COM THE FINEST GARMENT FOR MEN IN THE WORLD

55 EconomieEntreprises Août-Septembre 2018
DOSSIER
Le débat autour de la réforme de l’enseignement supérieur est plus que jamais d’actualité. Le secteur ne
parvient pas à se trouver une stratégie d’e cience. Pour les professionnels du secteur, l’urgence consiste à
revisiter la loi 01.00 qui régit entre autres le fonctionnement des universités. Quel serait le meilleur modèle de
gouvernance pour les universités au Maroc? Pour quelles missions et quels rôles? Qu’en est-il des ressources
de fi nancement et quid du mode de gestion? Autant de questions auxquelles répond le Dossier d’EE.
FAUT-IL RENDRE L’UNIVERSITÉ
PUBLIQUE PAYANTE?
SANAE RAQUI

Dossier
56 EconomieEntreprises Août-Septembre 2018
La réforme de l’enseignement supérieur au Maroc ne
cesse de faire couler de l’encre. Ceci ne se limite pas
au niveau national. De fait, les rapports établis par les
ONG internationales, dont précisément celui de la Banque
Mondiale, n’ont pas manqué de dresser un tableau noir de
l’état de l’enseignement supérieur dans le Royaume en le
plaçant aux derniers rangs. Tout le monde s’accorde à dire
que la situation actuelle a atteint un degré de gravité inquié-
tant, d’où la nécessité et l’urgence d’adopter des mesures
susceptibles de mettre à niveau le secteur, dont le budget
frôle le 1% du PIB. Su sant? Insu sant? La question se pose
avec acuité.
Souvent, lorsque les observateurs du secteur veulent établir
un état des lieux, ces derniers ont tendance à se focaliser sur
deux aspects de l’enseignement supérieur: le corps ensei-
gnant et l’o re pédagogique. Le premier est souvent accu-
sé de négligence voire même d’incompétence et le second
est pointé du doigt comme étant non adapté aux besoins
du marché de l’emploi. Ainsi, on néglige mécaniquement les
vraies raisons de ce fi asco national. Car si l’enseignement
supérieur sou re d’inertie, c’est parce que les moyens qui
lui sont attribués ne sont pas en adéquation avec les ob-
jectifs qui lui ont été assignés. Il est clair qu’on ne peut de-
mander à nos universités de démocratiser l’enseignement
et d’en faire bénéfi cier tout le monde sans leur fournir les
moyens nécessaires pour être à la hauteur des objectifs. Et
c’est là naturellement l’origine de tous les maux. Selon les
statistiques du ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifi que, le cycle d’enseignement supérieur
compte quelque 895.715 étudiants, dont 47.890 dans le pri-
vé. Une panoplie de chantiers a été entamée par le ministère
de tutelle pour mettre fi n aux multiples maux qui plombent le
secteur depuis plusieurs années.
Les maux
Il y a d’abord le manque de moyens fi nanciers. Cette contrainte
majeure restera insurmontable si le secteur compte exclusi-
vement sur le budget de l’Etat. Il y a également le problème
des ressources humaines de qualité que le système ne peut
absorber faute de crédits budgétaires supplémentaires. La
problématique de la qualifi cation du personnel enseignant
oppose également un obstacle à la mise à niveau du sec-
teur. Celle-ci est inscrite à l’ordre du jour du projet de grande
ampleur lancé récemment par le ministère et qui concerne la
formation des enseignants. Dans ce sens, Khalid Samadi, se-
crétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de
la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifi que, chargé de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scientifi que avoue: «Je ne peux
pas nier que des dysfonctionnements persistent et ce n’est
L’enseignement supérieur souffre de plusieurs maux, notamment en termes de
gouvernance, de fi nancement et de ressources humaines. Des défi s à prendre très au
sérieux.
Il est plus que primordial de mettre fi n à la problématique du manque d’enseignants.

Dossier
57 EconomieEntreprises Août-Septembre 2018
qu’en persévérant dans la volonté de réformer le secteur en
profondeur que nous pourrons les éradiquer». En e et, on
ne peut pas parler des insu sances dont sou re l’université
sans évoquer son autonomie qui demande à être renforcée
dans le cadre d’un système global de bonne gouvernance
«où le maitre mot sera la contractualisation entre le ministère
et les universités en vertu d’un cahier des charges fi xant clai-
rement les droits et obligations de chacun, le tout appuyé par
un système solide d’évaluation», martèle le secrétaire d’Etat.
A la recherche
d’e cience
Ainsi, la gouvernance est citée
en tête des défi s à relever par
la tutelle. Ce gros dossier passe
avant tout par le renforcement de
l’indépendance des universités
à l’instar des modèles interna-
tionaux. Comment? Il s’agit d’ins-
titutionnaliser l’auto-évaluation
annuelle des universités, le bilan
d’étape tous les deux ans ainsi
que l’évaluation externe tous les
quatre ans. Ces principes devront être inscrits dans la loi, se-
lon le ministère de tutelle. «L’université ne doit plus être un
établissement public à caractère administratif. Il faut changer
son statut pour qu’elle soit productive», avait souligné le mi-
nistre Said Amzazi à la presse marocaine. Ce dernier pro-
pose plutôt un contrôle d’accompagnement. Même le mo-
dèle de gestion doit être révisé. Actuellement, les universités
sont administrées par un conseil qui peut parfois atteindre
jusqu’à 100 membres. Ce qui complique les prises de dé-
cision. Quant au conseil de gestion, dont les membres sont
limités, il n’a aucun pouvoir décisionnel. À cela s’ajoute une
autre aberration: l’absence d’organigramme. Amzazi estime,
par ailleurs, nécessaire de revoir le système de nomination
des présidents d’universités et d’établissements en vue de
créer une bonne synergie entre les deux entités. Il appelle
aussi à permettre aux universités de créer des fondations
partenariales pour dépasser bon nombre de contraintes.
Quid de la gouvernance ?
A noter que le système d’enseignement supérieur marocain
est composé de trois grands secteurs: l’enseignement su-
périeur public, l’enseignement supérieur dans le cadre du
partenariat public-privé et l’enseignement supérieur privé.
Dominant, l’enseignement supérieur public regroupe notam-
ment les universités. Le Royaume compte douze universités
publiques et une université publique à gestion privée répar-
ties sur les di érentes régions du pays. Aux structures univer-
sitaires s’ajoutent également les établissements d’enseigne-
ment supérieur ne relevant pas des universités (EENSNPU).
Il s’agit d’établissements d’enseignement supérieur placés
sous la tutelle administrative et fi nancière de ministères
techniques et sous l’autorité pédagogique du ministère de
l’Enseignement supérieur. Pour leur part, les universités et
les établissements créés dans le cadre de partenariats sont
des fondations à but non lucratif. Ces universités et établis-
sements sont sous l’autorité pédagogique du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifi que et de
la Formation des cadres. De son côté, l’enseignement supé-
rieur privé comporte des universités et établissements créés
par des initiatives privées, mais sous l’autorité pédagogique
du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
scientifi que et de la Formation
des cadres. S’agissant de la
gouvernance, elle est assumée
par la Commission nationale
de coordination de l’enseigne-
ment supérieur (CNCES). Cette
dernière est une instance de
régulation créée par la loi 01-00
portant organisation de l’en-
seignement supérieur. Elle est
chargée notamment de formu-
ler un avis sur la création des
universités et/ou de tout autre
établissement d’enseignement
supérieur public ou privé et de donner un avis sur les de-
mandes d’accréditation des fi lières. D’autres organes inter-
viennent en ce qui concerne la gouvernance. C’est le cas
notamment du Conseil de coordination qui est une instance
de régulation qui émet un avis consultatif sur toutes les ques-
tions d’ordre pédagogique et organisationnel intéressant les
établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas
des universités.
Un personnel plus abondant et mieux formé
S’agissant des ressources humaines, il est aujourd’hui plus
que primordial de mettre fi n à la problématique du manque
d’enseignants. Le dossier de la formation des enseignants et
des recrutements est d’autant plus épineux dans les établis-
sements à accès ouvert (les universités) qui accueillent plus
de 80% des étudiants marocains. Le taux d’encadrement
varie d’un établissement à l’autre. Car si dans les établisse-
ments à accès limité, on compte en moyenne un enseignant
pour 19 étudiants, dans les universités, ce chi re passe à 40
étudiants voire 200 selon la branche proposée dans chaque
faculté. En 2019, les besoins en enseignants seront plus im-
portants alors que l’expérience démontre que le nombre de
postes budgétaires a ectés à l’enseignement supérieur est
resté très limité au cours des dernières années, ne dépas-
sant pas les 700 postes par an. L’enjeu de la réforme enta-
mée par l’Etat est donc énorme à tous les niveaux. L’objectif
est donc de rehausser la qualité de l’enseignement supé-
rieur notamment dans les universités (surtout les facultés de
droit) qui sou rent d’une grande faiblesse de rendement tant
interne qu’externe.
LA
CONTRACTUALISATION
ENTRE LE MINISTÈRE ET
LES UNIVERSITÉS PEUT
CHANGER LA DONNE.

Dossier
58 EconomieEntreprises Août-Septembre 2018
Dossier
D
ans l’imaginaire du Marocain lambda, l’enseignement su-
périeur marocain renvoie, pour schématiser, à des facul-
tés surpeuplées, une orientation pédagogique bancale,
un faible encadrement des étudiants… Sa mise à niveau et in fi ne
l’amélioration de sa gouvernance supposent un (sur)coût que l’Etat,
de longue date, se refuse à supporter. Faut-il pour atteindre ces ob-
jectifs passer à un système universitaire payant? La réponse à cette
question reste di cile pour les acteurs du secteur. L’essentiel est
de défi nir des objectifs ambitieux et réalistes pour l’enseignement
supérieur et concevoir un système équitable qui satisfait toutes les
couches sociales. Pour Abed Chagar, président de l’Association des
Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia (AIEM) et directeur général de
Colorado, «s’il est normal que des personnes aisées participent au
fi nancement des études de leurs enfants, il est tout aussi normal
que l’accès à toutes les fi lières soit permis aux personnes venant
de milieux modestes sur la base d’une seule exigence, le mérite. Il
ne faut pas ignorer l’espoir qu’une formation supérieure fait naître
chez les personnes dans le besoin et l’ascenseur social que repré-
sente l’enseignement supérieur». Pour Abdellatif Miraoui, président
de l’université Cadi Ayyad, «les modalités d’accès à l’université pu-
blique doivent être repensées. Il n’a jamais été question de toucher
au principe de gratuité ou d’empêcher un jeune issu d’un milieu
défavorisé d’accéder au supérieur. Bien au contraire, la question
des moyens ne doit absolument pas être une barrière qui entra-
verait l’accès des jeunes issus de milieux défavorisés d’accéder à
l’université». Seule une bonne gouvernance permettrait la viabilité
d’un tel système. Si le Maroc se donne les moyens d’appliquer une
telle réforme en tenant compte du pouvoir d’achat des ménages,
l’université publique se donnera toutes les chances de continuer à
o rir une excellente formation, à un coût plus compétitif que celui
appliqué dans les universités étrangères. Ses promoteurs voient
dans cette mesure une façon justement d’investir dans l’université
publique, un passage nécessaire pour améliorer la qualité de l’o re
de formation et permettre un développement beaucoup plus e -
cient de l’enseignement supérieur. D’autant que ces moyens que
l’Université marocaine exige pour réussir sa réforme et pour propo-
ser l’o re concurrentielle que la société marocaine appelle de ses
vœux, l’Etat n’en dispose pas. «J’estime alors qu’il serait salutaire,
équitable, et juste vis-à-vis des jeunes Marocains et de toutes les
familles marocaines que ceux qui ont les moyens paient des frais de
scolarité, et que ceux qui n’ont pas les moyens bénéfi cient d’aides
fi nancières et d’exonérations. Maintenant, nous avons la responsa-
bilité de donner confi ance à ceux qui ont les moyens de payer», af-
fi rme de son côté Amine Bensaïd, président de l’Université Mundia-
polis. Le Rwanda, par exemple, a fait un énorme bond en avant en
investissant dans l’éducation et en utilisant les opportunités qu’o re
la révolution technologique. En e et, son président Paul Kagamé a
principalement promu les TIC dans l’éducation en tant que vecteur
de transformation éducative destinée à accroître l’accès à l’éduca-
tion de base. Ceci a donc fonctionné: le taux d’alphabétisation est
passé de 55% en 1994 à 70% en 2017. Sa vision était claire, fournir
aux citoyens rwandais des opportunités égales pour une éducation
de qualité grâce à des centres d’apprentissage de classe mondiale
et à des institutions d’enseignement renommées. Résultat : les en-
fants des classes aisées ont repris le chemin de l’école publique. Ne
pas se donner les moyens équivaudrait à se condamner, en tirant
tout le système vers le bas, avec tous ceux (étudiants, professeurs,
sta administratif) qui décident ou sont contraints d’en être partie
prenante. Le modèle de l’intégration des fondations à but non lu-
cratif dans le management des universités est une option à étudier
pour le Maroc. L’exemple des Etats-Unis et de la Turquie a montré la
pertinence de ce modèle comme levier d’ascenseur social.
Les modalités d’accès à l’université publique doivent être repensées dans une double
optique d’accessibilité et de performance.
VERS L’UNIVERSITÉ PUBLIQUE PAYANTE?
L’Etat ne peut pas à lui seul fi nancer la qualité dont l’université a besoin.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%