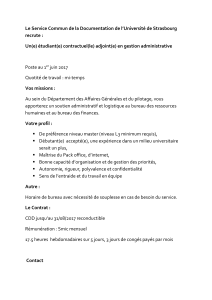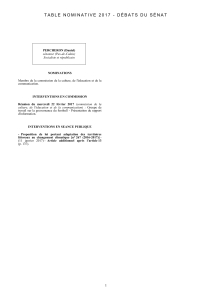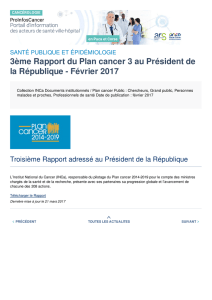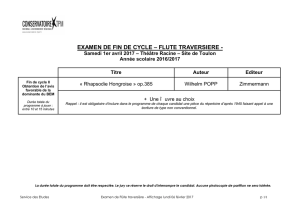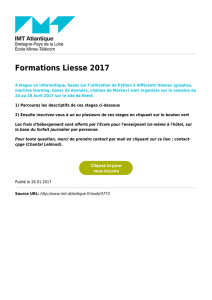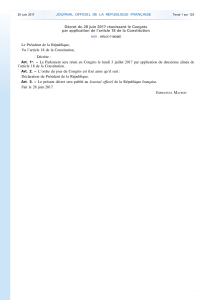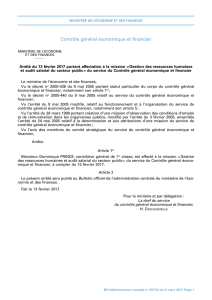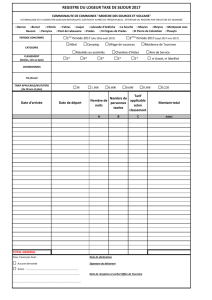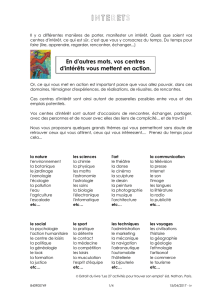en mission pour la Cité
EXPO
ICI L'AFFICHE
AUGMENTÉE
13 JUIN 2017
14 JANVIER 2018
PORTE DE LA VILLETTE
#ExpoValerian
AVEC LA PARTICIPATION DE AVEC LE SOUTIEN DE EN PARTENARIAT AVEC

DITO
É
www.pourlascience.fr
170 bis boulevard du Montparnasse – 75014 Paris
Tél. 01 55 42 84 00
Groupe POUR LA SCIENCE
Directrice des rédactions : Cécile Lestienne
POUR LA SCIENCE
Rédacteur en chef : Maurice Mashaal
Rédactrice en chef adjointe : Marie-Neige Cordonnier
Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly
POUR LA SCIENCE HORS-SÉRIE
Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin
Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe
Conception graphique : William Londiche
Directrice artistique : Céline Lapert
Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel,
Ingrid Leroy
Correction et assistance administrative :
Anne-Rozenn Jouble
Marketing & diffusion : Laurence Hay, Arthur Peys
assisté de William Armand
Direction financière et direction du personnel :
Marc Laumet
Fabrication : Marianne Sigogne et Olivier Lacam
Directrice de la publication et gérante : Sylvie Marcé
Anciens directeurs de la rédaction : Françoise Pétry
etPhilippe Boulanger
Conseiller scientifique : Hervé This
Ont également participé à ce numéro :
Didier Betbeder, Christophe Bonnal, Maud Bruguière,
Vincent Colot, Silvana Condemi, Pierre Jouventin,
Thierry Lasserre, José Pessis, Christophe Pichon,
Daniel Tacquenet, Benoît Valiron
PRESSE ET COMMUNICATION
Susan Mackie
[email protected] • Tél. 01 55 42 85 05
PUBLICITÉ France
Directeur de la publicité : Jean-François Guillotin
Tél. 01 55 42 84 28 • Fax: 01 43 25 18 29
ABONNEMENTS
Abonnement en ligne : http://boutique.pourlascience.fr
Courriel : [email protected]
Tél. 03 67 07 98 17
Adresse postale : Service des abonnements –
Pour la Science, 19rue de l’Industrie, BP90053,
67402Illkirch Cedex
Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)
France métropolitaine : 59 euros – Europe: 71 euros
Reste du monde : 85,25euros
DIFFUSION
Contact kiosques : À Juste Titres ; Benjamin Boutonnet
Tél. 04 88 15 12 41
Information/modification de service/réassort :
www.direct-editeurs.fr
SCIENTIFIC AMERICAN
1 New York Plaza, Suite 4500, New York, NY 10004-1562
Editor in chief : Mariette DiChristina
President : Dean Sanderson
Executive Vice President : Michael Florek
Toutes demandes d’autorisation de reproduire, pour lepublic français ou
francophone, les textes, les photos, les dessins ou les documents contenus
dans la revue «Pour la Science», dans la revue «Scientific American», dans
les livres édités par «Pour la Science» doivent être adressées par écrit à
«Pour la Science S.A.R.L.», 162 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010Paris.
© Pour la Science S.A.R.L. Tous droits de reproduction, detraduction,
d’adaptation et de représentation réservés pour tous les pays. La marque
et le nom commercial «Scientific American» sont la propriété de
Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science S.A.R.L.».
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit dereproduire
intégralement ou partiellement laprésente revue sans autorisation de
l’éditeur ou duCentre français de l’exploitation du droit de copie (20rue
des Grands-Augustins, 75006Paris).
Origine du papier : Autriche
Taux de fibres recyclées : 30%
Certification : PEFC
« Eutrophisation » ou « Impact
sur l’eau » : Ptot 0,007kg/tonne
Vous tenez ce mois-ci entre les mains (à moins que
vous ne nous lisiez en ligne…) un magazine tout
neuf ou presque, bien qu’il fêtera ses 40ans d’exis-
tence cet automne. L’équipe de Pour la Science est ravie
de vous faire découvrir un nouveau graphisme, une
couverture plus esthétique, une mise en pages moder-
nisée, mieux structurée et plus agréable, des polices de caractères qui
apportent un meilleur confort de lecture… Nous vous proposons
aussi de nouvelles rubriques ainsi que davantage d’actualités pour
mieux satisfaire votre curiosité et vos goûts.
Et nous continuons bien sûr à cultiver ce qui a fait la force et l’ori-
ginalité de Pour la Science: des articles de fond rédigés par les meilleurs
spécialistes, faisant le point sur les recherches (et découvertes!) ré-
centes dans des disciplines très variées. C’est, avec une équipe rédac-
tionnelle de formation scientifique, le gage d’une information de qua-
lité, claire et rigoureuse, loin des effets d’annonce et des simplifications
outrancières, voire des erreurs et des fausses informations qui peuvent
circuler sur la Toile ou ailleurs.
Nous sommes aussi convaincus que nos équipes humaines ne risquent
pas d’être détrônées, dans un futur prévisible, par des robots-journalistes
dont on entend parfois parler… Et pourtant, les programmes informa-
tiques et les robots sont de plus en plus performants. Voire «intelligents».
Mais qu’est-ce que l’intelligence d’une machine? Le test de Turing, ima-
giné en1950, se révèle insuffisant pour la caractériser et la mesurer. Par
quoi le compléter et pourquoi? C’est ce que vous expliquent dans ce nu-
méro Laurence Devillers et Gary Marcus, deux chercheurs en intelligence
artificielle (voir pages25 à38). Bonne lecture et bonne découverte!
Nous sommes impatients de recueillir vos réactions à cette nouvelle
formule sur [email protected] n
CE MAGAZINE
N’EST PAS
ENCORE ÉCRIT
PAR DES ROBOTS
MAURICE
MASHAAL
rédacteur
en chef
POUR LA SCIENCE N° 476 / Juin / 3

P. 6
ÉCHOS DES LABOS
• Hérédité sans gènes
chez la mouche
• Pic de performance
cognitive à 25ans
• Les chevaux scythes
• L’impossible zéro kelvin
• Les motifs du lézard ocellé
• La ruse du virus géant
• Cyanobactéries et origine
de la photosynthèse
• L’énergie sombre,
une illusion?
• De l’ADN fossile
dans la boue
P. 18
LIVRES DU MOIS
P. 20
AGENDA
P. 22
HOMO SAPIENS
INFORMATICUS
Qui est responsable?
Gilles Dowek
P. 24
CABINET DE CURIOSITÉS
SOCIOLOGIQUES
Vladimir Poutine
et Barbra Streisand
Gérald Bronner
P. 40
MÉDECINE
L’HÉPATITE C
BIENTÔT VAINCUE ?
Patrick Marcellin
et Pierre Kaldy
Il n’existe pas de vaccin
contre l’hépatite C.
Néanmoins, on sait
aujourd’hui guérir de cette
maladie virale meurtrière.
Reste à débloquer les fonds
pour étendre les traitements
aux 71 millions de personnes
infectées dans le monde.
P. 48
SPATIAL
CAP SUR ALPHA
DU CENTAURE
Ann Finkbeiner
Un projet fou: propulser par
laser des sortes de petits
voiliers vers une autre étoile
que le Soleil. En finançant
Starshot, le milliardaire russe
Youri Milner va-t-il réaliser
un vieux rêve de l’humanité?
P. 58
BIOLOGIE
SULFUREUSE
ÉVOLUTION CHEZ LES
POISSONS MEXICAINS
Rüdiger Reisch et Martin Plath
Les eaux de certaines
sources mexicaines, riches
en sulfure d’hydrogène,
sont extrêmement toxiques.
Pourtant, des espèces de
poissons s’y sont adaptées.
Par quels mécanismes?
P. 66
LINGUISTIQUE
PARLER EN SIFFLANT,
UN PHÉNOMÈNE
PLANÉTAIRE
Julien Meyer
«Je voudrais manger»,
«Cache-toi, la police
arrive»… Comment
transmettre
de tels messages sur
des centaines de mètres?
En sifflant! Dans le monde,
de nombreuses populations
ont développé cette
technique qui fascine
les linguistes.
NE MANQUEZ PAS
LA PARUTION DE
VOTRE MAGAZINE
GRÂCE À LA NEWSLETTER
LETTRE D’INFORMATION
• Notre sélection d’articles
• Des offres préférentielles
• Nos autres magazines
en kiosque
Inscrivez-vous
www.pourlascience.fr
En couverture :
© Takito/Shutterstock.com – PLS
Les portraits des contributeurs
sont de Seb Jarnot
Ce numéro comporte un encart
Mondadori sur une sélection
d’abonnés France métropolitaine.
4 / POUR LA SCIENCE N° 476 / Juin
N° 476 /
Juin 2017
OMMAIRE
sACTUALITÉS GRANDS FORMATS

P. 26
MACHINE,
ESTU INTELLIGENTE ?
Gary Marcus
On a longtemps cherché la réponse à cette question
à l’aide du fameux test de Turing. Mais ce test, imaginé
en1950, a montré ses limites. Par quoi le remplacer?
Par des batteries d’épreuves de différentes natures,
disent les spécialistes.
P. 32
TESTER LES ROBOTS
POUR BIEN VIVRE AVEC
Laurence Devillers
Dialoguer, apprendre, détecter l’état émotionnel
de ses interlocuteurs, faire de l’humour…:
certaines machines le font déjà. Mais il sera
indispensable de bien évaluer ces capacités si l’on veut
utiliser et côtoyer des robots en toute confiance.
P. 74
HISTOIRE DES SCIENCES
LA CÉRUSE,
UN POISON ?
ET ALORS !
Judith Rainhorn
Au esiècle, la toxicité
de la céruse, une poudre
à base de plomb largement
utilisée dans la peinture
en bâtiment, ne faisait aucun
doute. Pourtant, son usage
est resté légal en Europe
jusqu’en1993: les industriels
de la céruse veillaient
au grain…
P. 80
LOGIQUE & CALCUL
LES PARTAGES
ÉQUITABLES
D’UNE TARTE
Jean-Paul Delahaye
Il est facile de découper
un disque en parts égales
et identiques en partant
de son centre. Mais deux
géomètres britanniques ont
récemment montré qu’il
existe pléthore de découpages
équitables plus élaborés…
et moins symétriques.
P. 86
ART & SCIENCE
La D comme vous
ne l’avez jamais vue
Loïc Mangin
P. 88
IDÉES DE PHYSIQUE
Une vision progressive…
pas si nette
Jean-Michel Courty
et Édouard Kierlik
P. 92
CHRONIQUES
DE L’ÉVOLUTION
Comment l’ours polaire
a conquis l’Arctique
Hervé le Guyader
P. 96
SCIENCE & GASTRONOMIE
Beurre et sucre:
le bonbon ultime
Hervé This
P. 98
À PICORER
P. 25
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AUDELÀ DU
TEST DE TURING
POUR LA SCIENCE N° 476 / Juin / 5
RENDEZVOUSGRANDS FORMATS
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
1
/
98
100%