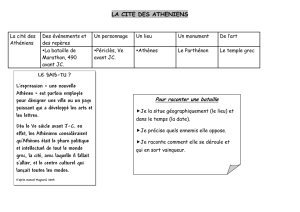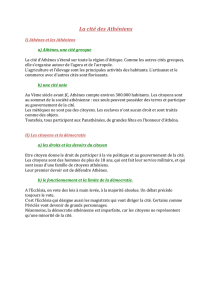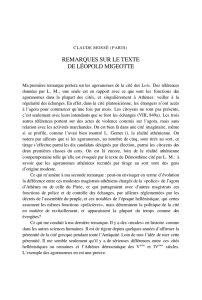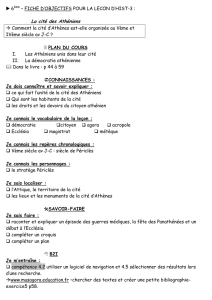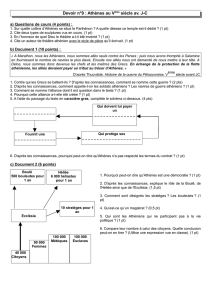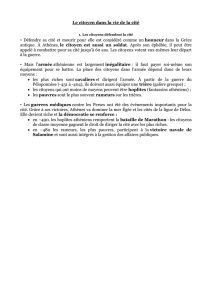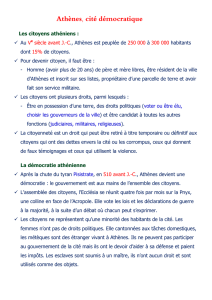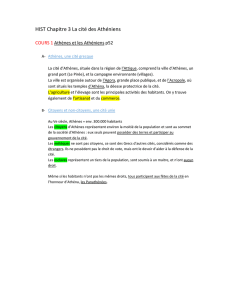HISTOIRE UNIVERSELLE Athènes (de 480 à 336 av. J.-C.)

HISTOIRE UNIVERSELLE
Athènes (de 480 à 336 av. J.-C.)
Par Marius Fontane

CHAPITRE PREMIER
480 Av. J.-C. - Après les Thermopyles. - Invasion de Xerxès. - Les Thessaliens. - Delphes et le
Grand-Roi. - Athènes et ses alliés. - Patriotisme des Athéniens. - Rappel des exilés. - Prise
d'Athènes et incendie de l'Acropole. - Thémistocle. - Combat de Salamine. - Aristide à Psyttalie. -
Retraite de Xerxès. - La flotte athénienne. - Sparte, ville souveraine
CHAPITRE II
DE 480 À 479 Av. J.-C. - Aristide, général en chef. - Athènes refaite, suspectée. - Les Phéniciens. -
Thèbes et Argos. - Aryens d'Athènes. - L'œuvre des Doriens. - Les Hellènes. - Les Perses en
Attique. - Bataille de Platée. - Mort de Mardonius.- Les fêtes de la Liberté. - Bataille de Mycale. -
Europe, Asie et Afrique. - Peuples et rois
CHAPITRE III
DE 480 A 466 Av. J.-C. - Xerxès perdu, méprisé. - L'histoire et l'épopée. - Hérodote : son
caractère, influence de Sparte sur son esprit, ses voyages, son oeuvre. - Eschyle continuateur
d'Homère : son caractère, son oeuvre. - La justice. - Fondation de l'Aréopage. - Pallas-Athénèe
CHAPITRE IV
DE 479 A 457 Av. J.-C. - Les nouveaux Athéniens. - La ville et le port. - Prise de Byzance. -
Trahisons de Pausanias et de Léotychidas, rois de Sparte. - Aristide, chef. - Démocratie. - Mort de
Xerxès et de Pausanias. - Cimon. - Sophocle vainqueur d'Eschyle. - Le temple de Thésée. - Siège
de Thasos. - Cimon banni ; départ d'Eschyle. - Éphialte et Périclès. - Troisième guerre de Messénie.
- Guerres civiles inaugurées. - Ioniens et Péloponnésiens
CHAPITRE V
DE 457 A 445 Av. J.-C. - Artaxerxés Ier, Longue-Main. - Les Spartiates à Tanagra. - Les Athéniens
en Égypte et en Thessalie. - Rappel et mort de Cimon. - Troubles. - Démocratie et Aristocratie. -
Question religieuse. - Divinités nouvelles, héros et prêtres. - Jupiter, Apollon et Bacchus. - Olympie
et Delphes. - Soumission de Pallas
CHAPITRE VI
DE 445 A 429 Av. J.-C. - Périclès. - L'Athènes impériale.- Révolte de Samos et de Byzance,
Colonies. - Aspasie. - Les nouveaux Athéniens : Marins, Ouvriers, Campagnards. - Les Grands et
les Petits. - La foule. - Dénonciateurs et suspects. - L'influence de la parole. - Monarchie,
Oligarchie, République
CHAPITRE VII
DE 445 A 429 Av. J.-C. - L'Empire Athénien. - Ville Capitale. - Monuments. - Artistes et marchands.
- La cour de Périclès. - Fêtes. - La famille à Athènes. - L'hospitalité. - Courtisanes. - Esclavage. -
Agriculture, commerce, industrie, navigation. - Riches et Pauvres. - Le Peuple. - La jeunesse

CHAPITRE VIII
L'Athènes monumentale. - Athéniens et étrangers. - Sculptures. - Crésus et Périclès.- L'art
nouveau. - Architecture. - La colonne. - Ordres dorique, ionique, corinthien et attique. - L'ornement
- Le Parthénon et les Propylées. - Temples et tombeaux. - Peinture. - Polychromie. - Céramique. -
L'Académie. - Les gymnases. - L'Agora. - Théâtres. - L'Acropole
CHAPITRE VIII (Suite)
La statuaire.- Phidias, Lysippe et Praxitèle. - Mythes et divinités. - Héros divinisés. - Le culte du
Beau. - Figurines de Rhodes, Chypre, Tanagra, Thèbes, Corinthe et Myrina. - Trafics : Étoffes
teintes et brodées, tapisseries, armes, ivoires, verreries, orfèvreries, bijoux. - Gravure. - Les vases
corinthiens, étrusques, chypriotes et helléniques. - L'art grec
CHAPITRE IX
But artistique de Périclès. - Rite théâtral. - Sacrifices humains. - Bacchus-Apollon. - Mystères. - Le
personnel des temples. - Tarification des sacrifices. - Divinateurs et rois. - La musique : chants,
modes, instruments. - La danse. - Bakkhos et Aphrodite. - Fêtes. - Femmes. - Processions. - Les
chansons. - Virtuoses et saltimbanques. - Athènes en Asie
CHAPITRE X
Les Tragiques, éducateurs. - Eschyle. - Le Drame substitué à l'Épopée. - Sophocle et son oeuvre. -
Le mal ouranien. - Euripide et son oeuvre. – La Politique. - Naturalisme. - Les spectateurs. - Le rire
et la pitié. - Tragédie et comédie
CHAPITRE XI
La Liberté athénienne. - L'éloquence. - Dialectes. - Les littérateurs. - Fabulistes et poètes. - Le
bruit bachique. - La science. - Pythagore. - Médecine : Hippocrate et Galien. - Anaxagore et
Périclès. - Dieu. - Socrate. - Philosophes. - Protagoras donne la grammaire. - La justice et le droit.
- Les héliastes. - Plaideurs et orateurs. - Sophistes et démagogues
CHAPITRE XII
Les Athéniens et Périclès. - Les ennemis d'Athènes : Égine, Mégare, Corinthe et les Aristocrates. -
L'or persique. - Les Spartiates : propriété et esclavage. - Messéniens et Héléates. - Hilotes. -
Périèques. - Industrie laconienne. - Lacédémone. - La peine de l'atimie. - Les éphores et les rois. -
Sparte et Athènes. - Origine de la guerre de Péloponnèse
CHAPITRE XIII
DE 432 A 430 Av. J.-C. - Incidents de Corcyre, Potidée et Platée. - Intervention de Corinthe. -
Combat naval de Sybota. - Mégare contre Athènes. - Delphes conseille Sparte. - Plan de Périclès. -
Archidamos en Attique. - Succès de la flotte athénienne. - Périclès allié de Perdiccas et de Sitalcès.
- Armées. - Stratèges. - Tactique. - Sièges. - Lutte décisive entre Athènes et Sparte

CHAPITRE XIV
DE 430 A 425 Av. J.C. - Archidamos en Attique. - La peste à Athènes. - Les moeurs athéniennes. -
Périclès à Épidaure. - Reddition de Potidée. - Platée. - Mort de Périclès. - Retour d'Archidamos. -
Révolte de Mitylène. - Cléon. Sophistes et Démagogues. - Siège de Platée. - Troubles et massacres
à Corcyre. - Tremblements de terre. - Aristocrates et Démocrates. - Aristophane et son œuvre
CHAPITRE XV
DE 425 A 421 Av. J.-C. - Le Péloponnèse. - Démosthène à Pylos. - Sparte désire la paix. -
Reddition des Spartiates à Sphactérie. - Cléon s'approprie la victoire. - Massacre des hilotes à
Sparte. - Victoires de Nicias et de Démosthène. - Succès de Brasidas. - Exil de Thucydide. - Trêve
d'un an rompue. - Mort de Brasidas et de Cléon. - Plistonax. - Paix de Nicias. - Delphes
omnipotente
CHAPITRE XVI
DE 421 A 416 Av. J.-C. - Nicias et Alcibiade. - Alcibiade en Péloponnèse. - Agis en Argolide. - Le
Conseil des Dix à Sparte. - Bataille de Mantinée. - L'armée de Lacédémone. - Chute d'Argos. - Prise
de Mélos par Athènes : Le droit de la force ; nouvelle politique. - La Sicile et les Siciliens. - Gélon et
Hiéron. - Syracuse et Agrigente. - Carthage. - Alcibiade prépare une expédition en Sicile
CHAPITRE XVII
DE 427 à 407 Av. J.-C. - L'expédition de Sicile. - Mutilation des Hermès. - Terreur à Athènes. -
Trahison d'Alcibiade. - Mort de Lomachos. - Gylippos à Syracuse. - Démosthène et Eurymédon
adjoints à Nicias. - Retraite désastreuse des Athéniens. - Mort de Nicias et de Démosthène. -
Sparte contre Athènes. - Nouvelle constitution d'Athènes. - Oligarchie. - Alcibiade à Samos. - La
Démocratie rétablie. - Victoire de Sestos et de Cyzique. - Alcibiade généralissime
CHAPITRE XVIII
DE 407 A 395 Av. J.-C. - Alcibiade à Athènes et en Asie. - Cyrus le jeune. - Fuite d'Alcibiade. -
Callicratidas et Conon. - Bataille des Arginuses. - Victoire et désastre des Athéniens à Égos-
Potamos. - Prise d'Athènes. - Les Trente Tyrans. - Mort d'Alcibiade. - Thrasybule reprend Athènes
et meurt. - L'ancienne constitution rétablie à Athènes. - Cyrus contre Artaxerxés II à Cunaxa. -
Mort de Cyrus. - Retraite des Dix-Mille : Xénophon. - Condamnation et mort de Socrate. -
Thimbron et Dercyliidas en Asie. - Agésilas. - L'or persique. - Guerre rallumée en Grèce
CHAPITRE XIX
DE 395 À 368 Av. J.-C. - Mort de Lysandre et de Pausanias. - Bataille de Némée et de Coronée. -
Victoire de Conon. - Iphicrate : Nouvelle tactique. - Les Peltastes. - Athènes relevée. - Sparte traite
avec les Perses. - Mort de Thrasybule. - Paix imposée à Athènes. - La Confédération olynthienne. -
Thèbes arrachée à Sparte. - La Thèbes nouvelle. - Épaminondas et Pélopidas. - Ligues athénienne
et lacédémonienne. - Agésilas et Chabrias. - Cléombrote. - Athènes et Sparte contre Thèbes. -
Bataille de Leuctres. - Les Arcadiens : fondation de Mégalopolis. - Sparte assiégée. - Les
Thessaliens. - Jason et Alexandre de Phères. - Delphes

CHAPITRE XX
DE 368 A 361 Av. J.-C. - Influence des Perses en Hellénie. - Épaminondas en Thessalie. - Flotte
thébaine. - Combat aux Cynoscéphales. - Mort de Pélopidas.- Troubles partout.- Athènes contre
Thèbes. Bataille de Mantinée. Mort d'Épaminondas. - Athènes seule encore vivante. - Thucydide :
son caractère et son œuvre. - Xénophon et ses œuvres. - L'Athènes phénicienne
CHAPITRE XXI
DE 361 A 324 Av. J.-C. - Les nouveaux Athéniens. - L'adoration de soi. - La misère des Pauvres. -
L'Éphébie. - La Comédie nouvelle : Chérémon, Théodecte et Agathon, Antiphane et Alexis. -
Sophron et le théâtre mimé. - Ménandre et Philémon. - Les discoureurs. - Le commerce des livres.
- Les écrivains. - Sculpture : Iktinos, Praxitèle, Scopas, Lysippe. - Peinture : Apelles. - La musique.
- Démoralisation par les esclaves. - Athènes sans Athéniens
CHAPITRE XXII
Platon : son caractère et son œuvre. - La Philosophie. - Orphée. - Ères théologique et
philosophique. - Homère et Hésiode. - Ioniens et Doriens. - Thalès. - Écoles ionique et italique. -
Anaximandre, Anaximène, Héraclite, Démocrite, Pythagore, Xénophane, Parménide, Zénon,
Empédocle et Anaxagore. - Les Sophistes. - Socrate et les socratiques : Antisthène, Aristippe,
Euclide, Platon
CHAPITRE XXIII
DE 600 A 356 Av. J.-C. - L'Hellénie abandonnée. - Vénalité des généraux. - Les Athéniens et les
étrangers. - Les Italiotes. - La Macédoine, terre grecque; l'Argien Perdiccas, premier roi.- Perdiccas
II. - Archélaos Ier et sa cour. - Quarante ans d'anarchie. - Perdiccas III. - Philippe roi. - La
Phalange. - Athènes et Pella. - Mort de Chabrias et défection de Charès. - Timothée et Iphicrate
condamnés. - Isocrate et Démosthène. - Naissance d'Alexandre. - Victoire de Parménion. - Philippe
vainqueur aux jeux olympiques
CHAPITRE XXIV
DE 356 A 343 Av. J.-C. - Philippe de Macédoine en Thessalie et en Phocide. - Philomélos prend
Delphes; sa mort. - L'Apollon-Delphien vengé par Philippe. - Paix entre Thèbes et Sparte. - Philippe
en Thrace. - Première philippique de Démosthène. - Philippe à Pella. - Les olynthiennes. - Les
Athéniens. - Philippe siège au conseil des Amphictyons.- Suppression de la Phocide. - Athènes
isolée et Sparte humiliée. - Deuxième philippique. - La Thessalie macédonienne. - Philippe et
Athènes. - Les véritables frontières helléniques
CHAPITRE XXV
DE 343 A 336 AV. J.-C. - Python et Hégésippos. - La guerre. - Démosthène, Eschine et Philocrate. -
Philippe en Thrace.- Succès d'Athènes.- Philippe en Phocide. - Thèbes alliée d'Athènes. Bataille de
Chéronée. - Congrès de Corinthe. - Philippe généralissime.- Troubles domestiques à Pella. -
Préparatifs d'expédition contre les Perses. - Assassinat de Philippe et avènement d'Alexandre. -
Philippe de Macédoine : son oeuvre et son caractère. - La politique de Démosthène
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
1
/
189
100%