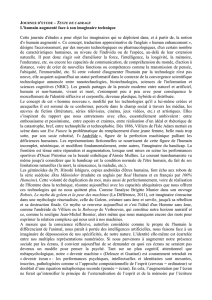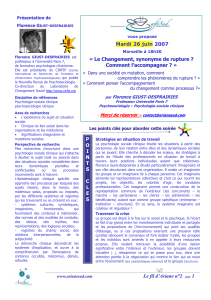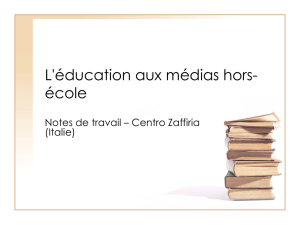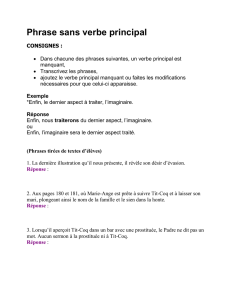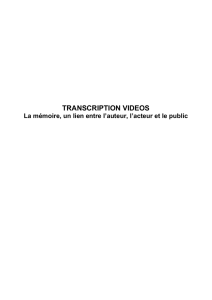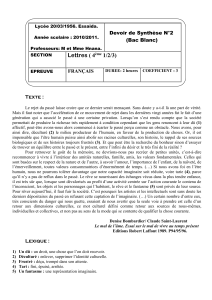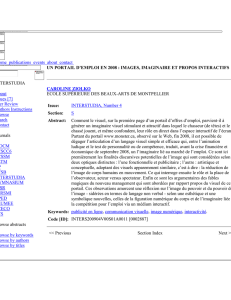Méthodologie d`exploration de l`imaginaire du train

Méthodologie d’exploration de l’imaginaire du train
« Le projet du Grand Paris Express »
25/06/2014
Université Paris Diderot
Cédric Faure

1
Présentation de la recherche
« Il ne s’agit plus d’opposer le sujet et l’objet mais bien de parvenir à comprendre que
se trouve au sein des objets plus de richesse et d’intelligence que nous ne l’avions jamais
pensé. En un sens, ce sont les objets qui sont dépositaires de ce que nous pouvons apprendre de
plus intéressant sur le sujet. Car les choses sont pleines d’ingéniosité, d’histoires, de puissance
symbolique qui se révèlent dès qu’on veut bien se donner la peine de les interroger. Leur
matérialité même, leur tissu, leur grain, mais aussi leurs formes offrent constamment de
nouvelles possibilités, que l’industrie et la technique ne cessent de déployer ».
François Dagognet, 1993
La recherche actuelle sur « l’imaginaire du train » se propose d’explorer la place de
l’imaginaire dans la prise de décision liée au train et aux infrastructures ferroviaires. Nous
souhaitons proposer dans ce texte des éléments de méthodologie et des pistes de réflexion qui
pourront être discutés et ultérieurement mis en débat pour l’ensemble de la recherche. Notre
réflexion ne se limite pas à notre terrain d’étude sur le projet du « Grand Paris Express » bien
qu’elle y trouve la source de son questionnement relativement aux processus de décision.
Nous voudrions que les premiers résultats issus de cette enquête de terrain, avec les cinq
premiers entretiens, puissent ainsi commencer à nous éclaircir sur les enjeux méthodologiques
et théoriques du projet global sur l’imaginaire du train et des réseaux ferroviaires.
Le train est aujourd’hui un symbole du progrès et de la civilisation. Mais il est aussi un
support aux projections imaginaires les plus contradictoires. Tout à la fois objet technique,
politique, économique, social, urbain… il est aussi objet de passions, d’amour et de haine,
d’espérances et de craintes, de fascination et de déception, de progrès et de mépris ; Le train
est un objet d’investissement ambivalent dont l’imaginaire très foisonnant illustre
parfaitement bien les évolutions et les contradictions de nos sociétés contemporaines. Ceci
n’est toutefois pas complétement nouveau. Depuis le XIXème siècle, le train participe au
rapport renouvelé de l’homme à la nature et à la technique : l’accélération de la vitesse de
déplacement par le roulement et le glissement (changement progressif des supports/guidages)
induit de nouveaux imaginaires et oblige à repenser les articulations entre le sujet, le regard et
la société, l’espace, le temps et la perception des paysages. L’histoire des techniques mais
aussi l’histoire des arts plastiques gardent en mémoire tous ces changements de
représentations créés par les effets de vitesse (révolution dans le domaine de la représentation
picturale, art dynamique et cinétique, etc.). En moins de deux siècles, le train va ainsi
diversement inspirer la poésie, la littérature, la peinture (impressionnisme, futurisme), le
cinéma. Nous y voyons se déployer les motifs récurrents du voyage ferroviaire : l’aventure et
la découverte (le départ, l’inconnu), la nostalgie et la mélancolie (la séparation, les adieux), le

2
désir et la sexualité (les rencontres insolites, amoureuses, les plaisirs liés aux secousses, les
excitations liées aux sensations du mouvement ou encore la prostitution qui s’établit à
proximité des gares parisiennes), le crime et la mort (craintes de l’accident, des collisions, du
déraillement, du bagage abandonné, de l’accident voyageur). Avec la démocratisation et la
vitesse du train, c’est enfin le voyage d’agrément et de plaisir qui se développe.
Ces imaginaires qui associent le voyage au train rencontrent aujourd’hui l’imaginaire
voyageur de l’individu contemporain : désirs manifestes de rêverie, d’itinérance, d’ailleurs, de
lointain, de découverte, de dépaysement, etc. Ces désirs abondamment étudiés par la
littérature sociologique correspondent bien à l’époque, à l’ère du temps, dans des sociétés qui
sont à l’évidence de plus en plus capitalistes, individualistes et hypermodernes. Ces désirs ne
sont pas pour autant contradictoires avec des besoins concrets, quotidiens, de mobilité, de
rapidité, d’utilité des déplacements et de nouvelles offres de transport en commun. Le voyage
en ville, le voyage urbain, métropolitain, répond en général à une demande plus pratique,
fonctionnelle (temps, coûts, fluidité des trajets, etc.). Ceci nous oblige à repenser aujourd’hui
les expériences de voyage et les éléments constitutifs aux mobilités, aux déplacements, dans
les « espaces urbains », les « espaces de transit », les « espaces de connectivité », etc.
Face à ces nouveaux impératifs, le projet du « Grand Paris Express » offre une expérience
complétement nouvelle du transport et du déplacement urbain. Le projet de réaménager toute
la métropole francilienne, en passant par la construction de ce métro automatique (circulant en
rocade à 60 km/h), pour porter le développement de la région capitale, soulève par ailleurs de
nombreuses questions. L’enjeu est en effet de transformer dans les décennies à venir la région
en grande métropole mondiale : le métro, avec notamment ses 200 km de lignes nouvelles, ses
4 nouvelles lignes et ses 72 gares, reliera les principaux pôles urbains de la région et sera
connecté au réseau ferroviaire à grande vitesse et aux aéroports d’Orly, du Bourget et de
Roissy-Charles de Gaulle. Le texte fondateur qui définit le Grand Paris comme « un projet
urbain, social et économique d’intérêt national » qui vise à promouvoir « le développement
économique durable, solidaire et créateur d’emplois de la région capitale » pour en faire un
territoire exemplaire (loi du 3 juin 2010) repose ainsi très clairement sur la construction du
métro express. L’Acte motivé et le Schéma d’ensemble (approuvés par le conseil de
surveillance de la société du Grand Paris le 26 mai 2011 et par décret le 26 août 2011) ont
déjà fixé les prévisions de tracé et les gares du futur métro. Le projet du Grand Paris Express
est donc inscrit au cœur du Grand Paris : les mouvements (les voyages, les déplacements) font
aujourd’hui la ville, et le métro automatique fera demain le « Grand Paris » et après-demain la
grande « métropole mondiale ». Il y a bien là toute une construction imaginaire à réinterroger.

3
Problématique de la recherche
Il semble finalement que l’on ne puisse pas explorer plus loin « l’imaginaire du train » sans
aussi explorer « l’imaginaire du voyage » et « l’imaginaire d’une ville » qui unissent
aujourd’hui « l’imaginaire politique » et « l’imaginaire technologique » des discours
politiques très modernisateurs à un désir commun, social, contemporain, de réinventer le
voyage, les manières de voyager et de se déplacer sur un territoire ou au sein de la ville. Ces
discours modernisateurs s’emparent ainsi très souvent de « l’objet train » pour assimiler
vitesse, déplacement-voyage et territoire : la vitesse devient la notion clé du déplacement et de
la mobilité (on le voit avec toute la rhétorique politique développée sur l’automatisation et la
vitesse du nouveau métro) et la mobilité devient le critère principal de l’inclusion socio-
spatiale. L’idée que la mobilité façonne le territoire tend alors à faire porter la discussion
politique sur des enjeux liés à la circulation des voyageurs, les modes d'acheminement, les
lieux de convergence (gares), etc. Mais cette idée n’est pour ainsi dire jamais questionnée
dans les processus de décision. Ses présupposés sont inaperçus. Elle agit comme une
évidence, un allant de soi, sans avoir été transformée en problème, en question.
Le débat risque alors de devenir un débat « d’experts » qui focalise l’attention sur des enjeux
qui évacuent toutes les dimensions imaginaires sous-jacentes aux décisions. Il s’agit bien
pourtant d’interroger ces imaginaires pour mieux comprendre ce qui résiste à se dire :
comment en effet les acteurs politiques se représentent le territoire ? Comment cherchent-ils à
le transformer par leurs décisions ? Pourquoi la vitesse et la mobilité (avatars contemporains
du progrès technique) sont devenues pour eux des enjeux majeurs dans l’aménagement du
territoire ? Le monde du ferroviaire est-il en ce sens devenu la clé de voûte de toute l’édifice
imaginaire du territoire ? Comment le ferroviaire vient-il alors légitimer et justifier leurs
décisions ? En recourant à quelle argumentation ?
Interroger les décisions concernant les projets d’aménagement ferroviaire suppose
d’interroger des logiques souterraines, non personnalisables, qui échappent ou dépassent donc
très largement les acteurs du système. Le discours politique peut cependant laisser entrevoir
ces logiques, notamment par ses omissions. Il s’agit donc d’identifier et de problématiser le
plus rigoureusement possible ces différentes logiques qui entrent dans la prise de décision.
Pour ce faire, il s’agit dans l’étude sur le projet du « Grand Paris Express », de mettre en
perspective « l’imaginaire du train » avec « l’imaginaire d’un territoire» dit exemplaire et à
terme d’une « future métropole mondiale ».

4
Dans le cadre de la construction politique des espaces urbains contemporains, l’exploration de
l’imaginaire du train nous conduit ainsi à repenser les articulations entre réseaux de transport
et structures urbaines, espaces de mobilité et politiques territoriales. Comment en effet penser
ces différentes articulations entre transport et territoire ? Territoire et politique ? Politique et
développement de la mobilité ? Mobilité, urbanité et métropole mondiale ? Tous ces éléments
entrent dans la composition des espaces et donc dans la prise de décision politique.
L’inscription concrète, matérielle, spatiale de l’imaginaire du train (choix, formes et finalités
des tracés des chemins de fer) nous invite à questionner l’imaginaire de la ville contemporaine
(des représentations du Grand Paris) avec les formes de collectif qui s’y produisent.
Pourquoi en effet avoir retenu ces tracés-là ? Pourquoi là ? Comment s’expliquer cette
exploitation politique actuelle du mouvement ? De ce nouveau moyen de locomotion ? De
cette circulation en rocade de ce futur réseau d’acheminement des voyageurs ?
L’imaginaire du train nous apparaît indissociable des raisons et des effets de cette inscription
spatiale qu’on pourrait entendre comme un « récit métropolitain » fabriqué, constitué, tissé de
nombreuses significations imaginaires contemporaines.
A l’image de l’archéologie ferroviaire qui fait ressurgir devant nous le dessin des villes
anciennes, à partir de ce que nous pouvons retracer des voies ferrées désaffectées, oubliées,
nos questions sur la spatialisation du Grand Paris (nouvelles représentations, définitions,
délimitations spatiales de la métropole) partent du « tracé » du futur métro pour investiguer
originalement les dimensions imaginaires actuelles de la ville et du train.
C’est un préalable pour comprendre les principaux critères qui entrent dans la décision
politique, à côté des registres habituels de justification : imaginaires politiques au service de la
République (avec la notion d’intégrité du territoire), de l'Intérêt Général (avec la notion de
service public), de la Modernisation et du Sens de l’histoire (avec la notion de progrès), etc.
Nous chercherons ainsi à travers le projet du « Grand Paris Express » à comprendre, à
montrer, comment s’inventent actuellement de nouvelles formes de politiques d'aménagement
du territoire et de conceptions urbaines (récits de mobilité, récit métropolitain, etc.) qui
déterminent fortement l’imaginaire du train.
Nous ne nous limiterons donc pas à une approche réductrice de l’imaginaire, à savoir d’un
imaginaire leurrant, mystificateur qui tend à effacer les vrais enjeux (jeux stratégiques des
acteurs, stratégies politiques, etc.) avec par exemple l’idéalisation des effets supposés des
infrastructures ferroviaires sur le dynamisme des territoires.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%