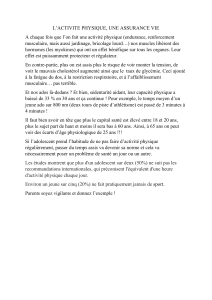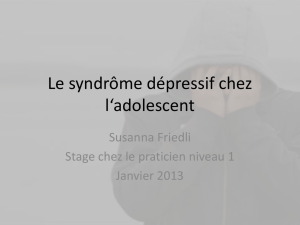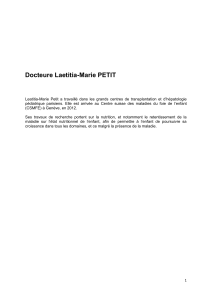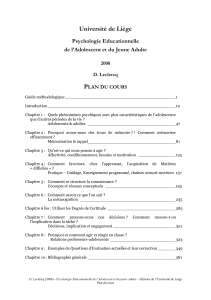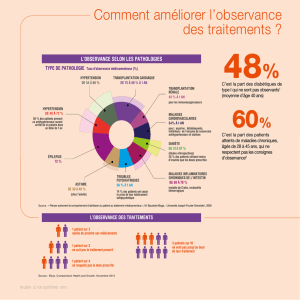thématique D Les enjeux de la “transition”

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
4 - oct.-nov.-déc. 2005
225
DOSSIER
thématique
Les enjeux
de la “transition”
et du “transfert”
après
transplantation
d’organe
Coordinatrice : D. Debray,
service d’hépatologie pédiatrique,
CHU de Bicêtre,
94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex.
◗Les enjeux et les modalités de la transition
J.P. Dommergues
(page 216)
◗L’adolescent et ses soignants face au défi de la maladie chronique
P. Alvin (page 220)
●Adolescence, greffe de rein...
P. Cochat, F. Nobili,V.Vessière, C. Boisriveaud, E. Morelon, H. Desombre
◗Transplantation hépatique : portrait d’un adolescent greffé
F. Lacaille (page 231)
◗Qualité de vie après transplantation rénale à l’adolescence
Ph. Duverger (page 234)
*Département de pédiatrie, hôpital Édouard-
Herriot et université Claude-Bernard, 69437 Lyon
Cedex 03.
** Unité de néphrologie pédiatrique, hôpital Saint-
Jacques, CHU de Besançon, 25030 Besançon.
*** Service de néphrologie et médecine de la
transplantation, hôpital Edouard-Herriot et univer-
sité Claude-Bernard, 69437 Lyon Cedex 03.
Adolescence, greffe de rein...
●
P. Cochat*, F. Nobili**,V.Vessière*, C. Boisriveaud***,
E. Morelon***, H. Desombre*
A
u-delà des particularités com-
portementales, affectives et
somatiques de l’adolescence, la maladie
chronique renforce plusieurs problèmes
spécifiques de cette période charnière.
L’observance est un enjeu à tout âge,
mais elle peut alors se transformer en
défi ; quant aux modalités de la transi-
tion pédiatrie-médecine d’adultes, elles
constituent un des principaux risques du
suivi, et donc du pronostic global (1).
OBSERVANCE
✓Si la “compliance” relève de l’an-
glais,le français utilise le mot “obser-
vance” pour désigner le degré auquel un
patient adhère à la prise en charge que
nécessite son état de santé. Cela inclut
le traitement (médicamenteux ou non),
mais aussi les consultations, les exa-
mens paracliniques, etc. Dans cette
optique, selon le niveau d’exigence
attendu, il est commun de considérer
que 100 % des sujets atteints de maladie
chronique ne sont pas “observants”, quel
que soit leur âge… Mais il convient de
préciser le degré et la nature de cette
non-observance pour en envisager les
retombées et justifier les interventions
les mieux adaptées. Objectivement, la
non-observance est source de morbidité
(rejet chronique, hypertension artérielle,
hyperparathyroïdie, etc.), d’inconfort et
de mortalité ; en outre, elle a un coût
pour la société [traitements de sauvetage,

hospitalisations, consommation de gref-
fons, etc.] (2). Les publications relatives
à la non-observance après transplanta-
tion rénale chez l’enfant évaluent sa fré-
quence entre 8 et 70 %, avec une
moyenne de l’ordre de 40 % (3).
✓La non-observance est un phéno-
mène compréhensible et relativement
naturel. En effet, le degré d’observance
est en relation directe avec les enjeux
qu’elle représente, et c’est bien à ce
niveau que l’adolescent aura un com-
portement différent de celui de l’enfant
obéissant ou de l’adulte autonome. La
soumission et la dépendance inhérentes
aux soins vont à l’encontre du travail
psychique de l’adolescent, qui cherche
activement à conquérir et à faire valoir
son statut. Ainsi, les arguments en
faveur de la non-observance sont poten-
tiellement nombreux : contraintes de la
prise médicamenteuse en elle-même,
nombre de médicaments, nombre de
prises médicamenteuses, rigueur des
horaires, effets indésirables, visibles
(mis en avant dans 25 à 50 % des cas :
obésité, acné et vergetures avec les cor-
ticoïdes, pilosité et hypertrophie gingi-
vale avec la ciclosporine, verrues et
mollusca liées à l’immunosuppression
dans son ensemble) ou non (troubles
digestifs avec le mycophénolate mofé-
til, hypertension artérielle justifiant un
traitement supplémentaire), sapidité de
certains produits, mauvaise acceptation
des formes galéniques, contrainte des
contrôles cliniques et biologiques, limi-
tations diététiques, parfois restriction de
certaines activités physiques, limitation
de l’exposition solaire, lassitude, sensa-
tion d’isolement social, désir d’opposi-
tion parentale, besoin de liberté totale,
questionnements tacites sur l’origine du
greffon en cas de donneur décédé (sexe,
âge, cause du décès), acceptation
contrariée d’une greffe à partir d’un des
deux parents, etc. (4). À cela s’ajoutent
les autres effets visibles et incontour-
nables (retard statural lorsque l’insuffi-
sance rénale est ancienne, cicatrice de la
greffe elle-même, cicatrices abdomi-
nales liées à la malformation causale ou
au cathéter de dialyse péritonéale, cica-
trice de fistule artérioveineuse en cas
d’hémodialyse, anomalies vésicosphinc-
tériennes séquellaires, syndrome mal-
formatif associé au problème rénal,
etc.). Bref, il s’agit de la contrainte
d’être greffé alors que “les autres” ne le
sont pas.
✓L’appréciation de la non-observance
est délicate et les interventions dispo-
nibles pour l’améliorer sont hasar-
deuses. Cependant, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) met à dis-
position des recommandations géné-
rales dont plusieurs peuvent s’appliquer
à la transplantation rénale (5).
✓L’évaluation de l’observance repose
sur deux types de méthodes, directe
(présence/absence à un rendez-vous,
prise du médicament devant un observa-
teur, dosage d’un médicament ou de son
effet biologique) ou indirecte (question-
naire rempli par le patient, comptage
des comprimés, évaluation du réappro-
visionnement, évaluation d’une réponse
clinique attendue, piluliers avec puce
incorporée au couvercle) ; s’y ajoutent
s’ajoutent des éléments subjectifs d’ap-
préciation [entretiens individuels entre
le patient et son référent, évaluation des
effets indésirables, informations four-
nies par les parents] (2). Mais le vécu de
cette évaluation chez l’adolescent peut
aller à l’encontre de l’objectif recher-
ché, et elle se doit d’être adaptée et
expliquée au patient.
✓Il existe des solutions, au moins
partielles, à la non-observance. La
principale consiste à pouvoir établir
avec l’adolescent une relation suffisam-
ment authentique pour que les raisons
de cette non-observance soient identi-
fiées et prises en compte. Il est alors
essentiel de proposer d’aménager cer-
tains horaires pour les prises médica-
menteuses ou les contrôles cliniques et
biologiques, de modifier de manière
transitoire ou définitive des schémas
d’immunosuppression à la demande et,
lorsque la fonction du greffon le permet
(priorité aux schémas d’épargne ou de
suppression des corticoïdes, remplace-
ment de la ciclosporine par le tacroli-
mus du fait de son innocuité cosmé-
tique, remplacement du mycophénolate
mofétil par l’azathioprine, qui est admi-
nistrée en une prise quotidienne et n’en-
traîne pas de trouble digestif, place du
sirolimus à préciser), de traiter efficace-
ment les problèmes dermatologiques.
De même, la reprise de la scolarité après
greffe doit être très rapide, afin que
l’image corporelle ne soit pas trop
modifiée aux yeux de l’adolescent ni au
regard des autres. Toutes ces options
font parfois peur aux cliniciens si elle
ne sont fondées “que” sur la prise en
compte de la non-observance ; en réali-
té, elles permettent souvent d’améliorer
significativement la survie actuarielle
des greffons et la qualité de vie de
l’adolescent ! Il ne faut cependant ja-
mais négliger le contexte de cette non-
observance ; elle peut accompagner un
état dépressif (secondaire aux modifica-
tions physiques, à la désillusion qui
accompagne l’idéalisation incontour-
nable de la greffe, angoisse de mort,
hypertrophie de certains risques post-
transplantation), qui s’exprime souvent
à travers des troubles des conduites ali-
mentaires ou du sommeil, justifiant une
évaluation et une prise en charge spéci-
fiques. On peut en effet observer un pas-
sage à l’acte sous forme de troubles des
conduites alimentaires, de conduites
dangereuses, de troubles du sommeil,
d’automutilation, de comportements
suicidaires. À côté de la dépression
post-transplantation, on peut observer
un état d’appauvrissement psychique,
caractérisé par une inhibition de la
spontanéité et des capacités d’expres-
sion (4). La plupart des adolescents
Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
4 - oct.-nov.-déc. 2005
226
DOSSIER
thématique

transplantés évoluent dans une structure
de soins qu’ils connaissent bien (ser-
vices de néphrologie pédiatrique) et
dont il est important de parler avec eux.
En effet, leur indifférence n’est souvent
qu’apparente, et les événements surve-
nus chez un autre enfant ou adolescent
greffé peuvent être traumatisants ou
encourageants ; il faut donc savoir leur
en parler tout en préservant le secret
médical. L’information doit rester le fil
conducteur du “contrat d’observance” :
les questionnements itératifs et les
menaces de retour en dialyse ne sont
pas souhaitables, et il est préférable
d’expliquer régulièrement le bénéfice
de tel ou tel médicament ou les méfaits
de telle ou telle situation à risque, tout
en restant dans un cadre très général que
l’adolescent sait parfaitement transpo-
ser à sa propre situation. L’information
doit donc être simple, personnalisée et
répétée, en favorisant notamment la
reformulation par l’adolescent lui-
même, cette pratique justifiant souvent
une formation spécifique de la part des
soignants. Afin d’assurer un dialogue de
qualité, il est alors essentiel de fidéliser
l’adolescent auprès d’un référent (médi-
cal ou paramédical) qui doit pouvoir lui
assurer disponibilité et confidentialité,
parfois avec l’aide d’un psychologue ou
d’un psychiatre. À cette période, il est
alors capital que l’adolescent se rende
seul en consultation, afin de reconnaître
sa responsabilité et ses compétences.
Les informations transmises aux parents
inquiets doivent impérativement respec-
ter la confidentialité, faute de quoi la
rupture de confiance adolescent-soi-
gnant pourrait être catastrophique. Il est
par ailleurs important de donner à l’ado-
lescent l’opportunité de pouvoir se pro-
jeter dans l’avenir sans attendre ses
questions, en abordant librement le pro-
blème de la contraception et des mala-
dies sexuellement transmissibles, les
possibilités de grossesse, les éventuels
effets de certains médicaments sur la
fertilité (cyclophosphamide, ganciclo-
vir) ou sur la mutagenèse (mycophéno-
late mofétil), les éventuels risques de
transmission d’une maladie génétique
(contact avec un généticien), les ouver-
tures professionnelles (la nécessité
d’une orientation spécifique ou d’une
réorientation est exceptionnelle, mais
les difficultés d’embauche sont fré-
quentes), les possibilités de chirurgie
plastique en cas de cicatrices mal accep-
tées, etc.
✓Certaines conditions sont connues
pour optimiser l’observance :traite-
ments courts, participation à un essai
thérapeutique, etc. De manière plus spé-
cifique à la transplantation rénale, la
pratique de la greffe préemptive fait
désormais partie des recommandations
et serait une solution idéale s’il n’y avait
pas pénurie d’organes provenant de
donneurs en état de mort encéphalique
(6). Cependant, pour certains praticiens,
l’absence de période “préparatoire” en
dialyse augmenterait le risque de non-
observance après transplantation, no-
tamment chez l’adolescent ; en fait, cela
n’est pas prouvé, et il est donc éthique
de proposer la greffe préemptive chaque
fois que possible et à tout âge.
TRANSITION PÉDIATRIE-MÉDECINE
D’ADULTES
Comme pour toutes les maladies chro-
niques, la transition entre les structures
pédiatriques et les structures d’adultes
n’est pas aisée, précisément en raison
des modifications psychiques et soma-
tiques de l’individu au moment où elle
se produit. Plusieurs facteurs pourraient
plaider pour un maintien dans un envi-
ronnement pédiatrique, comme le non-
achèvement de la croissance, l’existence
d’un retard psychomoteur ou un aspect
physique encore globalement infantile ;
cependant, ces arguments ne sont pas
suffisants par rapport au poids de la
majorité légale et civile. L’âge optimal
est néanmoins difficile à établir, cette
transition n’étant souvent “métabolisée”
qu’au-delà des vingt ans. Les médecins
d’adultes connaissent parfois peu cer-
taines affections (malformations de
l’appareil urinaire, maladies rénales
héréditaires, erreurs innées du métabo-
lisme), et donc le vécu qui y est associé.
De leur côté, les pédiatres tardent à res-
ponsabiliser les patients qui approchent
de l’âge adulte et connaissent mal les
problèmes qui émergent (sexualité,
insertion professionnelle, etc.). En pra-
tique, la plupart des équipes françaises
s’accordent pour effectuer ce transfert à
18 ans.
Même si la prise en charge thérapeu-
tique de la greffe est très proche, voire
identique, l’adolescent, dont les rela-
tions étaient personnalisées dans l’équipe
pédiatrique, se retrouve seul et a le sen-
timent d’être un peu abandonné dans un
service où évoluent de nombreux
adultes.
En fait, il est essentiel de faire collabo-
rer les équipes autour de l’adolescent
greffé devenant adulte et, pour cela, plu-
sieurs stratégies méritent d’être
déployées (4, 7).
✓Il convient d’intégrer précocement à
la prise en charge une guidance visant à
préparer le futur adulte et ses parents à
la notion d’autonomie et au travail de
deuil, que concrétise le transfert de
l’adolescent vers un service d’adultes.
✓Par la suite, des réunions régulières
entre les équipes s’imposent pour har-
moniser le fonctionnement global et
minimiser ainsi les différences aux yeux
de l’adolescent et de sa famille
✓Dès l’âge de 15 ou 16 ans, il est sou-
haitable que l’adolescent vienne seul
aux consultations qui ont encore lieu en
milieu pédiatrique, après en avoir expli-
qué soigneusement les raisons à l’inté-
ressé et à ses parents.
Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
4 - oct.-nov.-déc. 2005
227
DOSSIER
thématique
.../...

✓Un an avant la date prévue du trans-
fert, il convient de proposer des consul-
tations “de préparation” au transfert, ce
qui permet à l’adolescent de prendre des
contacts avec l’équipe de médecine
d’adultes tout en retournant dans la
structure pédiatrique pour le suivi et
pour discuter des éventuels problèmes
rencontrés.
✓Après le transfert, il est important de
maintenir un rythme de consultations
spécialisées suffisamment rapprochées
(par exemple tous les deux ou trois mois
pour les transplantations datant de plus
de deux ans), afin de se donner les
moyens de diagnostiquer et traiter un
rejet en temps utile, mais aussi de per-
mettre des entretiens fréquents entre le
jeune adulte et le nouveau référent, qui
doivent apprendre à se connaître et à
établir des liens de confiance.
✓Avant et après le transfert, l’instaura-
tion d’une consultation infirmière crée
un pont entre le suivi du néphrologue et
celui du “psy”, permettant à un soignant
de créer des liens privilégiés, d’établir
une certaine forme de confidentialité, et
d’apporter des conseils adaptés.
✓Il peut être intéressant de compléter
cet accompagnement humain par un
soutien documentaire (livrets, cédé-
roms, sites Internet, DVD, etc.) qui per-
mettra à l’adolescent et au jeune adulte
de revoir par lui-même certains aspects
qui nécessitent des bases théoriques.
Bien géré, ce transfert peut apporter
beaucoup au patient, tant sur le plan
personnel que sur le plan médical. Il
peut s’agir d’un déclic positif qui
conduit vers l’autonomie sous toutes ses
formes. Du côté médical, il convient
cependant de rester prudent et de n’ac-
corder qu’une confiance progressive au
patient, parfois au prix d’une très grande
disponibilité et d’une certaine souplesse,
eu égard à la rigueur de certains proto-
coles thérapeutiques. L’essentiel est que
patient et médecin sachent la vérité et
apprennent à la gérer ensemble en
bonne intelligence.
CONCLUSION
L’adolescence se termine avec la fin des
défis, des incertitudes et des attitudes
provocatrices, lorsque l’apparence phy-
sique le conforte. Cette étape essentielle
de la vie d’un greffé appartient partiel-
lement aux parents, au pédiatre, au
médecin d’adultes, au psychologue, au
psychiatre, à l’infirmière ; elle appar-
tient surtout à l’intéressé, qui n’accorde-
ra sa confiance qu’à ceux qui compren-
nent et acceptent de gérer avec lui cette
période de transition entre maternage,
indépendance et autonomie. ■
R
ÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
1. Alvin P. L’adolescent et l’observance au traite-
ment. J Pediatr Puériculture 2000;13:225-9.
2. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medica-
tion. N Engl J Med 2005;353:487-97.
3. Wolff G, Strecker K, Vester U, Latta K, Ehrich
JHH. Non-compliance following renal transplanta-
tion in children and adolescents. Pediatr Nephrol
1998;12:703-8.
4. Cochat P, Vial M. Transplantation d’organes. In:
P. Alvin, D. Marcelli. Médecine de l’adolescent.
Masson, Paris 2005:293-6.
5. Sabaté E. Adherence to long-term therapies: evi-
dence for action. Geneva: World Health Organi-
zation, 2003. http://www.who.int/chronic_conditions/
adherencereport/en
6.Cochat P, Offner G. European best practice guide-
lines for renal transplantation (Part 2)- Paediatrics
(specific problems). Nephrol Dial Transplant
2002;17(suppl.4):55-8.
7.Watson A. Non-compliance and transfer from pae-
diatric to adult transplant unit. Pediatr Nephrol
2000;14:469-72.
Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
4 - oct.-nov.-déc. 2005
230
DOSSIER
thématique
.../...
1
/
4
100%