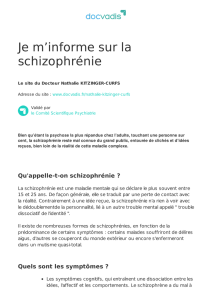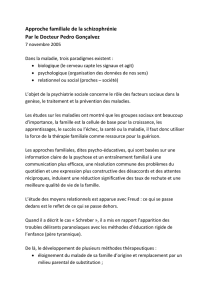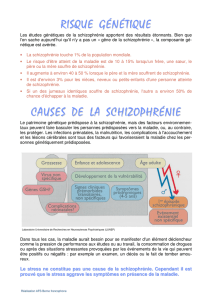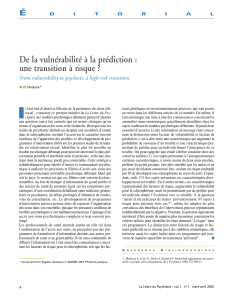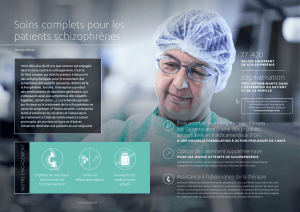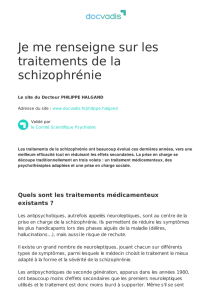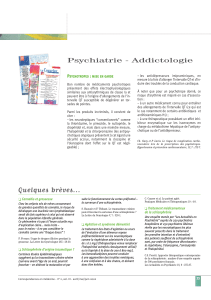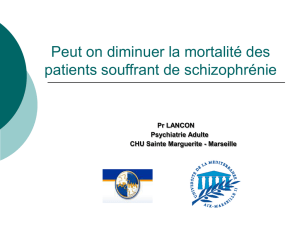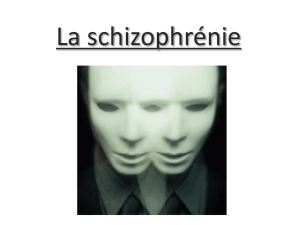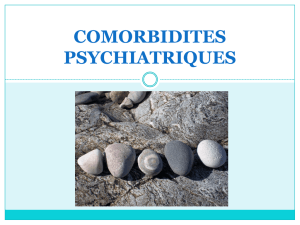Facteurs étiopathogéniques de la schizophrénie acquis D

Dossier thématique
Dossier thématique
164
La Lettre du Psychiatre - Vol. IV - n° 6 - novembre-décembre 2008
Les acquis
Facteurs étiopathogéniques de la schizophrénie
C. Demily*, F. Thibaut**
L’
introduction du concept de vulnérabilité à la maladie
schizo phrénique n’est pas une donnée récente, puisque
E. Kraepelin, en 1896, avait déjà souligné l’existence de
troubles cognitifs prémorbides à la maladie. La grande variabilité
des expressions cliniques et des regroupements syndromiques de la
schizophrénie explique pour une large part pourquoi il s’agit, encore
aujourd’hui, d’une pathologie dont les facteurs étiopathogéniques
sont mal connus. Cependant, loin des querelles idéologiques, un
consensus plaide actuellement en faveur d’un modèle étiopathogé-
nique complexe selon lequel une vulnérabilité génétique combinée
à des facteurs environnementaux pourrait aboutir à l’expression
de la maladie. En effet, on peut supposer que des individus ayant
une vulnérabilité génétique à la schizophrénie vont, en fonction
de leur environnement, développer ou non la maladie ou alors
présenter un phénotype intermédiaire appartenant au spectre de
la schizophrénie, tel qu’un trouble de la personnalité du registre
de la schizotypie. Nous en aborderons les principaux points, mais
notre revue ne saurait, ici, être exhaustive.
Actuellement, l’hypothèse neurodéveloppementale de la schizo-
phrénie – introduite par T. Clouston en 1891 – figure parmi les
modèles les mieux étayés de la littérature. Les données fournies
par l’imagerie cérébrale plaident en faveur de cette hypothèse qui
engendre la notion de “phase de latence” : des lésions cérébrales
survenant au cours du développement pourraient aboutir à la
survenue retardée de symptômes psychotiques. L’hypothèse neuro-
développementale dite “précoce” postule que des perturbations
du développement cérébral pourraient survenir de manière très
précoce au cours de la vie intra-utérine. Des facteurs génétiques
majoritaires pourraient ainsi combiner leurs effets avec des facteurs
environnementaux pré- ou périnataux pour aboutir, in fine et
à l’adolescence, au phénotype “schizophrénie”. À cet égard, des
troubles spécifiques du langage (comme une écholalie) ainsi que
des troubles de la coordination motrice ont été observés chez des
enfants de 4 et 7 ans devenus ultérieurement schizophrènes, mais
leur valeur prédictive reste faible. L’hypothèse développementale
dite “tardive” postule que des dysfonctionnements développemen-
taux affecteraient la maturation cérébrale durant l’adolescence, par
une perturbation de l’élimination des connexions synaptiques en
excès ou par des processus anormaux de myélinisation. Une étude
princeps prospective menée en imagerie fonctionnelle chez des
sujets vulnérables à la schizophrénie, et en ayant effectivement déve-
loppé une ultérieurement, atteste du caractère évolutif des lésions
cérébrales mises en évidence, qui atteignaient la substance grise des
régions parahippocampique, orbitofrontale et cérébelleuse.
L’hypothèse neurodégénérative classique de la schizophrénie entraî-
nant une cicatrice du tissu cérébral semble moins séduisante en
raison de l’absence de gliose dans le cerveau des sujets schizoph-
rènes après analyse post mortem. La principale limite de cette
observation est le nombre très faible de sujets inclus dans ce type
d’études. Cependant, la mort cellulaire apoptotique peut entraîner
une disparition silencieuse du neurone, sans réaction gliale ou
inflammatoire. Différentes protéines (de la famille Bcl-2) stimulent
ou au contraire inhibent l’apoptose. Chez les schizophrènes, le taux
de Bcl-2 semble réduit au niveau du cortex temporal et pourrait
rendre ainsi le cerveau de ces sujets plus sensible aux phénomènes
d’apoptose. De plus, il est désormais acquis que l’administration
de phencyclidine (antagoniste des récepteurs glutamatergiques
NMDA) exerce une excitotoxicité sur le tissu cérébral et permet de
produire des symptômes schizophréniques chez des sujets sains.
B.A. Morel, après la description de “l’idiotie acquise des jeunes
gens”, fut l’un des premiers auteurs à discuter l’idée que les
psychoses puissent être héréditaires. Toutes les études d’agrégation
familiale attestent de l’existence d’une concentration familiale de
la schizophrénie, sans transmission mendélienne identifiable.
Le risque de présenter la maladie pour les frères et sœurs (9 %)
et les enfants (13 %) de patients schizophrènes est environ dix
fois supérieur à celui de la population générale. Les études de
jumeaux aident à caractériser la composante génétique de la
maladie schizophrénique. Elles mettent en évidence une concor-
dance morbide pour la maladie plus élevée chez les monozygotes
(40 à 70 %) que chez les dizygotes (15 %). L’importance du facteur
génétique dans la transmission de la maladie est conforté par les
études d’adoption, puisque les enfants adoptés de parents biolo-
giques schizophrènes ont un risque accru (5,6 %) de développer
une schizophrénie par rapport aux enfants adoptés de parents
biologiques non schizophrènes (0,9 %).
Deux types de méthodes sont utilisés classiquement en génétique
pour localiser et identifier les gènes impliqués dans le détermi-
nisme d’une maladie : les études de liaison et les études d’asso-
ciation. À ce jour, pour la schizophrénie, aucune de ces stratégies
usuelles n’a permis d’identifier de manière reproductible l’existence
d’un gène majeur transmis selon un modèle mendélien classique.
L’hypothèse d’un modèle de transmission polygénique multifac-
toriel paraît donc beaucoup plus plausible : un grand nombre de
gènes combinent leurs effets avec la composante environnemen-
tale pour créer le phénotype “schizophrénie”. Face à la complexité
de ce type de modèle, il s’avère donc nécessaire de développer
des stratégies alternatives de recherche en génétique.
* Service hospitalo-universitaire du Pr Terra, centre hospitalier Le Vinatier, Bron ; ** Service hospi-
talo-universitaire de psychiatrie, hôpital Charles-Nicolle, Inserm U614, UFR de médecine, Rouen.
PSY 6 nov.-déc. 08.indd 164 17/12/08 11:33:59

Dossier thématique
Dossier thématique
165
La Lettre du Psychiatre - Vol. IV - n° 6 - novembre-décembre 2008
Faits nouveaux
Un des premiers écueils auquel se heurtent les stratégies
classiques en génétique est la complexité à considérer dans son
entièreté le phénotype “schizophrénie”. Il semble donc impératif
de “démembrer” cette entité si complexe. Les endophénotypes
sont des marqueurs phénotypiques associés à la maladie et
mesurables, présents chez les sujets schizophrènes et leurs
apparentés. Ils obéissent parfois à un mode de transmission
génétique plus simple et identifiable.
L’étude simultanée de plusieurs marqueurs électrophysio-
logiques, répondant aux critères des endophénotypes, semble
être une perspective novatrice intéressante. Dans cette optique,
une étude récente a combiné trois paradigmes : l’enregistre-
ment de l’onde P50 des potentiels évoqués auditifs (qui permet
d’évaluer les capacités de filtrage sensoriel des patients schi-
zophrènes), le paradigme des antisaccades lors de l’étude des
mouvements oculaires (qui nécessite l’intégrité des cortex
pariétal et préfrontal) et la poursuite oculaire lente dans une
population de 81 sujets schizophrènes, 25 apparentés et 60 sujets
contrôles. Le paradigme de l’onde P50 et celui des antisaccades
semblent puissants pour distinguer les sujets schizophrènes,
leurs apparentés et les témoins.
L’analyse des remaniements chromosomiques semble également
être une stratégie plus intéressante dans l’étude de la génétique
de la schizo phrénie. En effet, lorsque dans l’expression phénoty-
pique d’un réarrangement chromo somique connu et identifiable
se manifeste une augmentation de la fréquence des symptômes
schizophréniques, il semble judicieux d’envisager que cette
région puisse contenir un ou des gènes impliqués dans la schizo-
phrénie. L’implication du chromosome 22 dans le déterminisme
de la schizophrénie a été suggérée par la comorbidité fréquente
entre syndrome de DiGeorge et symptômes schizophréniques.
Les sujets DiGeorge ou atteints du syndrome vélo-cardio-facial
présentent une délétion hétérozygote de la région 22q11 entraî-
nant un phénotype particulier (dont une dysmorphie faciale et
des anomalies cardiaques), associé à des symptômes schizo-
phréniques dans 25 à 35 % des cas. Plusieurs études génétiques
portant sur les gènes de cette région ont été menées, révélant
l’association de certains polymorphismes avec la schizophrénie.
Certaines variations du gène PRODH (codant une enzyme de
dégradation de la proline) sont associées à une hyperprolinémie
retrouvée de manière significative chez les sujets présentant un
trouble schizo-affectif. Le gène COMT, situé également dans la
région 22q11, code la cathécol-O-méthyltransférase, enzyme
de dégradation des catécholamines, notamment de la dopa-
mine. Dans la psychose schizophrénique, le cortex préfrontal
est hypoactivé lors de la réalisation d’une tâche impliquant la
mémoire de travail, en lien avec une hypoactivation des neurones
dopaminergiques mésocorticaux. Les polymorphismes fonc-
tionnels Val/Val et Val/ Met situés en position 108 et 158 de
la COMT correspondent à une activité enzymatique haute,
alors que le polymorphisme Met/ Met correspond à une activité
normale. L’allèle Val serait donc possiblement à l’origine d’un
hypercatabolisme dopaminergique. Plusieurs études d’associa-
tion ont mis en évidence une augmentation de la transmission
de l’allèle Val chez les patients schizophrènes et leurs apparentés
par rapport à une population témoin, et suggèrent que l’allèle
Val aurait un rôle possible de facteur de vulnérabilité dans un
sous-groupe de schizophrénie, mais là encore les données sont
controversées. Une étude plus récente a directement corrélé, et
de manière significative, les performances cognitives, évaluées
grâce au test de Wisconsin, à l’analyse des différents polymor-
phismes fonctionnels du gène COMT dans une population de
sujets sains. Le génotype Val/Val serait corrélé à de mauvaises
performances cognitives au test de Wisconsin.
Cependant, l’existence de facteurs de vulnérabilité génétique
n’est pas suffisante pour développer une schizophrénie. Dans
cette optique, les modèles d’interaction gène/environnement
sont prometteurs dans la détermination de l’étiopathogénie de
la maladie. Parmi les facteurs environnementaux précipitants,
on citera l’exemple du cannabis. Une consommation précoce
(durant la préadolescence) pourrait être associée à un risque
plus important de manifestations psychotiques à l’adolescence.
La majorité des individus consommant du cannabis ne déve-
lopperont pas une psychose, ce qui suggère que certains sujets
pourraient présenter une vulnérabilité génétique aux effets du
cannabis. Dans cette perspective, il a été suggéré que le poly-
morphisme Val158Met du gène COMT puisse opérer comme
un facteur de risque à la psychose dans un contexte environ-
nemental favorisant. Dans une vaste cohorte prospective de
1 037 enfants, les sujets présentant le polymorphisme Val/Val
du COMT ont un risque accru de développer des phénomènes
psychotiques à l’âge de 25 ans (éléments délirants, hallucina-
tions ou trouble schizo phréniforme) lors de la consommation
de cannabis.
La synthèse des données souligne l’existence d’un modèle
complexe, polygénique et multifactoriel de la maladie. Ainsi,
aucun facteur, qu’il soit génétique ou environnemental, n’est
nécessaire ou suffisant pour développer la maladie. On peut faire
l’hypothèse qu’un environnement très délétère puisse engendrer
une schizophrénie chez un sujet à faible risque génétique et que,
réciproquement, chez un sujet à forte vulnérabilité génotypique,
un stress moindre puisse engendrer la maladie. ■
Pour en savoir Plus
Caspi A, Moffitt TE, Cannon M et al. Moderation of the effect of adolescent-
onset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the ca-
thecol-O-methyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X environment
interaction. Biol Psychiatry 2005;57:1117-27.
Louchart de la Chapelle S, Nkam I, Houy E et al. A concordance study of three
electrophysiological measures in schizophrenia. Am J Psychiatry 2005;162:466-74.
ibaut F. Génétique de la schizophrénie. Paris: John Libbey Eurotext, 2003.
PSY 6 nov.-déc. 08.indd 165 17/12/08 11:34:00
1
/
2
100%