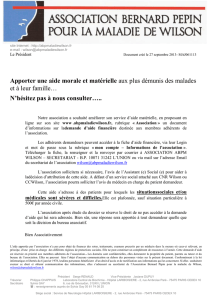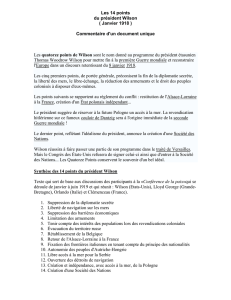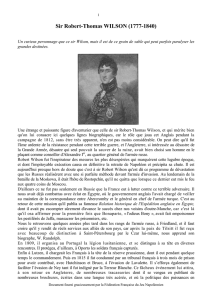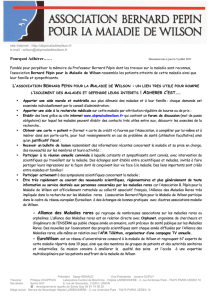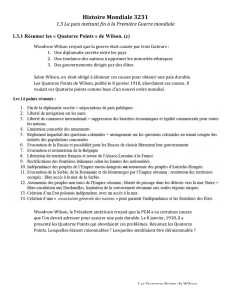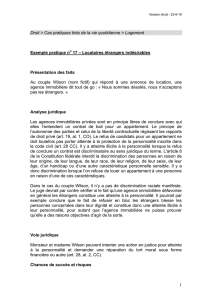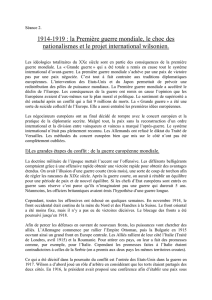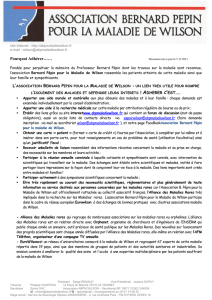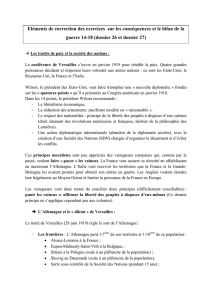Le Monde entre deux guerres (1919-1939)


DU MEME AUTEUR
dans cette collection
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Tome 1 1939-1942
Tome II 1942-1945
HISTOIRE MONDIALE DE L'APRÈS-GUERRE
Tome 1 - Tome II
A 10 000 JOURS DE L'AN 2000
LES 50 AMÉRIQUES
en collaboration avec Stephane Groueff
L'HOMME ET LA MER

RAYMOND CARTIER
LE MONDE
ENTRE DEUX GUERRES
(1919-1939)
PRESSES DE LA CITÉ
PARIS

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'Article 41,
d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part, que les
analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement
de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er de l'Ar-
ticle 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, consti-
tuerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du
Code Pénal.
@ Librairie Larousse, et « Paris-Match » 1974.
@ Presses de la Cité, 1977, pour la présente édition, abrégée.
ISBN 2-258-00316-4

PRÉFACE
L'entre-deux-guerres, c'est le nom que Charles Maurras avait
donné à la période s'étendant de 1871 à 1914. L'expression est un
passe-partout, puisque toutes les nations du monde n'ont jamais
cessé d'être entre deux guerres. Elle avait, cependant, un sens
spécifique. Entre la guerre qui s'est achevée au traité de Francfort
et la guerre qui a commencé quarante-quatre ans plus tard sur les
champs de bataille de Lorraine et de Belgique, il existe un
enchaînement constituant un lien de continuité.
L'enchaînement est encore plus net entre 1914-18 et 1939-45. La
période racontée par le présent ouvrage ne fut en réalité qu'une
trêve dans une nouvelle guerre de Trente Ans.
Pourtant, la tragédie de 1914-18 s'était achevée dans une grande
espérance. Les survivants avaient posé les armes avec la conviction
que l'humanité ne connaîtrait plus jamais les horreurs qu'ils avaient
vécues.
La paix universelle est probablement une chimère. Ce qu'il eût
été possible d'éviter, c'était une seconde grande guerre européenne.
Le moyen d'y parvenir était une réconciliation franco-allemande.
La dureté des traités de paix, l'arbitraire des clauses territoriales,
l'irréalisme des clauses .financières, la méfiance de la France devant
la démocratie allemande s'y opposèrent.
Partant de l'insignifiance, la .figure de Hitler grandit au fil de ce
récit. Les convulsions de l'immédiat après-guerre, l'occupation de
la Ruhr, l'inflation monstrueuse furent les premiers moteurs de son
ascension. Le putsch manqué de 1923 l'amena à comprendre que la
conquête du pouvoir par un coup de main était impossible, et à
mettre au service de son totalitarisme le suffrage universel, principe
sacré de la démocratie. Les historiens ne peuvent plus l'étudier sans
reconnaître l'astuce, la patience, l'intelligence politique profonde
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
1
/
55
100%