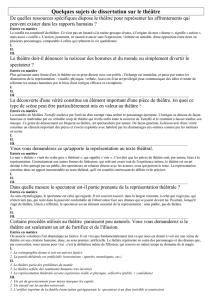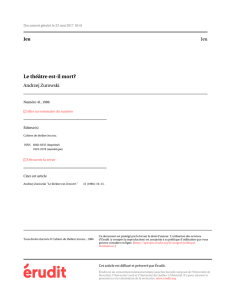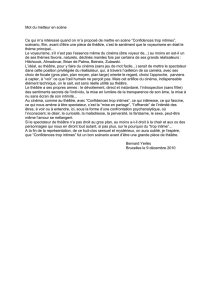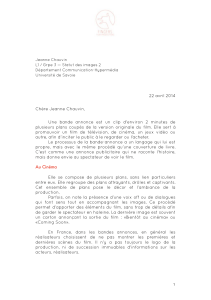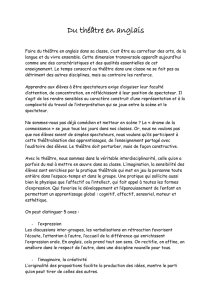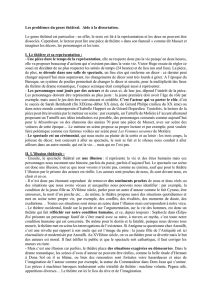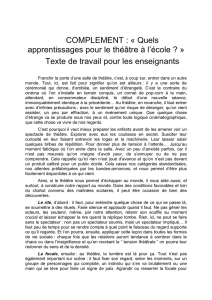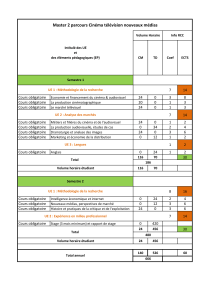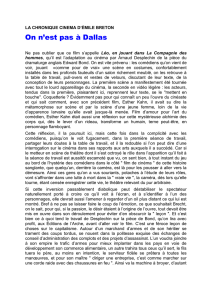théories et pratiques sémiotiques

théories
et pratiques
sémiotiques

est un périodique publié par le Département des Arts et Lettres
de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ce département regroupe des
professeurs qui font de l’ensei gnement et de la recherche en littérature,
en arts visuels, en linguistique, en théâtre, en cinéma, en langues mo-
dernes, en philosophie, en enseignement du français.
Directeur : Fernand ROY
Adjointe à la rédaction : Michelle CÔTÉ
Assistant à la rédaction : Thomas LAVOIE
Assistant à l’administration : Jacques-B. BOUCHARD
Assistant à la diffusion : Jean-Pierre VIDAL
Responsable du présent numéro : Rodrigue Villeneuve
Page couverture :
Comité de rédaction :
Jacques-B. BOUCHARD, Université du Québec à Chicoutimi
André GAUDREAULT, Université Laval
Eric LANDOWSKI, Groupe de recherches sémio-linguistiques (EHESS)
Thomas LAVOIE, Université du Québec à Chicoutimi
Clément LEGARÉ, Université du Québec à Trois-Rivières
Paul-Chanel MALENFANT, Université du Québec à Rimouski
Fernand ROY, Université du Québec à Chicoutimi
Fernande SAINT-MARTIN, Université du Québec à Montréal
Maryse SOUCHARD, Université du Québec à Montréal
Jean-Pierre VIDAL, Université du Québec à Chicoutimi
ABONNEMENT (3 numéros/année)
INDIVIDUEL
Canada : 25$ (12$ pour les étudiants)
CHAQUE NUMÉRO
Canada : 10$ (5$ pour les étudiants)
États-Unis : 12$
Autres pays : 13$
Mode de PAIEMENT :
ou mandat-poste : en dollars canadiens
Chèque (tiré sur une banque canadienne)
États-Unis : 30$
Autres pays : 35$
INSTITUTIONNEL
Canada : 30$
États-Unis : 40$
Autres pays : 45$
Corbus Design. Photo de Marick Boudreau :
, Les Petites Filles aux allumettes, Théâtre Corona, Montréal.
est un périodique publié trois fois l'an par le Département des Arts et Lettres de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ce
département regroupe des professeurs qui font de l’ensei gnement et de la recherche en littérature, en arts visuels, en linguistique,
en théâtre, en cinéma, en langues modernes, en philosophie, en enseignement du français.
Comité de lecture* :
Denis BELLEMARE, Université du Québec à Chicoutimi
Paul BLETON, Téluq
Marcel BOUDREAU, Université Laval
Enrico CARONTINI, Université du Québec à Montréal
Gilbert DAVID, Université de Montréal
Louisette GAUTHIER-MITCHELL, Université du Québec à Montréal
Jean-Guy HUDON, Université du Québec à Chicoutimi
Suzanne LEMERISE, Université du Québec à Montréal
Pierre MARTEL, Université de Sherbrooke
* La revue fait aussi appel à des lecteurs spécialistes
selon les contenus des dossiers thématiques et des articles reçus.
Distribution : Diffusion Parallèle, 815, rue Ontario Est, Montréal,
Québec, H2L 1P1, (514)525-2513
PROTÉE est membre de l'Association des éditeurs de périodiques
culturels québécois
Les textes et illustrations publiés dans cette revue engagent la responsa-
bilité de leurs seuls auteurs. Les documents reçus ne sont pas rendus et
leur envoi implique l’accord de l’auteur pour leur libre publication.
est subventionnée par le Fonds FCAR, le CRSH,
la Fondation de l’UQAC, le PAIR (aide à la publication)
et le Département des Arts et Lettres de l’UQAC.
Serge Tremblay, imprimeur inc., 109, rue Bossé, Chicoutimi (Québec)
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN-0300-3523

Présentation
Une épine dans l'œil
Conversations d'amoureuses
Les ruines de l'image
L’image en majesté
Les îles incertaines
l’objet de la sémiotique théâtrale
Du kabuki au cinéma
Le théâtre au cinéma :
prolégomènes à une non-comparaison
à propos du Tartuffe de Murnau
Quelques condamnés à mort
se sont échappés
à propos du spectateur du Bord extrême
La performance
ou le refus du théâtre
Pour une pédagogie
de l'invisible
Un miroir étrange
à propos de Felütés
Impressions sur impressions
photographiques
entretien avec Robert Lepage
L'acteur plus grand que nature
entretien avec Alice Ronfard
CHAQUE NUMÉRO
Canada : 10$ (5$ pour les étudiants)
Mode de PAIEMENT :
est un périodique publié trois fois l'an par le Département des Arts et Lettres de l’Université du Québec à Chicoutimi. Ce
département regroupe des professeurs qui font de l’ensei gnement et de la recherche en littérature, en arts visuels, en linguistique,
en théâtre, en cinéma, en langues modernes, en philosophie, en enseignement du français.

2
UNE
ÉPINE
DANS
L'OEIL
Dans
le
théâtre
de
Pina
Bausch
l'image
est une
épine
dans
l'oeil,
les
corps
écrivent
un texte qui
se
refuse
à
la
publication,
à
la
prison
de
la
signification.
Heiner
Müller, Erreurs choisies
L'image
peut
empêcher
de
voir; elle
peut
blesser, si bien qu'il est alors impossible
de
la
traduire,
de
la réduire
au
sens. Elle
ne
conduit nulle part, elle
ne
remplace rien, ne s'échange
contre rien, serait-ce mille mots. C'est l'image rte, l comble
de
l'image, semble dire
Müller,
"une
épine
dans
l'oeil".
C'est précisément l'image comme signe que ce numéro
de
Protée
sur
les "images de la
scène" pose
d'abord
comme question,
ou
met
en
question. Encore
une
fois, dira-t-on.
Pourtant il
s'en
faut
que
les travaux, ces vingt dernières années, des diverses sémiotiques
(et
au
premier chef
de
la sémiotique
du
"langage visuel"), l'aient résolue.
On
doit supposer
qu'elle reste vive
pour
que, sans programme, elle se trouve
au
centre ou
en
filigrane
de
la
plupart
des textes qui sont réunis ici.
D'autre part, elle se pose
au
théâtre et à propos
du
théâtre de façon
...
"théâtrale", c'est-à-dire
qu'on
y observe comme
une
hystérisation de la question. De là l'intérêt peut-être
de
la
considérer
de
nouveau. Elle est
pour
ceux qui font le théâtre, comédiens et metteurs
en
scène
d'abord,
au
coeur
d'une
pratique où on oscille, depuis la fin
du
XIX"
siècle, entre le rêve
d'une
représentation qui s'abolit et celui
d'une
représentation qui se suffit (ou s'exalte) comme
telle.
Pour
le spectateur aussi, l'usage des images est une question
de
"vie
ou
de mort", qu'il
doive la trancher sans arrêt
de
son fauteuil, sans cesse sollicité,
ou
qu'à
son insu, après, la
mémoire y travaille.
Récemment, Peter Zadek déclarait: "Le théâtre est affaire d'images et
de
comédiens". Au
théâtre
en
effet tout se passe
sur
la scène, ou, si
on
préfère, le spectacle s'énonce sans cesse
et il n'existe
que
dans
et lors
de
cette énonciation.
Il
constitue, comme n'importe quelle
"manifestation signifiante",
un
appel à la discursivité mais doté
d'un
caractère beaucoup
plus pressant. L'image à laquelle ce numéro s'arrête d'abord, ce n'est donc
pas
celle de la
scène, mais celle
que
produisent après l'expérience écrivains, photographes, vidéastes, sans
doute
d'abord
parce que, comme l'écrit Pierre Sullivan, "l'image vous autorise". Elle déçoit
toujours, mais
on
ne
saurait s'en passer.
Les
ruines
de
l'image
proposent la fiction - la
tentation
-
d'un
sujet qui voudraitfaire l'économie de la médiation des images.
Le
voyageur
palerrnitain frôle ainsi la mort(ou la folie, ou la maladie). Mais
il
est aussi suggéré qu'il existe
certains points, des
passages, où
il
serait possible parfois de se tenir sans images: le cabinet
pour
l'analyste, la scène
pour
l'acteur.
Nous
voilà revenus à ce lieu,la scène, que Jean Gillibert
(L'image
en
majesté)
définit, contre
la "panoptique totalisante" que serait devenu aujourd'hui l'exercice
de
la mise
en
scène,
comme
un
lieu d"'ouverture d'image"
pour
l'acteur (de "mise en danger",
de
"mise
en
sacrifice")
qu'aucun
signe
ne saurait combler.

C'est
entre ces
deux
pôles, le réel scénique qui est
toujours"
excès
de
l'image"
et
le réel aban-
donnique
du
spectateur qui est toujours insuffisance
de
l'image,
que
se situent les articles
de
ce
numéro.
Rodrigue Villeneuve
veut
montrer,
en
un
long parcours,
que
par
delà
"l'insoutenable
déception" (Sullivan)
qu'apportent
restes, traces et images
du
spectacle, ils
disent
"vrai",
supportés
par
la mémoire.
Dans
cette optique, il était aussi normal
que
des
collaborateurs se
demandent
quel secours
on
pourrait
attendre
du
cinéma
pour
conserver
les images
de
la scène, voire
pour
définir le théâtre
ou
interroger son fonctionnement.
Claude
R.
Blouin se livre ainsi à
une
étude
minutieuse des
rapports
entre le
kabuki
et le
cinéma japonais,
où
l'on
voit les risques
que
court le cinéma à
rapporter
le théâtre. Patrice
Pavis
cherche
dans
le Tartuffe
de
Murnau
des figures
de
ce
que
pourrait
être la théâtralité,
alors
qu'à
l'inverse Irène Perelli-Contos se penche
sur
un
spectacle,
le
Bord extrême, qui
prend
son
point
de
départ
dans
un
film
de
Bergman
et
qui
lui semble déstabiliser le
spectateur
en
inversant les pôles
de
la communication théâtrale.
La question
que
Josette Féral pose à la performance
qui
serait "refus
du
théâtre", celle
de
la
frontière entre le réel
et
la représentation, est encore
une
question
de
spectateur. Seul Larry
Tremblay ose passer
du
côté
de
l'acteur,
pour
proposer
une
"pédagogie
de
l'invisible"
où
serait cernée cette
part
du
travail
du
comédien qui précéderait l'image.
***
Heiner
Müller écrit
encore:
"Ce qui reste c'est ce
qui
est fugitif. Ce
qui
a pris la fuite
demeure"
(Erreurs choisies).
D'où
le cadre
qu'on
a
voulu
donner
à ce
numéro:
celui
du
vieux théâtre Corona, "repris",
si
on
peut
dire,
par
Martha Flemming et Lyne Lapointe,
et
photographié
par
Marick
Boudreau.
Non
pas
par
goût
des
ruines, mais parce
qu'au
contraire
un
tel lieu
nous
semblait
réconcilier les
deux
pôles
dont
nous
parlions,
en
situant le regard
sur
le spectacle passé, le
regard
en
arrière -qui,
on
le sait
depuis
l'histoire
d'Orphée,
peut
tuer
-
dans
un
rapport
obligé avec le théâtre à faire, le théâtre
qui
ne
peut
toujours
qu'être
à venir.
D'où
aussi la
part
qui
est faite à l'intervention
de
certains metteurs
en
scène (Erzsébet Gaal,
Robert Lepage, Alice Ronfard), déjà ailleurs,
qu'on
a
voulu
retenir
un
peu.
***
Il
n'y
a
pas
lieu
de
s'étonner enfin
de
ne pas trouver
dans
ce
numéro
de
traces
du
combat
que
peut-être
son
titre laissait présager entre l'image
etle
texte.
Il
n'est
pas
question ici
du
théâtre
d'images,
dont
certains voient avec inquiétude la prolifération actuelle, mais
des
images
du
théâtre et des images
au
théâtre (ces images
pouvant
être-devant
être même?
-des
éléments
textuels,
comme
le
montre
Jean Gillibert).
Tout
retour
du
balancier
qui
prendrait
la forme
d'une
nouvelle
"fureur
iconoclaste" ne
pourrait
faire oublier
qu'on
ne
se débarrasse
pas
des
images.
Un
peu
mieux peut-être
de
celles
qu'on
dit
nous
submerger, publicitaires, télévisuelles; moins bien de celles
qu'on
dévore
au
cinéma,
ou
de
l'l'aura"
de
certaines photographies,
ou
du
tableau qui
nous
a cloué
dans
la
salle
du
musée
qu'on
parcourait distraitement. Ces images, peut-être,
nous
sauvent.
Comme
nous
sauve
quelquefois, trop rarement, la scène
que
l'on
regarde.
Rodrigue Villeneuve
Université
du
Québec à Chicoutimi
3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
1
/
94
100%