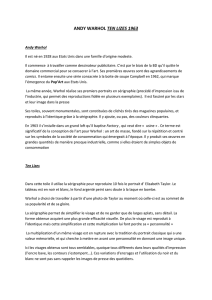L`édition théâtrale fait salon

Fondateurs : Jacques Decour (1910-1942), fusillé par les nazis, et Jean Paulhan (1884-1968).
Directeurs : Aragon (1953-1972), Jean Ristat.
Les Lettres françaises
du 9 mai 2009. Nouvelle série n° 59.
Appel pour les
Lettres françaises
L’édition théâtrale fait salon
par Pierre Banos, Jean-Pierre Han
et Jean-Pierre Siméon
Le noir dans l’art contemporain
par Christine Buci-Glucksmann, Gianni Burattoni,
Didier Laroque, Principe Laval et Gérard-Georges Lemaire.
Lettre à Gabriel Matzneff, par Franck Delorieux.
Late Night Story
, de Mark Brusse, tempera et pastel à l’huile sur papier marouflé sur toile. 2005.
DR

Les Lettres françaises
. Mai 2009 (supplément à
l’Humanité
du 9 mai 2009) . II
SOMMAIRE
Les Lettres françaises,
foliotées de I à XVI
dans
l’Humanité
du 9 mai 2009.
Fondateurs : Jacques Decour, fusillé par les nazis,
et Jean Paulhan.
Directeurs : Aragon puis Jean Ristat.
Directeur : Jean Ristat.
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Han.
Secrétaire de rédaction : François Eychart.
Responsables de rubrique : Gérard-Georges Lemaire (arts),
Claude Schopp (cinéma), Franck Delorieux (lettres),
Claude Glayman (musique), Jean-Pierre Han (spectacles),
Jacques-Olivier Bégot et Baptiste Eychart (savoirs).
Conception graphique : Mustapha Boutadjine.
Correspondants : Franz Kaiser (Pays-Bas),
Fernando Toledo (Colombie), Gerhard Jacquet (Marseille),
Marc Sagaert (Mexique), Marco Filoni (Italie), Gavin Bowd (Écosse),
Rachid Mokhtari (Algérie).
Correcteurs et photograveurs : SGP
164, rue Ambroise-Croizat, 93528 Saint-Denis CEDEX.
Téléphone : (33) 01 49 22 74 09. Fax : 01 49 22 72 51.
E-mail : [email protected].
Copyright
Les Lettres françaises
, tous droits réservés.
La rédaction décline toute responsabilité
quant aux manuscrits qui lui sont envoyés.
Retrouvez
les Lettres françaises
le premier samedi de chaque mois.
Prochain numéro : le 6 juin 2009.
Mark Brusse : (en couverture). Page I
L’appel des
Lettres françaises
(édito). Page II
Jean-Pierre Han : Une fête théâtrale bien particulière. Page III
Jean-Pierre Siméon : Pour un théâtre de poésie. Page III
Jean-Pierre Han : Une réussite éditoriale. Page III
Pierre Banos : L’édition théâtrale dans tous ses états. Page IV
Jean-Pierre Han : Une vraie critique de combat. Page IV
Le Chapelier Fou… : Un sursaut de vie. Page V
Jean-Pierre Han : Parcours pluriels et singuliers. Page V
Jean-Pierre Han : Un manifeste en forme de biographie. Page V
Jean-Pierre Han : Prises de paroles. Page VI
Jean-Pierre Han : La folie Feydeau. Page VI
Olivier Barbarant : Tout un volcan vocalisé. Page VI
Franck Delorieux : Lettre à Gabriel Matzneff. Page VII
Jean-Louis Panné, Antoine Jaccottet : La littérature
dans son essence même (entretien). Page VIII
Marianne Lioust : L’écrivain et son double. Page VIII
Jean-Pierre Han : Une mise en perspective. Page VIII
Gérard-Georges Lemaire : Prague et ses fantômes… Page IX
François Eychart : La dure conquête de la force. Page IX
Françoise Hàn : Voyage réel, voyage rêvé (chronique). Page X
Jane L. September : Belinda Cannone et le bruissement
du monde. Page X
Jean-Claude Hauc : Une édition critique de
Bachaumont.
Page X
Baptiste Eychart : À la croisée des subversions :
Philippines et Espagne au tournant du siècle. Page XI
Jacques-Olivier Bégot : Du bon usage de l’idéologie. Page XI
Jacques-Olivier Bégot : Le lecteur Althusser. Page XI
Giorgio Podestà : Wahrol, d’Elvis Presley à Mao,
en passant par Marilyn. Page XII
Michel Bulteau : Warhol sans confession. Page XII
Giorgio Podesta : Kandinsky, le peintre errant. Page XII
Christine Buci-Gluksmann, Gérard-Georges Lemaire :
La peinture à l’enseigne du noir absolu (entretien). Page XIII
Gianni Burattoni : Pas si noir que ça... Page XIII
Didier Laroque : Le noir comme dénuement. Page XIV
Principe Laval : Le noir selon Bernard Ollier. Page XIV
Clémentine Hougue : Photographie métamorphe
(la boîte à pixels). Page XIV
Claude Schopp : Journal du cinémateur (chronique). Page XV
José Moure : Trois films de(s) Straub. Page XV
Claude Schopp : Un morceau d’érotisme anthologique. Page XV
José Moure, Gaël Pasquier, Claude Schopp : Filmer l’invisible.
Page XVI
Claude Glayman : Jean-Luc Choplin : le Châtelet,
popu et sophistiqué. Page XVI
ÉDITO
Pour que vivent
l’Humanité
et
les Lettres françaises
Les Lettres françaises
sont actuellement en pé-
ril, comme toute la presse démocratique. Ce
péril ne concerne bien sûr pas la qualité des
articles des
Lettres,
il vient des conditions écono-
miques qui régissent aujourd’hui la possibilité de
faire vivre un journal indépendant de la grande fi-
nance. En un mot, du capital.
Nos lecteurs savent que
les Lettres
n’ont pu être
relancées et ne vivent que grâce à l’appui généreux
de la direction et du personnel de
l’Humanité
. Sans
cet appui, bien que nous soyions tous bénévoles, rien
n’aurait pu être fait. Et depuis cinq ans que
les
Lettres
ont reparu, nous avons toujours pu publier
très exactement le journal que nous voulions, sans
aucun problème. Cette générosité que nous avons
plaisir à reconnaître est un fait rare dans la presse,
surtout depuis que les turbulences économiques et
financières ont pris l’importance que l’on sait.
Nous avons conscience que
les Lettres françaises
ne sont pas une publication comme bien d’autres.
Elles sont un condensé de l’histoire intellectuelle de
notre pays, dans ce qu’elle a de cruel et de magni-
fique. Rien ne pourra jamais retirer le poids que
confère leur fondation en 1941 dans la clandestinité,
le sacrifice de Jacques Decour et les périls sans fin
qu’assumèrent ceux qui lui succédèrent à leur direc-
tion. C’est sans doute à cause de tout cela que
les
Lettres françaises
ont su porter si haut le combat de
l’intelligence française contre la barbarie de
l’époque. Plus tard, sous la direction d’Aragon, elles
ont joué un rôle de premier plan pour faire connaître
les tendances culturelles nouvelles. Elles ont aussi
poussé dans les années 1960 et 1970 à l’émancipation
du Parti communiste et à sa réinsertion dans la vie
culturelle française. Ces faits font partie de l’histoire
intellectuelle du XXesiècle. Ils nous rappellent que,
même si la culture n’est pas indépendante de la po-
litique, toute perspective politique repose sur une vi-
sion de l’avenir et que la culture, celle du passé
comme celle qui se fait, constitue un élément irrem-
plaçable pour saisir les sensibilités nouvelles qui vont
influer sur cet avenir. C’est pourquoi, mois après
mois,
les Lettres françaises
s’attachent à mettre au
jour ces sensibilités et à les restituer dans l’histoire
culturelle de notre pays. Nous avons l’ambition de
faire des
Lettres
un élément précieux pour tous ceux
qui n’ont pas désespéré de conquérir l’avenir.
Ce n’est pas seulement parce que
l’Humanité
nous a donné jusqu’à ce jour les moyens de notre
existence que nous nous engageons résolument
dans le combat pour que ce journal vive. Sur le
fond, nous pensons que nul ne peut accepter la dis-
parition d’une voix aussi essentielle au pluralisme
et au combat démocratique sans mettre en péril ce
en quoi il est le plus attaché. Nous savons que ce
sont les lecteurs de
l’Humanité
qui lui donneront
les moyens de vivre. Mais nous savons aussi que
les lecteurs des
Lettres
ne peuvent pas davantage
accepter l’étouffement qui menace. Ils ont un rôle
spécifique à jouer pour soutenir la parution des
Lettres.
Nous les appelons à adhérer à l’associa-
tion les Amis des Lettres françaises et à la soutenir
financièrement. Tous les fonds qui seront réunis
seront versés à la trésorerie de
l’Humanité
. La ba-
taille qui commence a pour enjeu le maintien des
idées de progrès, de justice, la transformation réus-
sie de la société actuelle en une société plus juste,
libérée de la dictature du capital, rejetant la culture
de divertissement qu’on veut imposer au plus
grand nombre ou les formes faussement trans-
gressives ou élitistes qui sont réservées aux autres.
La disparition des
Lettres françaises,
qui antici-
perait celle de
l’Humanité,
serait la destruction
d’un symbole historique et une défaite importante.
Le Conseil de rédaction
des
Lettres françaises
Appel
pour
les Lettres françaises
Je soutiens l’association Les Amis des Lettres françaises
Je verse :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. : Mail :
Chèque à libeller à l’ordre de l’association Les Amis des Lettres françaises et à envoyer aux
Lettres françaises
164, rue Ambroise-Croizat, 93528 Saint-Denis Cedex

Les Lettres françaises
. Mai 2009 (supplément à
l’Humanité
du 9 mai 2009) . III
ÉDITIONS THÉÂTRALES
Pour un théâtre de poésie
Il y a mille façons de faire du théâtre. Et c’est
tant mieux. C’est tant mieux jusqu’à un certain
point, le point d’abandon et de déni où le
théâtre est avalé par le « spectacle vivant ». Je veux
un mal de mort à cette appellation de « spectacle
vivant » d’abord parce qu’elle est stupide (mon-
trez-moi un spectacle mort), ensuite parce qu’elle
inaugure une catégorie
insensée
(le foot,
la Star Ac,
et la soirée Miss France sont du spectacle vivant,
stricto sensu). Je tiens que dans la confusion men-
tale, la seule sauvegarde est de réaffirmer des idées
claires. Ma première idée claire est que le théâtre
n’a de justification que si, quelles que soient ses in-
nombrables métamorphoses, il reste, en demeurant
théâtre, ce qui n’a pas d’équivalent dans la multi-
tude des manifestations humaines. Or qu’est-ce
qu’offre le théâtre qui n’ait pas aujourd’hui d’équi-
valent ? Le partage collectif du poème dans une as-
semblée ouverte et laïque. Mais pas le spectaculaire
(effets visuels, images d’esthètes, déploiement scé-
nographique, machineries en tout genre) qui lui est
certes lié depuis l’origine et dont on a un appétit
compréhensible puisqu’il procure du plaisir, mais
qui triomphe partout et dans tous les domaines et
avec de plus raffinés moyens hors des théâtres. Voici donc ma
deuxième idée claire : le théâtre n’a de nécessité aujourd’hui que
s’il revendique son archaïsme et manifeste un contre-pied cri-
tique face aux modes dominants des représentations du monde.
Un théâtre selon ce principe : clarté et « distinction » comme le
préconisait Roland Barthes, au service de l’intensité et du pou-
voir de suggestion de la parole (par exemple, le
Coriolan
mis en
scène par Schiaretti). Ma troisième idée claire est que le théâtre
n’a d’utilité que dans une intention générale et déterminée
d’éducation populaire. Que des citoyens se rassemblent volon-
tairement pour mettre en débat leur propre compréhension de
la réalité à travers le poème aux seules fins de l’émancipation
individuelle et collective que cette mise en débat favorise, cela
ne peut avoir de motivation qu’éthique et politique. Sinon
quoi ? Bras d’honneur à qui prétend, dans le présent contexte
d’une humanité pour les trois quarts en déshérence, user de l’ar-
gent public pour exhiber son génie propre ou simplement si-
gnifier dans un désert de médiocrité la permanence sacrée de
l’intelligence et du beau. En bref, nous n’avons que faire d’un
talent théâtral qui ne soit pas
pour l’autre
, non comme un dé-
sir, qui n’est que posture, mais en actes.
Maintenant, l’essentiel : les partis pris que je viens d’expo-
ser tiennent tout entiers à deux convictions préalables qui leur
donnent sens et validité : nous avons un besoin urgent de
poèmes et le théâtre est le lieu destiné dans la cité à la promul-
gation du poème. Mais entendons-nous sur le sens de
« poème » : trop de malentendus ou détournements commodes
(désignation vague, attrape-tout, du texte en jeu, voire de l’idée
créatrice) ont occulté des vérités premières. Il n’y a poème que
s’il y a, non pas seulement texte mais langue, c’est-à-dire langue
présente (des textes de théâtre sans langue, ça existe, n’est-ce
pas ?), consistante, problématique, et impossible hors du
théâtre. Une langue qui par excès (Claudel) ou par défaut (Bec-
kett) fait obstacle. Une langue multipolaire (son, sens, rythme,
images) dont la complexité comme le disait Aragon « exige la
révolte de l’oreille ». Vous voyez : si le théâtre est poétique, il
suscite la « révolte de l’oreille » et restituant ainsi une liberté
perdue il remplit déjà l’essentiel de sa mission. Ce qui est vrai-
ment subversif c’est la langue du poème, pas Stéphane Guillon.
L’un
passe
à la radio, l’autre
ne passe pas
. Bref, nous avons pour
tâche de réarmer en chacun le désir et la compétence du poème,
c’est-à-dire d’une langue complexe, polysémique,
dérangée
parce que c’est l’antidote à tous les processus de
simplification, de standardisation et de vulgarisa-
tion des langages à l’œuvre dans le temps présent.
Les gens de théâtre peuvent tout faire, ils ont le ta-
lent et l’antériorité sur tous les faiseurs de spec-
tacles, ils peuvent faire du beau, de l’épatant, du
surprenant, jouer du son, de la lumière, des trappes,
des cordes, de la vidéo et tutti quanti. Ils peuvent
comme les autres raconter des histoires, amuser,
critiquer les mœurs, tenir un propos politique mais
ils sont les seuls à pouvoir et savoir le faire dans la
langue impossible du poème.
Je résume : les besoins du moment désignent,
parmi tous les possibles, le théâtre qu’il nous faut
faire aujourd’hui. Il doit donner à la communauté
ce qui lui manque le plus : une langue libre, hors
normes, seule garantie d’une pensée libre. Il lui
faut l’audace de se redéfinir, coûte que coûte, dans
le poème. Élucider une réalité profuse et confuse
en la passant au crible d’une langue inouïe, c’est
plus que jamais sa raison d’être. Le théâtre doit,
poème dramatique, monologue ou polyphonie,
être un théâtre de poésie ou bien il est condamné
à n’être qu’un avatar supérieur et chic du grand Barnum cul-
turel. Et encore ne le sera-t-il que pour son petit monde à lui,
ses quelques-uns. Un théâtre de poésie absolument, la tâche,
certes, est ingrate puisque, le besoin désignant le manque, c’est
justement au poème que les oreilles de tous sont rétives. Mais
sans cette dissonance assumée, cet anachronisme, si l’on veut,
le théâtre n’a plus de sens. Or si la dissonance surprend, dé-
concerte, agace, elle a aussi un pouvoir de séduction car elle
promet de l’autre et du neuf. Le défi est donc de rendre ac-
ceptable et désirable cette dissonance en veillant à ne pas l’ar-
borer comme la jouissance d’un petit peuple d’élus mais en la
proposant comme une alternative offerte a priori à tous. C’est
où l’on retrouve les enjeux de l’éducation populaire : Copeau,
Dasté, Puaux. Le paradoxe du théâtre d’art qui se veut popu-
laire c’est qu’il s’adresse à l’Autre, au vraiment Autre, qui ne
l’entend pas de cette oreille. Mais il n’a pas le choix, il ne se
justifie que par cet autre : « Le poème veut aller vers un Autre,
il a besoin de cet Autre, il en a besoin en face de lui. Il le re-
cherche, il se promet à lui. » C’est du poète Paul Celan. Ce de-
vrait être l’alpha et l’oméga de notre théâtre.
Jean-Pierre Siméon
Une réussite éditoriale
Seuls,
de Wajdi Mouawad. Éditions Leméac-Actes
Sud. 192 pages, 25 euros
La quadrature du cercle que tentent de
réaliser tous les éditeurs soucieux de
rendre compte non seulement d’un
texte de théâtre, mais aussi de sa dimension
spectaculaire sans avoir recours aux éternelles
illustrations photographiques, les éditions
Actes Sud associées aux Québécois de
Leméac, sous la houlette de Claire David pour
l’occasion, sont en passe de la réaliser avec le
livre de Wajdi Mouawad,
Seuls
. Elles avaient,
en l’occurrence, ces éditions et Claire David,
plusieurs atouts dans la manche. La compé-
tence de l’éditrice, ça va de soi bien sûr, qui
s’ajoute à une grande connaissance du
théâtre, mais aussi le fait que l’auteur en per-
sonne a bien voulu payer de sa personne,
c’est-à-dire travailler à l’élaboration du livre,
et surtout le fait que le texte,
Seuls
, présenté
l’année dernière avec succès au Festival
d’Avignon tourne autour du problème de…
l’écriture, de ses limites, de la quasi-obligation
du personnage qu’il met en scène, de se tour-
ner vers la peinture et la performance pour
parvenir à sa juste expression…
Le texte du spectacle, certes, est présent
mais quasi en fin de parcours, après tout un
cheminement passionnant qui évite avec sub-
tilité tout commentaire oiseux ou universi-
taire. Le décrire serait le réduire et donc le ca-
ricaturer, car on ne peut pas vraiment et seu-
lement évoquer une parole sur l’élaboration
du spectacle lui-même. Nous sommes ailleurs
dans un décalage assez subtil que mène
Wajdi Mouawad et qui ressortit encore et tou-
jours à un acte de pure création !
Seuls
(le livre
donc) porte en sous-titre
Chemin, texte et
peintures
. Voilà qui éclaire un peu mieux la
nature du projet éditorial auquel il faut asso-
cier les noms de Charlotte Farcey, d’Irène
Afker et de Maxence Scherf, qui signe la
conception graphique de l’ensemble avec Wa-
jdi Mouawad.
Une belle réussite qu’il faut saluer, mais
dont on se demande s’il elle pourra être re-
nouvelée avec d’autres artistes, tant celle-ci est
vraiment l’expression d’une réflexion et d’un
travail personnels.
J-P. H.
Une fête théâtrale bien particulière
Voici qu’au moment de réaliser ce petit dossier consacré
au livre de théâtre (la foire Saint-Germain, place Saint-
Sulpice à Paris, qui renaît de ses cendres, nous y
pousse), l’idée qu’il y a là quelque chose de saugrenu vient me
tarauder l’esprit. Un dossier sur le roman, sur l’autofiction,
sur la poésie même, soit… personne n’y trouverait à redire,
mais sur l’édition théâtrale ! Quelle idée (d’ailleurs, allez jeter
un coup d’œil sur les rayons consacrés au théâtre, quand ils
existent, dans les librairies), et pourtant… persistons et si-
gnons !
Il est un fait cependant qu’en France, tout au moins, c’est
même une de nos spécificités, dont nos voisins étrangers se
gaussent volontiers : le théâtre a partie liée de manière intime
à la littérature. Il est non moins vrai que la révolution théâ-
trale majeure du XXesiècle, l’avènement de ce drôle de per-
sonnage qu’est le metteur en scène, a failli être fatale aux au-
teurs et à leurs textes. L’ère de la représentation, la préémi-
nence de la réalité du plateau ont beau être très légitimement
mises en avant, rien n’y fait. Il est, et il sera toujours question
d’écriture, de texte et de… poésie – très particuliers, je n’en
disconviens pas, mais de texte et de poésie quand même. C’est
la raison pour laquelle je suis ravi que Jean-Pierre Siméon, qui
prône un théâtre de poésie, ouvre ces pages. Dans quelles
conditions éditoriales ? Pierre Banos nous livre de l’intérieur
(il travaille aux éditions Théâtrales) quelques traits de la si-
tuation. Des traits relativement optimistes, qui contrastent
avec les lointains propos d’un Claude Roy qui, jadis, disait jo-
liment de l’édition théâtrale qu’elle était « un dormeur qu’il
ne fallait pas réveiller ! ». Quant à l’enquête qu’avait réalisée,
il y a une vingtaine d’années (en 1986), le très sérieux
Livres
hebdo,
elle estimait qu’entre l’édition et le théâtre « le mariage
était mal assorti » (tel était le titre du dossier), une métaphore
maintes fois reprise dès que l’on aborde le sujet…
Pourquoi éditer du théâtre et des ouvrages concernant le
théâtre ? Un éditeur posait le problème en ces termes : « Un
éditeur veut vendre, or le théâtre ne se vend pas. Un éditeur
veut être lu, or le théâtre ne se lit pas ! » Pourquoi continuer ?
« Parce que le théâtre, c’est toujours mystérieux, énigma-
tique... » Des propos empreints de chaleur, mais plutôt vagues
et qui ne répondent guère à la question de savoir pour-
quoi – même les professionnels lisent peu ou pas du tout. Si
les revues (ou plutôt leur absence) sont un symptôme de ce
mal, autant dire que la cote d’alerte est depuis longtemps lar-
gement dépassée. Mais qui s’en soucie ?
« Comment faire du théâtre sans réfléchir au théâtre ? »*
se demandait Jouvet. Belle question par ces temps de disette
intellectuelle qui donne encore plus d’éclat à ces trois jours de
manifestation place Saint-Sulpice, et qui nous autorise à vous
proposer aussi le compte rendu de quelques ouvrages de ré-
flexion sur le théâtre…
Jean-Pierre Han
* Citation tirée de la préface de Jean-Luc Mattéoli au très beau
livre que je ne peux que vous recommander (voici donc le
premier de la liste) de Roland Shön,
les Oiseaux architectes.
Le Montreur d’Adzirie.
Éditions l’Entretemps, 200 pages,
13,50 euros.
Dessin de Mark Brusse.

Les Lettres françaises
. Mai 2009 (supplément à
l’Humanité
du 9 mai 2009) . IV
ÉDITIONS THÉÂTRALES
Une vraie critique de combat
Le Théâtre face au pouvoir :
chroniques d’une relation orageuse,
de Renée Saurel, L’Harmattan.
296 pages, 29 euros.
Ce livre est une gifle pour les pauvres tâ-
cherons critiques que nous sommes au-
jourd’hui en 2009. Espérons seulement
qu’elle saura nous réveiller, car nous en avons
plus que jamais un besoin urgent. De quoi
s’agit-il ? D’un recueil de textes, critiques
donc, réunis par Robert Abirached, qui fut un
temps de la partie au
Nouvel Observateur
avant de prendre la direction du théâtre, de la
musique et de la danse au ministère de la
Culture. Un recueil de plus me dira-t-on,
soit, mais celui-ci est bien particulier. Robert
Abirached ne s’est pas contenté de réunir les
nombreux textes de Renée Saurel écrits pour
les Temps modernes,
où elle tint la rubrique
théâtrale de 1952 à 1984. Elle avait aupara-
vant collaboré à
Combat
, à
l’Express
et sur-
tout, sur la demande d’Aragon, aux
Lettres
françaises,
où elle s’était occupée des émis-
sions de radio et de télévision. Le choix opéré
a été de ne publier que les articles consacrés à
l’analyse des rapports entre le théâtre et le
pouvoir. Critique de combat déclarée (l’ex-
pression fut reprise par Gilles Sandier), Renée
Saurel ne pouvait bien évidemment pas faire
l’impasse d’un regard et d’une analyse sur les
conditions mêmes de la production théâtrale
de son époque. À lire ses analyses, ses juge-
ments, on ne peut qu’être admiratif et se dire,
une fois de plus, que la critique dramatique ne
consiste pas seulement à aligner, soir après
soir, souvent sans effort de continuité, des pe-
tits jugements sur tel ou tel spectacle.
C’est, en fin de compte, toute l’histoire de
la politique culturelle de notre pays qui est pas-
sée en revue, sans l’ombre de la moindre
concession. Les titres des chroniques, de ce
point de vue, sont parfaitement parlants. Il est
question, bien sûr, du théâtre privé et du
théâtre public, de « la décentralisation en dan-
ger », de « l’État face au théâtre » et d’« Une
mauvaise odeur de Bas-Empire » (nous
sommes en 1969), du « Monstre froid et le
théâtre », du « malthusianisme, arbitraire et
prestidigitation », et encore de « cultivez-vous,
le grand capital fera le reste ! »... Où nos res-
ponsables sont nommément cités, de l’ineffable
Michelet au pauvre Druon (vous souvenez-
vous qu’ils furent ministres de la Culture ?).
Faut-il s’étonner que l’ouvrage s’achève sur
l’évocation d’un des grands hommes de théâtre
de l’époque que Renée Saurel admirait, Roger
Blin, et que les deux derniers articles portent le
même titre de
Cendres fertiles de Roger Blin ou
Pavane pour une éthique défunte
?
C’est une formidable leçon que nous
ferions bien de méditer que nous donne une
ultime fois cette grande dame qui fut de tous
les combats, du « Manifeste des 121 » en 1960,
à celui, onze ans plus tard, « des 343 femmes
pour le droit à l’avortement et le libre accès
aux moyens anticonceptionnels », puis à la
dénonciation des mutilations sexuelles fémi-
nines (voir
l’Enterrée vive
, Slatkine, 1981),
avant de réclamer de droit de mourir dans la
dignité. Ce fut, pour elle, en 1988.
Jean-Pierre Han
L’édition théâtrale dans
tous ses états
1987 : Michel Vinaver, alors président de la commission
théâtre du Centre national du livre, publie chez Actes Sud son
Compte rendu d’Avignon
,
des mille maux dont souffre l’édi-
tion théâtrale et des trente-sept pour l’en soulager.
Son sous-
titre éclaire l’état de léthargie que connaissait la publication
des œuvres dramatiques contemporaines. Un état de mort cli-
nique que confirme la petite centaine de publications subsis-
tant alors.
2009 : le malade d’avant est devenu une niche éditoriale,
économiquement fragile certes, mais qui existe, résiste et s’est
même renforcée par l’adjonction de plusieurs nouvelles mai-
sons spécialisées qui ont rejoint ces dernières années cette
« aberration économique ». La production famélique du dé-
but des années 1980 est devenue plus imposante avec près de
400 unités annuelles.
En vingt ans, comment le secteur s’est-il agrégé ? Autour
de quelles entités éditoriales ? Avec quels soutiens ? Selon
quels critères éditoriaux ? Quels sont les freins à l’édition théâ-
trale de demain ? Autant d’interrogations pour ce rapide pa-
norama.
L’abandon progressif du genre théâtral par les maisons de
littérature générale date du milieu des années 1970. Cet aban-
don était motivé par une perte massive du lectorat de théâtre
concurrencé par une offre culturelle plus forte ; un âge d’or
du metteur en scène, qui souhaitait faire « du théâtre de tout »,
sauf à partir de pièces ; une raison économique majeure, le
changement de statuts de la SACD en 1975 qui interdit aux
auteurs la cession d’une partie de leurs droits de représenta-
tion à un tiers. Avant cette évolution, publier du théâtre était
rentable avec la perception de 50 % des droits. Après, cela te-
nait du philanthropisme béat. Gallimard range alors son pres-
tigieux « Manteau d’Arlequin », pour ne le raviver que ponc-
tuellement, quand un auteur maison commet une pièce. Lu-
cien Attoun est prié d’aller défendre les dramaturges
contemporains ailleurs que dans la sphère privée de Stock : ce
sont les « Tapuscrits de Théâtre ouvert », toujours vivaces au-
jourd’hui.
Seuls résistent L’Arche et l’Avant-Scène Théâtre, deux
maisons créées en 1949. La première est alors essentiellement
tournée vers la dramaturgie allemande post-brechtienne,
ayant importé d’Allemagne la figure de l’éditeur agent axé sur
la seule diffusion des textes pour la scène. La seconde pour-
suit la tradition française de la revue d’actualité théâtrale. La
publication du théâtre subsiste donc, elle qui a fondé l’édition
industrielle française (les frères Lévy, fondateurs de Calmann-
Lévy, ont d’abord publié des pièces) mais de façon marginale.
Deux maisons ouvrent la brèche de l’édition spécialisée entre
1981 et 1984. Jean-Pierre Engelbach qui, grâce à l’aide de la
branche éditoriale de la Ligue de l’enseignement, créé Théâ-
trales (aujourd’hui Éditions Théâtrales) qui se charge de pu-
blier les dramaturges contemporains sevrés d’accueils édito-
riaux et boutés hors du jeu théâtral. Christian Dupeyron en-
suite, qui avec Claire David toujours à la tête de la collection,
créé « Papiers » pour accueillir « tout ce qui se joue » sur les
scènes, comme premier ferment esthétique. Actes Sud, jeune
maison généraliste, récompense rapidement ce volontarisme
en accueillant ces premières publications dans la collection
aujourd’hui en tête du marché.
Inspirées par ces exemples volontaristes, L’Arche, sous
l’impulsion de Rudolf Rach, se tourne davantage vers les dra-
maturges français ou anglais par exemple ; tout en poursui-
vant son travail de revue,
l’Avant-Scène
, sous la houlette de
Danielle Dumas, s’affranchit du seul choix des metteurs en
scène et crée une collection de livres, « les Quatre Vents ». Le
secteur spécialisé de l’édition théâtrale s’était ainsi agrégé. Il
se renforce dans les années 1990 avec l’apport militant, dans
une démarche socioculturelle, de l’éditeur belge Émile Lans-
man. Par ailleurs, le hasard présidant souvent aux aventures
artistiques, la non-publication par les maisons précédemment
nommées des textes de Jean-Luc Lagarce conduit ce dernier
à fonder, avec François Berreur, les Solitaires intempestifs. Il
faut encore citer les plus petites maisons, économiquement
s’entend, qui participent depuis dix ou quinze ans à la pro-
gression de la production dramatique contemporaine : Espace
34, Le Bruit des autres, L’Amandier, La Fontaine et, plus ré-
cemment, L’Espace d’un instant ou Quartett. Aujourd’hui, il
se publie donc entre 350 et 400 titres de théâtre contemporain
répartis à 60 % par ces entités spécialisées, le restant étant as-
sumés par des occasionnels.
Mais comment ce qui était impossible à l’orée des années
1980 est devenu tangible vingt ans après ? Un faisceau de fac-
teurs, souvent cités par Vinaver dans son rapport, a favorisé
ce développement, modeste à l’aune des contrôleurs de ges-
tion qui régissent aujourd’hui les grandes maisons d’édition,
mais réel au regard de la situation désertique d’alors. Premiè-
rement, un soutien régulier du Centre national du livre qui a
classé le théâtre, comme la poésie, au rang des genres « à écou-
lement lent », ce qui lui accorde la possibilité de subventions.
D’aucuns estiment qu’il y a là assujettissement à un art offi-
ciel. Il ne tient qu’à eux d’assumer leur fonction d’éditeur en
publiant, même en cas de refus de la commission théâtre du
CNL. Deuxièmement, l’utilisation est courante aujourd’hui
d’un partage des risques par le prisme des coéditions avec des
structures théâtrales publiques ou parapubliques. Troisième-
ment, le soutien fluctuant de l’action culturelle de la SACD
aux maisons d’édition théâtrale qui semble aujourd’hui plus
souvent accordé aux maisons émergentes, ce qui pourrait se
tenir si cela ne défavorisait pas les auteurs publiés par les
autres. Enfin, le développement du livre de théâtre a été au-
torisé par le travail tout autant militant de quelques librairies
spécialisées et au regard bienveillant sur ces livres en train de
se perfectionner, tant sur la forme que sur le fond, de libraires
généralistes. Mais brisons une image d’Épinal qui sclérose les
relations entre le secteur théâtral subventionné et l’édition de
théâtre : en agrégeant les subventions du CNL, aujourd’hui
toujours nécessaires, les aides ponctuelles SACD et les coédi-
tions, l’apport externe vers ces maisons spécialisées dépasse
rarement les 10 % du budget. Le reste étant constitué de vente
d’ouvrages. La vision d’éditeurs publics s’autorisant des re-
fus pleins de morgue doit être dépassée.
Au-delà de ces considérations économiques pourtant ma-
jeures dans une économie de marché et intrinsèques à la fonc-
tion éditoriale, l’objet de ces maisons est de proposer des textes
aux lecteurs et à l’assemblée théâtrale. Trois marqueurs édi-
toriaux président à l’ensemble des choix, comme autant de
curseurs que les uns et les autres meuvent selon leurs philoso-
phies. La notion de répertoire est la première commune au sec-
teur : publier du théâtre aujourd’hui c’est essayer de com-
prendre qui seront les auteurs de demain. Le théâtre comme
genre littéraire est une idée relativement admise par tous se-
lon une vision volontariste de retour du dramaturge en litté-
rature. Enfin, entité plus débattue, la relation à l’actualité scé-
nique. Elle engendre la publication des pièces, par certains,
concomitamment à leur création, à la fois pour bénéficier de
la médiatisation du spectacle et dans un objectif esthétique
d’un nécessaire passage du texte par le corps des acteurs.
D’autres préfèrent publier en amont de tout projet scénique
afin de ne pas dépendre du désir d’un autre, comme le metteur
en scène. En s’affranchissant du plateau et en s’adressant
d’abord aux lecteurs (du lecteur « pur » aux lecteurs praticiens,
professionnels ou amateurs), ces éditeurs, qui figent les textes
dans les livres, leur rendent paradoxalement leur liberté et leur
autorisent des vies futures en les « dépolluant » de tout ima-
ginaire esthétique scénique.
Ces trois marqueurs renvoient aux trois fonctions dédiées
à la figure de l’éditeur de théâtre : la trace d’un art éphémère
dans un esprit de conservation des pièces ; la source des spec-
tacles en contribuant aux côtés des comités de lecture divers
à réintroduire l’auteur au sein du jeu théâtral, en dépassant le
stérile débat texto/scénocentrisme ; l’écot à la littérature en
proposant une littérature souvent formellement en recherche.
Le malade décrit par Michel Vinaver a donc quitté sa
convalescence, mais nécessite toujours un traitement au mi-
nimum homéopathique. Or la baisse des aides CNL pourrait
à terme faire craindre pour sa santé. Si certaines barrières ont
été levées, subsistent encore aujourd’hui des freins à la péren-
nisation de la publication théâtrale. L’absence récurrente d’in-
téressement des éditeurs aux droits de représentation consti-
tue le principal obstacle. Le secteur doit encore progresser
dans sa diffusion et dans le règlement plus rapide des droits
de vente pour mériter ce nouvel oxygène sous la forme d’un
système d’intéressement progressif qui profitera d’abord aux
auteurs. En élargissant l’assiette, ils ont plus à gagner qu’à
perdre. La balle est dans leur camp. Mais les éditeurs en main-
tenant en circulation des textes sur des décennies – le secteur
est peu consommateur de pilons – prouvent leur volonté de
favoriser des créations multiples.
Enfin, deux dangers majeurs se profilent, non pour l’édi-
tion théâtrale elle-même qui, si elle ne s’engage pas corps et
biens pour assumer ses fonctions, périra. Mais bien pour les
auteurs et les textes de théâtre. Ce genre risque en effet la sclé-
rose du fait de la marginalité de sa critique. La critique mé-
diatique des textes contemporains est quasi inexistante, quand
l’universitaire s’interroge, mais à l’aune d’un corpus en
constante évolution. Constituer l’une des seules instances cri-
tiques est sans doute une responsabilité trop grande pour les
éditeurs. D’autre part, le fantasme du « tous créateurs » qui
conduit certains dramaturges à livrer leurs œuvres au télé-
chargement gratuit sur l’Internet les aveugle. On ne devient
artiste que par le public et ses médiateurs. Aux éditeurs de dé-
fendre leur position de premier filtre et d’octroi de label pour,
s’ils s’engagent dans la voie numérique, poursuivre leur tâche
première : proposer des œuvres contemporaines à la scène et
à la littérature. L’avenir de l’édition théâtrale s’annonce pas-
sionnant car c’est bien du conflit que naissent l’exigence et la
qualité.
Pierre Banos

Les Lettres françaises
. Mai 2009 (supplément à
l’Humanité
du 9 mai 2009) . V
ÉDITIONS THÉÂTRALES
DR
Parcours
pluriels et singuliers
Livraison et Délivrance. Théâtre, politique, philosophie
par Denis Guénoun. Éditions Belin, 400 pages, 26 euros.
Titre et sous-titre du dernier ouvrage de Denis Guénoun
sont particulièrement alléchants :
Livraison et Déli-
vrance. Théâtre, politique, philosophie.
Nous voilà fort
opportunément dans une direction de réflexion telle que le
théâtre d’aujourd’hui entend, avec un brin d’ostentation
quelque peu suspect, parcourir.
Rien de semblable chez Denis Guénoun, bien sûr, que l’on
connaît de longue date et qui a, pour ainsi dire, toujours œu-
vré dans ce sens. D’ailleurs son livre n’a pas été écrit à la va-
vite pour être dans l’air du temps ; c’est le recueil d’un cer-
tain nombre de ses articles ou interventions, écrits, commu-
niqués, ici et là au fil du temps. Ici et là, c’est-à-dire auprès
d’instances théâtrales, mais aussi auprès d’instances philo-
sophiques, voire politiques… Pourquoi cette réunion appa-
remment contre nature ?
Livraison et Délivrance
est la juste
réponse à cette question, mais aussi et surtout parce que De-
nis Guénoun arrive à un moment où certaines « parts » de sa
vie (en tout cas les deux principales) trouveraient enfin leur
unité. Comédien, metteur en scène, auteur, directeur de com-
pagnie, Guénoun fut un homme de théâtre complet, et re-
connu comme tel. Depuis quelques années, il a abandonné les
planches pour ne se consacrer qu’à la philosophie. Il enseigne
à la Sorbonne (Paris-IV). Cette séparation, ou cette double
appartenance, n’a désormais plus lieu d’être : Denis Guénoun
a enfin trouvé le lien qui existe entre, dit-il, « la réflexion sur
le théâtre et la pensée philosophique en général ». Il y a peut-
être, ajoute-t-il, « un rapport entre le désir de jeu, comme li-
vraison, et le désir d’émancipation politique, comme déli-
vrance ».
Voilà pour le beau titre, deux beaux chapitres sur la livraison
et la délivrance, qui enserrent l’ensemble du livre néanmoins
séparé en deux parties : théâtre, puis politique et philosophie.
Au lecteur d’établir les correspondances ou la liaison. Effec-
tivement les deux chapitres, livraisons et délivrances (au plu-
riel cette fois-ci) sont essentiels. Composés aujourd’hui donc,
c’est-à-dire après-coup, ils livrent, en s’autorisant de la pa-
role de Jacques Derrida (voir
l’Animal autobiographique, au-
tour de Jacques Derrida
, Éditions Galilée), la personnalité
profonde de l’auteur. Et c’est tout simplement à la fois pas-
sionnant et remarquable. Des années 1970 qui marquent son
entrée en scène (intellectuelle et politique) à aujourd’hui, De-
nis Guénoun nous livre un témoignage de première valeur sur
sa vie intime, sur la vie intellectuelle qui tournait essentielle-
ment, à l’époque, autour du Parti communiste, en même
temps qu’un vibrant et très émouvant hommage à celui qui
fut son maître et ami, Jacques Derrida.
« La livraison est l’acte d’un don, d’une offre », dit Denis
Guénoun. Ce qu’il nous offre de manière si intime (un intime
qui rejoint l’universel) dans son livre est inestimable. Ses der-
nières lignes qui parlent de Derrida mort, de ses dernières pa-
roles écrites et prononcées par son fils Pierre à son enterre-
ment sont d’une bouleversante intelligence. Le théâtre, la po-
litique et la philosophie prennent alors sens. C’est bien là
l’essentiel.
Jean-Pierre Han
Un sursaut de vie
Début 2005, la librairie Oh les beaux jours, dédiée aux
arts du spectacle et au cinéma, était créée par une toute
jeune femme, Céline Lucet, épaulée par Gilles Gonord,
son libraire de compagnon. D’emblée, ce lieu a proposé une
sélection d’ouvrages de qualité dans les domaines des arts de
la scène, mais a également ouvert ses portes, et poussé ses
murs ! à des lectures, rencontres et spectacles divers, souvent
en cours de création, et qui rencontraient donc là leur premier
public. La librairie s’est aussi transportée au-dehors, afin de
participer à des festivals, des soirées thématiques dans des ci-
némas ou des théâtres… Un lieu utopique certes : où sur les
tables se croisent l’histoire d’un art et sa pratique la plus
contemporaine ; où un cheminot vient rencontrer le choré-
graphe Emmanuel Grivet, venu évoquer l’importance du
temps dans son travail ; où des comédiens venus acheter des
livres se retrouvent à conseiller d’autres clients…
Bâtir un lieu, l’inventer et « l’exister », comme un sursaut
de vie, pour faire, pour agir, ne pas se laisser démunir de ce qui
appartient à chacun : le choix, la possibilité.
Et un jour, dans le marasme environnant et dans lequel
tous les jours il faut se battre pour ne pas être franchement dé-
couragé, nous nous sommes dit, amoureux des livres que nous
sommes, que faire des livres quand même, c’est un truc in-
croyable. Un livre ! De l’espoir ! Un livre, ça dure, ça se pro-
jette, donc : l’avenir existe.
Nous nous sommes alors retrouvés, les deux susnommés
et leur amie Marie-Céline Orlhac, trois comparses animés par
le désir de faire, de faire des livres, de faire ensemble, de faire
avec.
Nous nous sommes nommés Un thé chez les fous.
Dans ce chapitre d’
Alice
, habité par le Chapelier, le Loir et
le Lièvre de Mars, on y pose des questions sur le temps, les ha-
bitudes et les rôles de chacun ; questions rébus portant à la fois
sur le langage et le dessin, l’écrit devenu personne, etc.
D’une manière générale
Alice
contient en métaphore la ma-
nière dont nous considérons les œuvres et la création : quelque
chose qui fait grandir, métamorphose et nourrit, bref, change
radicalement, physiquement, celui qui donne aussi bien que
celui qui reçoit.
Nous croyons qu’éditer n’est pas seulement faire exister un
objet sur un marché, mais bien aussi et surtout rendre visibles
une pensée, un acte, une position face au monde, qui pour-
raient rencontrer d’autres regards, d’autres pensées, et trans-
former ainsi l’ensemble des personnes concernées par le pro-
jet livre. Bref, nous pensons qu’un réseau d’individus parti-
culiers, réunis autour de ce thé particulier, peut former le
noyau d’une aventure collective, c’est-à-dire commune, ce qui
est somme toute assez ordinaire, mais ne l’est toutefois pas
dans le contexte quelque peu chamboulé, voire franchement
cul par-dessus tête, dans lequel nous vivons.
Les domaines éditoriaux sont ceux de la librairie Oh les
beaux jours : le théâtre, la danse contemporaine, le cinéma, la
poésie (axée sur la performance, l’oralité, la sonorité…), la
marionnette, le cirque, la performance, les arts de la rue.
Notre désir est de rassembler autour de chaque projet une
petite équipe : un auteur, un éditeur, un typographe, un gra-
veur… Cette équipe travaillera afin de faire exister un livre qui
sera une œuvre commune. Nous aimerions associer artistes,
artisans, penseurs…
Nous proposerons un ou deux livres par an, c’est peu mais
pour nous ce sera déjà beaucoup ! Ça signifie aussi que nous
serons d’une extrême exigence et n’éditerons que des textes
qui nous transportent, nous interrogent, nous démunissent…
Enfin, cette structure, si elle vise en premier lieu à éditer des
livres, ambitionne également d’organiser des événements, et
de participer à des initiatives où se croisent domaines artis-
tiques et intellectuels…
Le Chapelier Fou,
le Loir et le Lièvre de Mars
Un thé chez les fous
Librairie
Oh les beaux jours
20, rue Sainte-Ursule, 31000 Toulouse.
ttp://unthechezlesfous.blogspot.com
À l’heure où les librairies spécialisées dans les arts du spectacle ferment leurs portent (à Paris notamment),
et au moment où les éditeurs des mêmes arts du spectacle font feu de tout bois pour survivre, nous voilà avec la librairie
Oh les beaux jours et les éditions Un thé chez les fous, tous deux sis à Toulouse (on admirera au passage le choix
des titres), en pleine utopie. Raison de plus pour leur donner la parole.
Un manifeste en
forme de biographie
Je n’ai jamais quitté l’école…
de Daniel Mesguich,
entretiens avec Rodolphe Fouano.
Albin Michel, 200 pages, 16 euros.
«Je n’ai jamais quitté l’école… » nous dit donc Daniel Mes-
guich. Cette école, bien sûr, c’est le CNSAD (le Conser-
vatoire national supérieur d’art dramatique) de Paris.
Quand même, son statut a quelque peu changé. Le tout jeune
homme, élève d’Irène Lamberton à Marseille, qui l’incita à se
présenter au Conservatoire, où il fut reçu, grâce à
Antoine Vitez, fit donc son apprentissage dans la célèbre de-
meure, avant de devenir, très vite, à son tour (il avait à peine trente
et un ans), professeur, en 1983, à la demande de Jean-Pierre Mi-
quel, le directeur de l’époque. Il a donc « formé » des générations
de comédiens, et le voici aujourd’hui, depuis près d’un an, direc-
teur dudit Conservatoire… Tout un parcours dans l’ombre de
cette institution, mais avec, fort heureusement, de nombreuses
échappées dans le jeu, la mise en scène, la direction d’un centre
dramatique national (celui du Nord-Pas-de-Calais). Aucune rai-
son d’ailleurs que ces échappées s’arrêtent : « Le directeur du
Conservatoire se doit d’être dans la réalité artistique, et non sim-
plement un directeur d’école ! »
Retour donc, avec Rodolphe Fouano qui l’interroge, sur un
parcours riche d’où je retiendrai personnellement les très belles
et passionnantes évocations d’Antoine Vitez et de Pierre De-
bauche (avec accessoirement le très bref hommage à Jacques Der-
rida), qui rénovèrent l’antique Conservatoire…
Vitez et Debauche, deux hommes, deux artistes aux antipodes
l’un de l’autre, deux amis qui s’entendirent à merveille, l’un
« avant-gardiste expérimental » dans la vieille école, l’autre « ma-
gicien forain », mélange de l’eau et du feu, dont le « produit » ou
l’enfant serait Mesguich soi-même ? On ne saurait rêver mieux !
En tout cas, côté théorie, Daniel Mesguich a du répondant ; cela,
on le savait depuis longtemps. Son entretien nous le confirme.
C’est donc un plaisir que de converser avec lui.
J.-P. H.
À ÉCOUTER
Dimanche 24 mai, de 17 heures à 18 heures, au Salon du
théâtre, le Théâtre 71 de Malakoff et
les Lettres françaises
présentent leur 3eConversation de la saison : la mise en
scène et sa transmission. Avec Christian Schiaretti, Robert
Cantarella et sous réserve Alain Françon et Julie Brochen.
Débat animé par Jean-Pierre Han.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%

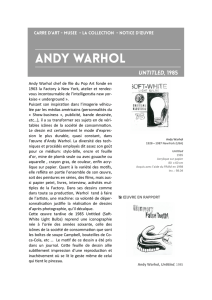
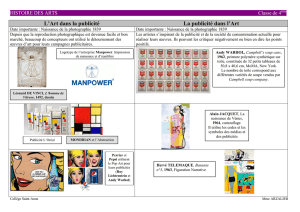
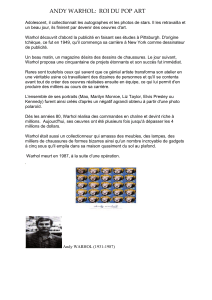
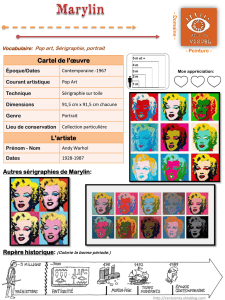

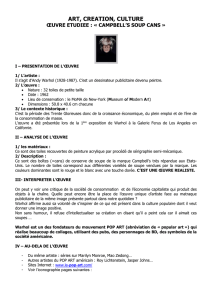
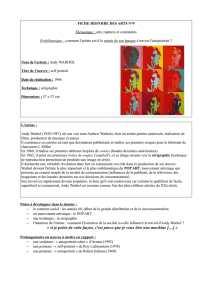

![Biographie [modifier]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001541494_1-cc628b4ec4892869c93c968068c7b382-300x300.png)