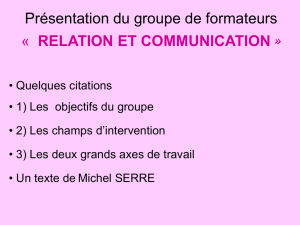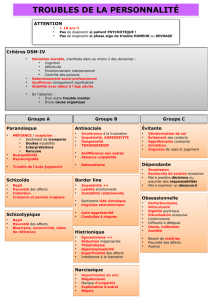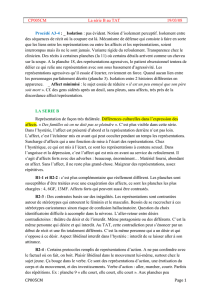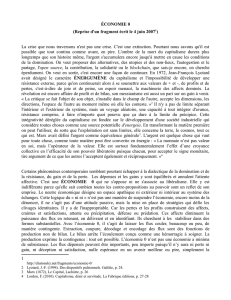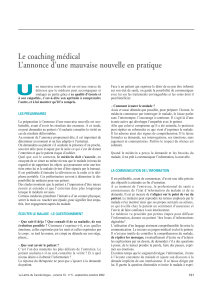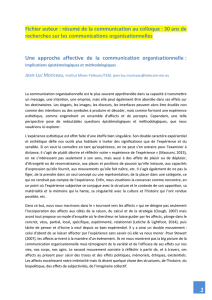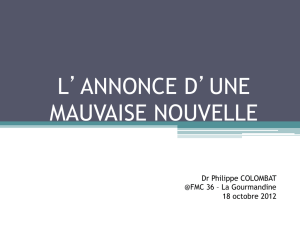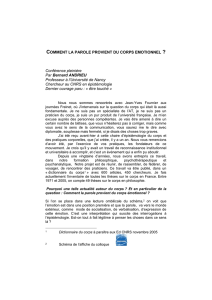Open access

!"#$%&'&()*(+),--(%.+/)0(&+1(%.'2(+)(.)(34(56),3.7&818*89':5(+/);,&'3()0*,3%<()(.)=>8)?,&',3'@)
$A+@)0,&'+@)0(.&,@)BCDE/)
)
)
0F$GH;$)
I>&83':5()J(&2,'+))
)
K*)(+.)A(2(35)'L18++'M*(),5485&AN75')AN'938&(&):5()*(+)+%'(3%(+)+8%',*(+@),1&O+)*(+)+%'(3%(+)
1+P%78*89':5(+@)83.)1&'+)53)Q.85&3,3.),--(%.'-Q/);(*5'R%')+N,%%8L1,93()AN53)3852(*)'3.>&S.)
185&)*()%8&1+)(.)*N'3%,&3,.'83)!embodiment#)(.)%83.&'M5()T)&(3852(*(&)*()&(9,&A)18&.>)+5&)*(+)
17>38LO3(+)+8%',56)(.)75L,'3+/)U'(3)+V&)*(+)+%'(3%(+)+8%',*(+)3N83.)4,L,'+)'938&>):5()*(+)
S.&(+)75L,'3+)+83.)A(+)S.&(+),--(%.>+)W)L,'+)T)A>-,5.)AN53().7>8&'()+8%',*()A(+),--(%.+@)A(+)
>L8.'83+)(.)A(+)+(3.'L(3.+@)%()A8L,'3()-*85)(.)A'--'%'*()T)38LL(&)A()*N(61>&'(3%()75L,'3()
,)9*8M,*(L(3.)>.>)A>*,'++>)1,&)*N,3.7&818*89'(@)(.)1*5+)(3%8&()1,&)*,)+8%'8*89'(/)X&)
,5485&AY75')%7,%53)+(LM*()1&(3A&()%83+%'(3%():5()*(+),--(%.+).&,2(&+(3.)38+)2'(+)(.)38+)
'3+.'.5.'83+@):5Y'*+)+83.)1&>+(3.+)+5&)*,)+%O3()A()*,)2'()15M*':5(),5.,3.):5()A,3+)*,)2'()'3.'L(@)
(.):5()A(+)&>+(,56)AY,--(%.,.'83)*'(3.)(3+(LM*()75L,'3+)(.)383)75L,'3+/))
)
?,'+)*Y5M':5'.>)A(+),--(%.+)3Y(3)-,'.)1,+)185&),5.,3.)A(+)Z)8M4(.+)[),'+>+)T)+,'+'&/);,&)'*+)83.)
M(,5)S.&()1,&.85.@)'*)(+.)A'--'%'*()A()+,28'&)A():58')'*+)+83.)-,'.+/)\5()+'93'-'()Z)S.&(),--(%.>)[)
185&)53)S.&()75L,'3@)53)2(&)A().(&&(@)53)2>9>.,*)85)53()M,%.>&'(@)185&)53()1'(&&()18+>()*T)
85)185&)53),+.>&8]A()^)G,5.R'*)&>+(&2(&)*().(&L()AY,--(%.),56)S.&(+)%,1,M*(+)A()&(++(3.'&)A(+)
>L8.'83+@)%8LL()*(+),3'L,56)^)H56)8&9,3'+L(+)%,1,M*(+)A().&,'.(&)*Y'3-8&L,.'83@)A83%)T)
.85+)*(+)8&9,3'+L(+)2'2,3.+@)2>9>.,56)(.)M,%.>&'(+)%8L1&'+)^)G,5.R'*)*Y>.(3A&(),56)+P+.OL(+)
(3.'(&+),5)+('3)A(+:5(*+)%'&%5*()A()*Y'3-8&L,.'83)85@)185&)&(1&(3A&()53().(&L'38*89'()A()_/)
U,.(+83@)A(+)Z)3852(**(+)A()A'-->&(3%(+)[)^)"8'.R83),*8&+)*'L'.(&)*,)%,1,%'.>)AYS.&(),--(%.>)
,56)+P+.OL(+):5'@)+(*83)%(.),5.(5&).85485&+@)18++OA(3.)A(+)%,&,%.>&'+.':5(+)Z)L(3.,*(+)[)85)
*Y>.(3A&(@)%8LL()*()1&818+()`(.7(&(**)!BCDB#)45+:5Y,5)L83A()A(+)8M4(.+@)A(+)(3.'.>+)
'32'+'M*(+)(.)A(+)L,.>&',56)^);()A(&3'(&)>*,&9'++(L(3.)A5)%(&%*()A()*Y,--(%.,.'83)3Y(+.)1,+)
,38A'3)%,&)'*)+5118+():5()*Y83)%(++()A()A'+.'395(&)(3.&()2'2,3.)(.)383)2'2,3.@)(3.&()*()L83A()
8a)*(+)%,5+(+)+83.)A(+)A'-->&(3%(+)(.)%(*5')8a)*(+)%,5+(+)+83.)A(+)'L1,%.+)A()L,.'O&()85)
AY>3(&9'(/)K*)+5118+()A83%)AY(32'+,9(&)A,3+)53()1&>8%%51,.'83)%8LL53()*(+)S.&(+)(.)*(+)
%78+(+)(.)'32'.()A()%()-,'.)T)53)%7,39(L(3.)1&8-83A)A()&(9,&A/))
)
",3+)%()Z).85&3,3.),--(%.'-)[@);,&'3()0*,3%<(@)=>8)?,&',3')(.)*(+)4(53(+),5.(5&+)&,++(LM*>+)
'%')385+)1&818+(3.)A()385+)P)(39,9(&@):58':5()A()L,3'O&()%&'.':5(/)X3).&852()%(&.(+)'%')
*Y'3-*5(3%()A()%(56):5Y83),),11(*>)*(+)Z)3852(,56).7>8&'%'(3+)A()*Y,--(%.)[@)38.,LL(3.)A,3+)
*,)28*83.>)AY>.5A'(&@)1*5.b.):5()A(+)>L8.'83+)75L,'3(+)(.)*(5&+)+'93'-'%,.'83+)+8%',*(+@)A(+)
&>+(,56)%8L1*(6(+)(.)7>.>&89O3(+),5)+('3+)A(+:5(*+)+()1&81,9(3.)A(+)A'-->&(3%(+)(.)A(+)
'L1,%.+/)X3)P).&852()>9,*(L(3.@)%7(c)%7,%53)A(+),5.(5&+@)*,)28*83.>)AY>%7,11(&),56)
A5,*'+L(+):5')83.)*839.(L1+)%,A(3,++>)*,)&>-*(6'83)+5&)*(+)>L8.'83+)(3)+%'(3%(+)75L,'3(+/)
;(.)852&,9()1,&.'%'1()A83%)A5)&(3852(,5)A5)&(9,&A)+5&)*(+),--(%.+)(3),3.7&818*89'(/)K*)385+)
'32'.()T)%7(&%7(&)AY,5.&(+)28'(+)185&)A'+%(&3(&@)A>%&'&()(.)%83%(28'&)*(+),--(%.+)(.)*(+)
>L8.'83+)1&>+(3.+),5)%d5&)A(+)+8%'>.>+)75L,'3(+/)K*)385+)L83.&()%8LL(3.).(3'&)(3+(LM*(@)
2',)53()(3:5S.()(L1'&':5()+(&&>(@)A(+)chaînes.ou.réseaux.d’affectation)A,3+)*(+:5(**(+)*(+)
>*>L(3.+)2'2,3.+)(.)383)2'2,3.+@)%83+%'(3.+)(.)383)%83+%'(3.+@)'3A'2'A5(*+)(.)%8**(%.'-+@)
'3.(3.'833(*+)85)383@)+83.)&(*'>+)(.)+Y,--(%.(3.)*(+)53+)*(+),5.&(+/)=(+).&,2,56)1&>+(3.>+)'%')

+83.)A83%),2,3.).85.),3%&>+)A,3+)A(+)>.5A(+)A().(&&,'3)L'35.'(5+(+)(.),..(3.'2(+@)+(5*(+)T)
LSL(+)A()&(3A&()%8L1.()A()*,)&>,*'.>)%8L1*(6()A(+)&>+(,56)AY,--(%.,.'83/)=(+).(6.(+)+83.)
1&>%>A>+)AY53()'3.&8A5%.'83)%83+>:5(3.():5')&(.&,%(),2(%)M(,5%851)A()-'3(++()(.)A()
&'95(5&)*(+).&'M5*,.'83+)+5'2'(+)1,&)*Y>.5A()A(+),--(%.+@)A(+)>L8.'83+)(.)A(+)+(3.'L(3.+)A,3+)
*()%7,L1)A(+)+%'(3%(+)+8%',*(+)A(15'+):5()",&e'3),)1&818+>)A()*(+)+'.5(&)A5)%b.>)A()*,)
M'8*89'(@)A,3+)53()-'*',.'83),3'L,*()1,&),'**(5&+)'3%83.(+.,M*(/);8LL()*Y>%&'2(3.)*(+),5.(5&+)T)
*,)-'3)A()*(5&)'3.&8A5%.'83@)*Y852&,9()(+.)A83%)53()'32'.,.'83)T)(61*8&(&)%():5()*(+)
,3.7&818*895(+)-83.)A()%().85&3,3.),--(%.'-@)A83.)*Y53()A(+)1'(&&(+)A().85%7()(+.)*,).7>8&'()
A()*Y,--(%.)%8LL()Z)15&()'3.(3+'.>)[)A()U&',3)?,++5L'/))
)
",3+)%(..().7>8&'().&O+)A'+%5.>(@)U&',3)?,++5L')+Y,115'()+5&)*,)3(5&8M'8*89'()185&)
%83+'A>&(&)*Y,--(%.)%8LL()53()&>183+()%8&18&(**()autonome)A>35>()A()+'93'-'%,.'83)+8%',*(@)
53()Z)'3.(3+'.>)383):5,*'-'>()[)(.)Z)'3,++'L'*,M*()[@):5')+5&2'(3.)avant)(.)en.amont)A().85.()
'3.(&1&>.,.'83/);(..()1&818+'.'83)'3A5'.)53()A'+483%.'83)+')&,A'%,*()(3.&()'3.(3+'.>)%8&18&(**()
(.)%893'.'83):5Y83)1(5.)&,'+833,M*(L(3.)A85.(&)A()*,)%,1,%'.>)AY53)+54(.)T)'A(3.'-'(&)%():5')
*Y,),--(%.>)f)+(*83)%(..().7>8&'(@)%()A(&3'(&)+(&,'.).85485&+)A,3+)53()interprétation)a.
posteriori@)A,3+)*Y,++'93,.'83)&>.&8+1(%.'2()AY53()+'93'-'%,.'83)%832(3.'833(**()T)A(+)
1&8%(++5+)3(5&817P+'8*89':5(+)A83.)*,)*89':5()&>(**()*5')>%7,11(/)X&)%(%')3Y(+.)1,+)53()
:5(+.'83)A()A>.,'*)1,&%():5(@)+')*,)+'93'-'%,.'83)A833>(),56),--(%.+)A,3+)*Y,1&O+R%851)(+.)*,)
+(5*()A'L(3+'83)A()*Y(61>&'(3%()+5+%(1.'M*()AY,11,&,g.&()A,3+)*,)*5L'O&()A()*,)%83+%'(3%(@)
,*8&+)'3.(&&89(&)*(+)9(3+)+5&)%():5')*(+),--(%.()(+.)'35.'*(/)=Y(3:5S.()3()1&8A5'&,):5()A(+)
45+.'-'%,.'83+)a.posteriori@):5')3()1(&L(..&83.)LSL()1,+)AY>%*,'&(&)*(+)1&8%(++5+)A()
%832(3.'833,*'+,.'83@)A()Z)1&'+()[)!,5)+(3+)8a)A5)1*h.&()Z)1&(3A)[)1&89&(++'2(L(3.#@)
AY,%.5,*'+,.'83)A5)2'&.5(*/)$3)+8LL(@)A,3+)53().(**()%83-'95&,.'83@)*Y,--(%.)(+.)53)18'3.)
,2(59*()A()*Y(61>&'(3%(@)'3,%%(++'M*()1,&)A>-'3'.'83)T)*,)%83+%'(3%()(.)A83%)T)*Y'3.&8+1(%.'83/)
J(5*()*Y,3,*P+()8M4(%.'2()A(+),%.'2,.'83+)3(5&83,*(+)+(&,'.)A83%)T)LSL()AY(3)A>28'*(&)*(+)
%,5+(+)(.)*()-83%.'833(L(3.i)(.)(3%8&(/)
)
X&)'*)+()-,'.):5Y53)A>M,.)+'L'*,'&(),)(5)*'(5)(3)1+P%78*89'()+8%',*()(61>&'L(3.,*(/)$3)DjEE@)
k'+M(..)(.)`'*+83)83.)15M*'>)53()+>&'()A()&>+5*.,.+)(61>&'L(3.,56)L83.&,3.):5()*(+)+54(.+)
3Y83.)1,+),%%O+)T)*(5&+)1&8%(++5+)%893'.'-+/)",3+)*(5&+)1&8.8%8*(+@)A(+)+54(.+)A(2,'(3.)%78'+'&)
(3.&()A(56)178.89&,17'(+)%(**():5Y'*+)1&>->&,'(3.@)15'+)'*+)>.,'(3.)'32'.>+)T)(61*':5(&)*(+)
&,'+83+)A()*(5&)%78'6/)=(+)%&'.O&(+)A()%78'6)>.,'(3.)(3)&>,*'.>)L,3'15*>+)(61>&'L(3.,*(L(3.)T)
*(5&)'3+5/)",3+)%(+)%83A'.'83+@)*(+)+54(.+)A()k'+M(..)(.)`'*+83)3Y83.)1&818+>):5()A(+)
justifications):5')>.,'(3.)T)*,)-8'+)+8%',*(L(3.),%%(1.,M*(+)(.)+,3+)&,118&.),2(%)*(+)2>&'.,M*(+)
L8.'-+):5'),2,'(3.)A>.(&L'3>)*(5&),%.'83/)=(+),5.(5&+)(3)%83%*5,'(3.):5Y'*)-,**,'.)M,33'&).85.()
L>.78A()'3.&8+1(%.'2()(3)+%'(3%(+)+8%',*(+@)15'+:5()%(**(R%')3()*'2&,'.):5()A(+)45+.'-'%,.'83+)
A()+(3+)%8LL53@)(.)383)*(+)2>&'.,M*(+)L8.'-+)A()*Y,%.'83)f)*(+)1&8%(++5+)%893'.'-+)>.,'(3.)
'3,%%(++'M*(+)T)*Y'3.&8+1(%.'83/)?,'+)*Y7'+.8'&()3()+Y,&&S.()1,+)*T@)1,&%():5Y(3)BCDl@);*,'&()
0(.'.L(39'3)(.)+83)>:5'1()!0(.'.L(39'3)(.),*@)BCDl#)83.)&>1>.>)*(+)(61>&'(3%(+)A()k'+M(..)m)
`'*+83)(3)L8A'-',3.)*,)L,3'O&()A()18+(&)*(+):5(+.'83+/)K*+)83.)L83.&>):5()*8&+:5Y83)*(5&)(3)
A833()*,)18++'M'*'.>@)1,&)53()L>.78A()AY(3.&(.'(3),11&81&'>()!*(+)(3.&(.'(3+)AY(61*'%'.,.'83@)
28'&)0(.'.L(39'3@)BCCn)W)I(&L(&+%7@)BCCo#)*(+),%.(5&+)+83.)T)LSL()AY,%%>A(&)T)*(5&+)
1&8%(++5+)%893'.'-+)1&>%83+%'(3.+@)&(2,*'A,3.),'3+')*Y'3.&8+1(%.'83)%8LL()L>.78A()
AY(3:5S.(/)F'(3)3Y'3.(&A'.)A()1(3+(&):5Y'*)15'++()(3)S.&()A()LSL()185&)*(+)1&8%(++5+)
AY,--(%.,.'83@)(.):5()A(+)L>.78A8*89'(+)AY(3.&(.'(3),11&81&'>(+)15'++(3.)&(3A&()%8L1.()A()
*(5&)>L(&9(3%(@)15'+)A(+),9(3%(L(3.+):5')1&89&(++'2(L(3.)A833(3.)+(3+),56)&(++(3.'+@)

,'3+'):5()A5)&b*()A5)*,39,9()A,3+)%()1&8%(++5+/)p3)%7,L1)(3.'(&)AY'32(+.'9,.'83)+Y852&(),'3+')
T)*Y(3:5S.(),3.7&818*89':5(@)185&)1(5):5()*(+)%7(&%7(5&+),%%(1.(3.),5++')A()&(3852(*(&)
*(5&+)L,3'O&(+)A()18+(&)A(+):5(+.'83+)(.)AY(3.&(&)(3)&(*,.'83),2(%)*(+)(3:5S.>+@)%():5')
+5118+()1&8M,M*(L(3.),5++')A()+()*,'++(&),--(%.(&/)J')*(+),--(%.+)+83.)M'(3@)%8LL()*()1&818+()
?,++5L'@)A(+)18.(3.',*'.>+)*,'++>(+).(L18&,'&(L(3.)A,3+)*Y'3A>.(&L'3,.'83@)%():5')(+.)53()
1&818+'.'83)1,++'833,3.()185&)*(+),3.7&818*895(+@),*8&+)%(56R%')283.)18528'&)+Y'3.>&(++(&)(3)
A>.,'*),56)L'**()(.)53(+)L,3'O&(+)A83.)*(+),--(%.+)+Y,%.5,*'+(3.)(3)>L8.'83+)
%832(3.'833(**(+/);Y(+.)M'(3)*T)%():5Y83.)(3.&(1&'+)A()-,'&()*(+),5.(5&+)&,++(LM*>+)'%'@)T)1,&.'&)
AY53)85.'**,9()%83%(1.5(*):5')3()+()*'L'.()1,+@)*8'3)+Y(3)-,5.@),56).7>8&'(+)A()?,++5L'/)
)
;(**(+R%')3()+83.)AY,'**(5&+)1(5.RS.&()1,+),5++')Z)3852(**(+)[):5Y83)185&&,'.)*()%&8'&(/);(&.(+)*()
&(3852(**(L(3.)A5)&(9,&A)+5&)*(+)>L8.'83+@),'3+'):5()A(+)L>.78A8*89'(+)185&)*(+)+,'+'&)(.)
*(+)A>%&'&()(+.)1,.(3.@)%8LL()(3).>L8'93()'3%83.(+.,M*(L(3.)%(.)852&,9(/)?,'+)'*)(+.)
+5&1&(3,3.)A()%83+.,.(&)*(+)%832(&9(3%(+)1&8-83A(+)(3.&()*,).7>8&'()A()*Y,--(%.)%8LL()
Z)15&()'3.(3+'.>)[)A()?,++5L')(.)*,).7>8&'()A()Z)*YhL()+(3.,3.()[):5()q(9(*),)>*,M8&>()(3)
DrDE)185&)&(3A&()%8L1.()A5)17>38LO3()A5)Z)L,93>.'+L(),3'L,*)[/)",3+)*,)L,93'-':5()
'3.&8A5%.'83):5')1&>*5A()T)+,).&,A5%.'83)A(+)1,9(+)A()q(9(*)%83+,%&>()T)%()17>38LO3(@)*()
+1>%',*'+.()A()*Y7P138+()G&,3s8'+)F85+.,39)385+)&,11(**():5(@)185&)%8L1&(3A&()*()
L,93>.'+L(),3'L,*@)q(9(*)-5.),L(3>)T)-,'&()*Y7P18.7O+()AY53)Z)+(3.'&)[):5')3()+8'.)+85L'+)3')
T)*,)%83+%'(3%()3')T)*Y(3.(3A(L(3.)!83)&(.&852()*,)A'+483%.'83)(3.&(),--(%.)(.)%893'.'83#)(.)
:5'@)%8LL()*Y,--(%.)A()?,++5L')Z)A(L(5&()A,3+)*Y>.,.)AY'3A>.(&L'3,.'83)t8au),5%53()
+(3+,.'83)3Y(+.)1&'2'*>9'>()85)*'>()T)53(),5.&()185&)-8&L(&)A(+)%833(6'83+)A5&,M*(+)[)
!F85+.,39@)BCCv@)BB#/);8LL()%7(c)?,++5L')(3%8&(@)*()+(3.'&)%7(c)q(9(*)(+.)53()
18.(3.',*'.>)f)Z)$3).,3.):5Y(**(+)&(*O2(3.)A()*YhL(@)*(+)+(3+,.'83+)+83.)(.)A(L(5&(3.)A(+)
18.(3.',*'.>+@)(**(+)3()+83.)4,L,'+)A(+)&>,*'.>+)[/)$.)F85+.,39),485.()f)Z);(%')(+.)%,1'.,*)185&)
*,)%8L1&>7(3+'83)A5)L,93>.'+L(),3'L,*@):5')+()A>2(*811()A,3+)*()&(9'+.&()A()*YhL()
+(3.,3.(/)tiu)=(+)18.(3.',*'.>+@)383)(3%8&()(6'+.,3.(+@)+83.)A(+)%,1,%'.>+)(.)A83%)A(+)-8&%(+)
8a)%(.)'3A'2'A5)2,)18528'&)2(3'&)15'+(&/)[)"Y8a)*,)-8&%()(.)*()18528'&)A()95>&'+83)A5)
L,93>.'+L()f)Z)K*)P),)-8&%()(.)>3(&9'(@)>%&'.)F85+.,39@)1,&%():5()*()383)%83.&b*()A()*,)
%83+%'(3%()(.)A()*Y(3.(3A(L(3.)*,'++()2(3'&),5)485&@)*,'++()(3.&(&)A,3+)*()4(5@)A(+)
18.(3.',*'.>+):5')>.,'(3.)45+:5()*T).(35(+)T)*Y>%,&./)$**(+)>.,'(3.)(3),..(3.(@)L,'+),5++')(3)
&>+(&2()W)(**(+)+83.)&>'3.>9&>(+)9&h%()T)*,)*'M(&.>)A()L852(L(3.):5')*(5&)(+.)8%.&8P>()(.)(**(+)
>*,&9'++(3.)(.)'3.(3+'-'(3.)*(+)%,1,%'.>+)A()*Y'3A'2'A5)[)!Bl#/)k8.83+)(3%8&():5()185&)q(9(*)'*)
+Y,9'.)*T)AY53)>.,.)T)*,)-8'+)1,.78*89':5()(.).7>&,1(5.':5(/)X3)3()1(5.)P)&(+.(&@)L,'+)+YP)
1*839(&)*'MO&()A(+)&(++85&%(+)'3+851s833>(+/)JY,9'.R'*)AY53()+'L1*()%832(&9(3%()A()25(+)85)
A()*Y'A(3.'-'%,.'83)AY53()1&81&'>.>)-83A,L(3.,*()A()*,)2'(@)(.)(3)1,&.'%5*'(&)A()*,)2'()
,3'L,*()^)K*)(+.)'3.>&(++,3.)A()%83+.,.(&):5()%Y(+.)%(..()LSL()'3A>.(&L'3,.'83@),2(%)+83)
18528'&)A()&>9>3>&,.'83)(.)AY>*,&9'++(L(3.)A(+)%,1,%'.>+)A(+)'3A'2'A5+@)(.)1&8M,M*(L(3.)
%(..()LSL()1&>93,3%()A5)+(3.'&@):5Y83)&(.&852()A,3+)53)A8L,'3()8a)*Y,3'L,*@)(3)%7,'&)(.)
(3)8+)%(..()-8'+@)(+.)1,&.'()1&(3,3.()f)%(*5')A(+)&(3%83.&(+),3'L,*(+)(.)A()*(5&)18.(3.'(*)
.7>&,1(5.':5(/);(+)&(3%83.&(+@)185&)1(5):5Y83),%%(1.()A()28'+'3(&)53)L8L(3.),2(%)
*Y'3A>.(&L'3,.'83)A(+)Z)%78+(+)+,3+)38L)[)+5+%'.>(+)1,&)*,)1&>+(3%()AY53),3'L,*@)
&(L8M'*'+(3.)*(+)&(++85&%(+)(.)&(%83-'95&(3.)*(+)7,M'.5(**(+)L,3'O&(+)A()+()&(*'(&),5)2'2,3./))
)
;(%')385+),LO3()T)%83+.,.(&):5(@)>.833,LL(3.@)*()Z).85&3,3.),--(%.'-)[)3()+()LS*()95O&()
,5)Z).85&3,3.),3'L,*'+.()[)(3)+%'(3%(+)+8%',*(+/);Y(+.)%8LL()+')*,)&>-*(6'83)+5&)*Y>L8.'83)(.)
*Y,--(%.@).85.)(3)1&(3,3.)(3)%8L1.()*,)3(5&817P+'8*89'()(.).85.)(3)'3+'+.,3.)+5&)*()Z)383)

75L,'3)[@)1852,'.)(3)A>-'3'.'2()'938&(&):5Y,--(%.+)(.)>L8.'83+)3Y83.)1,+),..(3A5)*(+)S.&(+)
75L,'3+)185&)485(&)53)&b*()%&5%',*)A,3+)*,)+5&2'()(.)*Y8&9,3'+,.'83)A()*,)2'()+8%',*()%7(c)A()
38LM&(5+(+)(+1O%(+/)X&)+')*(+)>L8.'83+)+83.)A(+),--(%.+)A8.>+)AY53()+'93'-'%,.'83)
%832(3.'833(**(@)(.)+')83),AL(.):5()*(+),3'L,56)83.)A(+)>L8.'83+@)'*)-,5.),*8&+)+Y'3.(&&89(&)
+5&)*(+)A'-->&(3.(+)L,3'O&(+)A83.)*(+)%832(3.'83+)1(52(3.)+Y'3+%&'&()A,3+)*,)2'()+8%',*()
'3A>1(3A,LL(3.)AY53()%83+%'(3%()&>-*(6'2(/);(*,)+'93'-'():5()+')83)8118+(@)%8LL()83)*Y,)
-,'.).&,A'.'833(**(L(3.)A,3+)*Y>.5A()A(+)>L8.'83+@)*()+(3+)(.)*,)17P+'8*89'(@)(.)+')*Y>L8.'83)
(+.@)%8LL()*()1&818+()?,++5L'@)A5)%b.>)A5)+(3+@),*8&+)'*)-,5.),AL(..&()*(+),3'L,56@)(.)
1(5.RS.&().85.)*()2'2,3.@)A5)%b.>)A5)+(3+/))
)
F>->&(3%(+)M'M*'89&,17':5(+)f))
)
U,.(+83/)DjEC/)G8&L(@)J5M+.,3%()(.)A'-->&(3%(/)F>>A'.>)A,3+)I(&+)53()$%8*89'()A()*Y(+1&'.@)
.B@)0,&'+@)J(5'*@)DjrC@)BCvRBBB)
k'+M(..) F/$/) ,3A) `'*+83) w/"/) DjEE/) w(**'39) L8&() .7,3) e() <38ef) I(&M,*) &(18&.+) 83) L(3.,*)
1&8%(++(+/)Psychological.Review.ro@)BlDRBvj/)
F85+.,39@)G/)BCCv/)K3.&8A5%.'83/)K3)q(9(*/)=()L,93>.'+L(),3'L,*/)k,'++,3%()A()*Y7P138+(/)
0,&'+@)0pG)
`7(.(&(**@)?/)BCDB/)H--(%.),3A)(L8.'83/)H)3(e)+8%',*)+%'(3%()53A(&+.,3.A'39/)=8+)H39(*(+@)
J,9(/))
0(.'.L(39'3@) ;/) BCCn/) "(+%&'M'39) 83(N+) J5M4(%.'2() $61(&'(3%() '3) .7() J(%83A) 0(&+83/) H3)
K3.(&2'(e) ?(.78A) -8&) .7() J%'(3%() 8-) ;83+%'85+3(++/) Phenomenology. and. the. Cognitive.
Sciences,.v,.BBjRBnj/)
0(.'.L(39'3) ;/@) F(L'**'(56) H/@) ;,785&) U/@) ;,&.(&Rw78L,+) J/) !BCDl#/) H) 9,1) '3) k'+M(..) ,3A)
`'*+83Y+) -'3A'39+^) H) -'&+.R1(&+83) ,%%(++) .8) 85&) %893'.'2() 1&8%(++(+/) Consciousness. and.
Cognition.BB)!B#@)nvoxnnj/)7..1fyyA6/A8'/8&9yDC/DCDny4/%83%89/BCDl/CB/CCo)
I(&L(&+%7@)0/)!BCCoyBCDD#/)L'entretien.d'explicitation/)$JG)f)0,&'+)
)
)
?,&+)BCDE)
)
)
)
1
/
4
100%