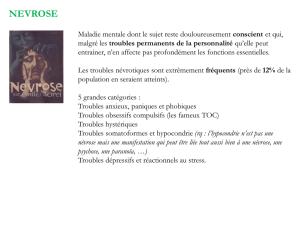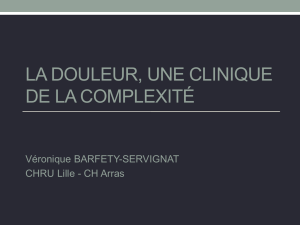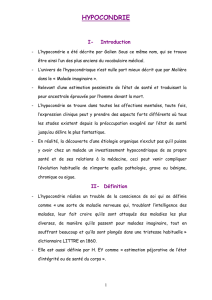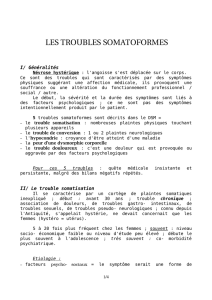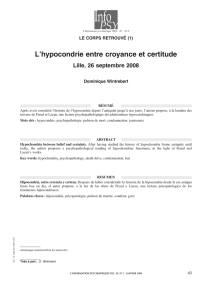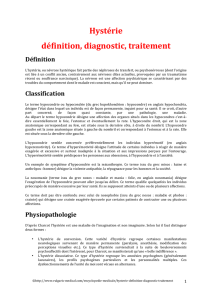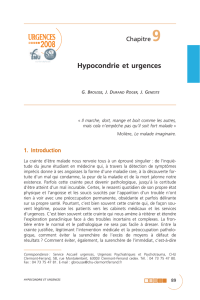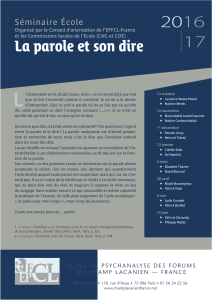Revue trimestrielle mai 2014 N° 2

le
l’EcolE PsychanalytiquE dE saintE-annE (anciEnnEmEnt institut Edouard toulousE)
Est affiliéE à l’association lacaniEnnE intErnationalE
Revue trimestrielle
en partenariat avec le Centre Hospitalier Sainte-Anne
mai 2014
N° 2
Journal de Bord

Editorial
Une psychiatrie… lacanienne
?
Marcel Czermak l’évoque
dans les pages qui suivent,
tout comme Jean-Jacques
Tyszler nous parlait, dans
notre premier numéro, des
« inventions de psychiatrie
lacanienne ».
D’aucuns penseront que nous
ne sommes pas loin de dériver
à oser adosser à la psychiatrie
cet adjectif – dérivé,
justement - du nom propre.
Lacan a rappelé cette
particularité du nom propre
à pouvoir s’employer au
pluriel, verbalement, ou
en fonction d’adjectif. La
psychiatrie, de son côté, n’a
jamais hésité à s’appuyer sur
d’autres champs que le sien,
la philosophie notamment,
pour soutenir sa doctrine,
qu’il s’agisse du jacksonisme
chez Henri Ey, de la lecture de
Bergson par Minkowski ou du
traité de Pinel dit « médico-
philosophique sur l’aliénation
mentale ».
Cette dérivation, lacanienne,
de la psychiatrie n’a de
sens qu’à vouloir amarrer
la psychanalyse, si souvent
présentée par Lacan dans sa
position extra-territoriale,
incapable - comme il est dit
dans les « variantes de la cure
type » - de faire valoir ses
propres critères au-dehors
d’elle-même. Il s’agit de savoir
si une psychiatrie qui se
soutiendrait d’une théorie de
l’objet – seule invention de
Lacan comme celui se plaisait
à le souligner – pourrait dès
lors être nommée lacanienne.
Si, comme on le lit dans le
séminaire II, « c’est par la
nomination que l’homme fait
subsister les objets dans une
certaine consistance », il s’agit
alors pour nous de tenter de
tirer les conséquences, pour
la psychiatrie, de ses apports
lacaniens.
Edouard Bertaud
Sommaire
Pour Une Psychiatrie
lacanienne :
intervention de Marcel Czermak à la Société Clinique
du 25 janvier 2014
--------------------------------------------------p. 4
Apologue :
La boîte à sardine ou la fonction du regard, par Nico-
las Dissez
--------------------------------------------------p. 12
A.L.I.énistes :
«l’hypocondrie» par Jules Cotard
--------------------------------------------------p. 16
WitZ dits, les bons mots du divan
--------------------------------------------------p. 30
Les Enfants à l’école de Sainte Anne :
Une Clinique infantile? par Eva-Marie Golder
--------------------------------------------------p. 31
Entretien avec Guy Pariente
--------------------------------------------------p. 34
Argument
journées annuelles de l’EPSA d’octobre 2014, par
Jean-Jacques Tyszler
--------------------------------------------------p. 43
Ecole Psychanalytique de
Sainte-Anne
Cycle de conférence : Présence de Jacques Lacan à l’Hôpital Sainte-Anne
Mercredi 7 mai 2014,
Marcel Czermak
«Y a-t-il une psychiatrie lacanienne ?»
Mercredi 21 mai 2014,
Françoise Gorog
« Lacan actuel»
Mercredi 18 juin 2014,
Charles Melman
«De quelques conséquences de la
présentation clinique de Lacan à Sainte-Anne»
amphithéâtre Raymond Garcin, de 14h30 à 16h30

Marcel Czermak : Allez, on va fermer la porte… C’est vraiment pathologique… l’heure! Freud
disait : « moi, j’ai des montres qui sont toujours à l’heure ! »
Nous étions à une réunion, mobilisée par Françoise Gorog et Patrick Guyomard, sur le thème
Psychanalyse et Psychiatrie1. Je commence par y faire un premier faux pas… Comme je suis
un peu élémentaire, c’est moi qui ai commencé à m’expliquer. J’aurais dû leur demander qu’ils
commencent par s’expliquer: Sur quel pied ils dansent ? Pourquoi ce thème les tourmente ? A
ce jour, je n’en ai aucune réponse. Alors moi j’ai essayé de m’expliquer maladroitement.
Je me retrouve donc invité par des gens sur qui j’ai veillé, et qui m’invitent chez moi. Je ne l’ai
pas fait remarquer, que ce soit par oubli névrotique ou par délicatesse ou dieu sait quoi ! On me
demande, chez moi:«qu’est ce que tu penses de l’aaire ?»
Donc, un eet, comme vous le voyez, d’étrangeté: on vous demande de vous expliquer et
de rendre des comptes - ce qui est forcément bienvenu, mais ce qui suppose simultanément
qu’après tous les travaux eectués, ils soient, d’une certaine façon, caducs et non advenus.
Après tous les eorts, les peines, les barouds parfois sanglants, tout cela est passé à la trappe
sans que personne n’en ait pris de la graine… Cela n’a pas été sans me peiner quelque peu, mais
je commence à avoir l’habitude! Ici même, à l’A.L.I., en arrivant, je croise l’un de mes camarades
qui sursaute et qui me dit « Ah ! Marcel, mais qu’est-ce que tu fais ici ? »… Moi, je reste zen : « je
ne fais que passer ! »
Nicolas [Dissez] sait très bien, quand on met sur la table quelque chose qui est un peu inédit,
la viscosité mentale du milieu est telle, qu’il faut vingt ans pour que ça passe l’horizon… Si ça
le passe… Donc je ne vais pas me livrer à un récapitulatif que n’importe quel étudiant serait
capable d’établir. Ce n’est plus mon job !
Je vous fais un peu d’histoire là quand même… Parce que je vois Edouard [Bertaud] et Luc
[Sibony] : vous êtes en train de réactiver notre Journal de Bord, avec un petit litige… Nous
sommes domiciliés au Centre Hospitalier Sainte-Anne, mais l’administration s’interroge pour
savoir si on peut utiliser le logo ou pas ! Je me dis : « Tu as tous les galons requis, tu as eu quelques
barouds comme tout le monde… Mais jusqu’à ce jour, à l’âge que tu as, à tes camarades et à
toi-même on nous demande de faire nos preuves ! » Je compte sur votre sens diplomatique
pour leur faire remarquer qu’on n’est pas là arbitrairement, on n’est pas là par le fait du prince !
Seulement, comme ils manquent d’informations, comme ils nous ont peu lus, l’appréhension
des problèmes leur est très cadrée. Il faut leur fournir quelques éléments.
Le jour où je suis parti à la retraite, en théorie, j’aurais dû soit organiser un pot de départ - ce
qui se fait - si vous ne le faîtes pas, c’est la direction qui le fait… Compte tenu des barouds
déplaisants qu’il y avait eus, je ne me sentais pas, moi, d’organiser un pot de départ. Peut-être
ai-je eu tort ! Cependant, il eût été bienvenu de la part de mon administration qu’elle organise
ce pot de départ, ce qu’ils n’ont pas fait de peur, probablement, que je me récuse ! Et donc il ne
se passe rien. Dernière consultation, dernier moment, un de nos inrmiers, Michel Bekses, m’a
dit « venez donc ! » Dans un coin, ils avaient préparé le champagne ! Qu’est ce qu’ils avaient fait :
au moment des grands travaux, ils avaient volé la poignée d’entrée de l’amphithéâtre Magnan,
qu’ils m’ont remise en douce, en me disant « cette poignée vous appartient ! »
Voilà un amphi, qui a été le cœur de la psychiatrie depuis 1922, sur lequel j’ai eu à veiller
pendant presque quarante ans de ma vie, en accueillant ceux qui, d’une façon ou d’une autre,
estimaient pouvoir contribuer à l’histoire de la discipline…
C’est l’un des plus beaux cadeaux qu’on m’ait fait dans la vie !
Alors le hasard fait que mercredi, l’un de nos amis cherbourgeois, m’avait donné un livre qui
vient de sortir au Seuil : Patrick Coupechoux, Un homme comme vous, sous titré « essai sur
l’humanité de la folie », avec une préface de Pierre Delion.
Simultanément, on me remet le texte d’un entretien que j’ai eu l’occasion d’avoir avec Gérard
1 Séminaire «Psychanalyse et psychiatrie, aujourd’hui et demain» organisé par l’I.H.P. de Ste Anne et la
S.F.P., mardi 26 novembre 2013
Amiel, de Grenoble - qui sera publié ou pas -
et qui s’appelle Remarques impertinentes sur
l’objet a. Je parcours rapidement à l’aube le
bouquin de Coupechoux - je ne l’ai pas lu par
le menu - Je regarde en diagonale ce que j’ai
pu raconter à Gérard et ça n’a rien à voir… Et
pourtant ça a tout à voir !
Coupechoux est un journaliste très
sympathique, avec qui j’ai passé une après-
midi pour un livre qui s’appelle Un monde
de fous. Alors le dernier s’appelle Un Homme
comme vous, essai sur l’humanité de la
folie. Alors c’est une bibliographie que j’ai
bien connue dans ma jeunesse, c’est-à-dire,
généreuse, bienveillante… et à côté de la
plaque. Parce que ça soulève tout de suite
cette question majeure de savoir si la clinique,
ce qui donne son ton, ce qui la manœuvre, ce
qui l’axe, est-ce que c’est la générosité ? Il m’est
arrivé de le dire à Lacan - je crois que c’était en
67 - il doit y en avoir une trace dans cette petite
conférence - je n’y étais pas, j’étais à l’étranger
: « Petit discours aux psychiatres », quelque
chose comme ça… Il raconte qu’il a rencontré
un jeune psychiatre qui ne pensait pas que
la générosité soit l’alpha et l’oméga de la
clinique. Ce en quoi il était d’accord. Il faisait la
remarque suivante : j’avais été le voir… J’avais
à faire à un truc un peu étrange, quand j’étais
encore un peu médecin et que je me sentais
anxieux, j’allais dans le service et je savais quoi
faire. J’avais mes arbres de décisions, mes
machins, mes trucs, j’avais l’impression d’être
quelqu’un qui tient debout. Et puis quand on
arrive dans un service de psychiatrie c’est le
contraire, on n’a qu’une seule peur, c’est de
franchir le seuil ! C’est là qu’on a l’angoisse!
Et pourquoi a-t-on l’angoisse? Précisément
parce que les fous nous demandent rien, c’est
nous qui demandons. Cette angoisse perdure
y compris dans le grand âge.
Le livre de Coupechoux, vous verrez, est
vraiment sympathique, bienveillant. C’est
bien documenté! Le rapport sur le service
des aliénés de Gérard de Cayeux de 1874,
je l’ai lu par le menu ! Vous avez toutes les
références sociologiques qui conviennent,
qui donnent le ton. Le camarade Robert
Castel, mon moins camarade Michel Foucault,
quelques anciens : Bonnafé, Rouard, Le
Guillant, Daumézon, enn toute la bande !
Tous d’ailleurs sont soit membres du parti
communiste, ou protestants. J’en passe aussi,
il y a les surréalistes, Eluard - Nous avons fait il
y a un an une réunion sur Artaud2 - les écrits
d’Artaud, et de Robert Desnos… Lettre au
médecin chef des asiles de fous…
Alors qu’est ce qu’il écrit - citons la plume
d’Antonin Artaud :
« Nous n’admettons pas qu’on entrave le libre
développement d’un délire aussi légitime,
aussi logique que tout autre succession
d’idées ou d’actes humains. La répression
d’une réaction antisociale est tout aussi
chimérique qu’inacceptable en son principe »
- tous les actes individuels seraient antisociaux
- qui irait contre? - « les fous sont les victimes
individuelles par excellence de la dictature
sociale. » De quoi parlons-nous quand on
parle de dictature sociale ? « Au nom de cette
individualité qui est le propre de l’homme,
nous réclamons qu’on libère ces forçats de la
sensibilité » - sensibilité - « puisqu’aussi bien il
n’est pas au pouvoir des lois d’enfermer tous les
hommes qui pensent et agissent. » C’est vrai,
il faudrait tous vous enfermer… Et il ajoute :
« sans insister sur le caractère parfaitement
génial des manifestations de certains fous,
dans la mesure où nous sommes aptes à les
apprécier » - vous voyez heureusement, il y
a un bémol - « nous armons la légitimité
absolue de leur conception de la réalité.»
Bien sûr ! Puisque comme Freud le disait et
Lacan après lui, le problème n’est pas la perte
de la réalité, c’est ce qui s’y est substitué. Qu’est-
ce qui se substitue à la réalité dite normale?
Et de tous les actes qui en découlent… C’est
d’ailleurs l’une des questions initiales de
Freud, puisque dans les psychonévroses de
défense, c’est là-dessus qu’il démarre : les
mécanismes. Or vous verrez que dans de
tels ouvrages, la question du mécanisme est
tout à fait opaque. Ca n’intéresse personne
! On postule toujours dans l’Autre que ces
mécanismes, ce sont les mêmes que les
vôtres. Mais que quelqu’un puisse être Autre,
avec des mécanismes Autres ! Alors là ! Un
névrosé ne peut de s’en débrouiller, et c’est
quand même au cœur de la discipline… Je ne
vais pas vous faire un récapitulatif de ce sur
quoi j’ai mis la main… Artaud disait : « je ne
demande qu’à sentir mon cerveau »… Là, il
faudrait faire un petit cours sur l’hypocondrie !
2 «La passion Artaud», journée du 9 février 2013
organisée par l’EPHEP
Intervention de Marcel Czermak à la réunion de la Société Clinique du 25 janvier 2014
Pour une
psychiatrie
lacanienne
5

Et puis, le week-end dernier nous avons relu
le texte de Freud sur le Witz3, avec la façon
qu’il a d’eeurer les fabrications langagières
des enfants, à quoi je suis amené à faire une
petite objection parce que… c’est dans ce
terme-là, glossolalie, la troisième note de
bas de page p. 201 du livre de Coupechoux :
« glossolalie, langue inintelligible que parlent
les mystiques en début d’extase », mais aussi
« langage imaginaire de certains malades
mentaux fait d’onomatopées et dont la
relative xité au point de vue de la syntaxe
et du vocabulaire permet la compréhension
dans une certaine mesure »… Vous voyez,
ça n’a rien à voir! Prenez des linguistes qui
ont traité la question des glossolalies par
exemple dans les communautés religieuses
de Sicile… Néo-langage qui vise à une seule
chose, maintenir l’unité de la communauté,
cependant qu’à l’examen n de ce qu’ils
formulent, on s’aperçoit que la morphologie
de fond est celle d’une langue qui n’a rien
d’inventif et que néanmoins, comme c’était
évoqué lors de notre réunion, la semaine
dernière, sur la question du sens et du non-
sens, évidemment qu’il y a du sens dans le
non-sens, dans certains cas… On imagine
qu’on a compris ! Et ça maintient l’unité et la
cohésion.
Alors maintenant vous reprenez Artaud, «
Interjections » :
maloussi toumi
tapapouts hermafrot
emajouts pamafrot
toupi pissarot
rapajouts erkanpfti
Voila… Je ne vais pas vous balancer tout
le texte. A un examen linguistique un peu
précis, c’est quelque chose qui apparaîtra
hors langue, hors syntaxe…
Avec des remarques, dans le livre de
Coupechoux, tout à fait excellentes : «
Ne devient pas fou qui veut. » Citation
fort bienvenue : « l’être de l’homme, non
seulement ne peut être compris sans la folie,
mais il ne serait pas l’être de l’homme s’il ne
portait pas en lui la folie comme limite de
sa liberté. » Qui ne pourrait y souscrire ? Le
problème, c’est que ne devient pas fou qui
3 Séminaire d’hiver de l’ALI: «l’inconscient
s’amuse», 18 et 19 janvier 2014
veut ! Qu’est ce qui fait que quelqu’un, dans
telle conjoncture, sollicité de telle manière,
son monde change ! En un instant, ce n’est
pas progressif, ça pivote !
Donc, comme vous voyez, je lisais cela.
Dans ce livre, l’accent est surtout mis sur la
psychothérapie institutionnelle. Tosquelles,
qui avait appris la psychiatrie en lisant la thèse
de Lacan, relayée par Jean Oury, disait que
la psychothérapie institutionnelle n’existait
pas et que seule était valable l’analyse
institutionnelle.
Donc, je pourrais vous débiter cela, larga
manu... « L’aventure de la psychose » ... Ce
sont des choses très bienvenues ! ... « En fait, le
comportement de l’observateur modie celui
de l’observé », cela les physiciens nous l’ont
appris de longue date ! La psychanalyse et le
transfert, aussi bien ! ... « Et Bonnafé se réfère
de nouveau à Jacques Lacan, pour qui la folie
change de nature, avec la connaissance qu’en
prend le psychiatre »... C’est vrai ! Qu’est ce
qu’on en fait in ne ? Tous pareils ! Donc, si
je parle, celui à qui je m’adresse est supposé
être sur la même longueur d’onde que moi ?
... Qu’est ce que j’en sais ?!
D’un autre côté, je passe deux heures avec
notre ami Gérard Amiel, de Grenoble, en
prévision d’un éditorial pour la Revue
Lacanienne qui s’intitule « Remarques
impertinentes sur l’objet a »... Et, cela n’a
absolument rien à voir !
Vous vous demandez si vous avez le même
intérêt, le même job, si ce à quoi vous avez
aaire, est du même tonneau ou pas ! Il y a
un mur entre les deux, même si ça a l’air
d’avoir des anités, si ça se ressemble,
si ça a des sympathies, voire même des
embranchements communs.
Il arrive donc que tel ou tel ami me pose cette
question ; quand Pierre-Yves Gaudard est
arrivé dans le service, au bout de six mois il
me demande: « l’objet a c’est quoi ?! ». Rien
qu’avec ça, on change la face des choses ! Je
ne vais pas vous récapituler la teneur de cet
entretien, vous en aurez un résumé dans le
prochain numéro de la Revue Lacanienne,
mais il y a de quoi se demander pourquoi on
rame!
Je vais à une réunion et certains de vos
camarades, dont certains de la S.P.P.,
ont fait une grande ache : « Entretiens
psychanalytiques en milieu psychiatrique
». C’est comme si on disait « entretiens
maritimes en milieu psychiatrique », vous
prenez un tonton de la marine marchande,
vous le balancez dans un service, et voilà !
C’est une espèce de greon, parce que quand
même, pour apprendre à parler le même
langage, il faut au moins dix ans, au moins…
Et encore… Du coup, je me demande ce
que j’ai fait ! Et qu’est-ce que je viens faire là
? J’étais payé comme psychiatre… et après
tout, ce qui a constitué, justement, l’objet de
la discipline, en ce qui concerne certains de
mes camarades et moi-même, nous avons
essayé de l’aner, puisqu’une discipline se
spécie par son objet, sa méthode, et sa
théorie. La méthode étant en rapport avec
la théorie et l’objet ! Même si l’objet change
! Dans toute science, on a vu l’objet changer,
la théorie et la méthodologie changer. Et on
vient nous empoisonner, en nous demandant
: « qu’est-ce que vous avez de scientique ? »
C’est ce que nous balancent ceux de l’HAS !
Ils vous balancent un paquet d’items, en vous
disant: évaluation scientique ! Mais moi, je
voudrais qu’on me dise ce que c’est que la
science ? Qu’est ce que j’ai fait, moi ? J’ai fait
quelque chose de non scientique ? Si c’est
le cas, qu’on m’explique en quoi ça ne l’était
pas ! Charge à moi-même de dire en quoi ce
qu’ils fabriquent, ne l’est pas plus ! Puisque
le propre de la science, c’est évidemment à
chaque fois, une dimension transgressive !
Toute l’histoire des sciences est une histoire
de la transgression: Galilée, Semmelweis,
Harvey, Michel Servet, y compris Pasteur…
Pasteur avait le tort d’être pharmacien, toute
la médecine était contre lui ! Donc, je ne
connais aucun pas de la science qui n’ait été
une transgression, voire un coup de force.
Evidemment, nos appareillages administratifs
et juridiques se sont tellement perfectionnés,
qu’on peut se demander jusqu’à quel point
l’ouverture à la recherche est maintenue, dès
lors qu’elle est tellement balisée. Prenons ce
débat actuel sur l’euthanasie. Historiquement,
le magistrat ne tranchait pas entre Galien et
Hippocrate… Débrouillez-vous ! Vous avez
prêté serment, il s’agit de votre science et de
votre conscience et personne n’a à vous dire
comment vous conduire… Sauf cas agrant
etc.… Là, on voudrait baliser le terrain pour
savoir qui on tue ou pas.
Voilà ce que je voulais vous dire …
(désignant sa montre qu’il est en train de
remettre à son poignet) : C’est un coup du
Professeur Kreisel, vous connaissez ? Logicien
d’origine viennoise, ayant fait toute sa carrière
aux Etats-Unis et ayant parcouru tout le
vingtième siècle.
Un jour, j’entends, en cercle restreint, le
Professeur Kreisel faire un cours sur l’histoire
de la logique au vingtième siècle. Il enlève sa
montre, la met dans sa poche, puis il parle,
il nit son exposé et nous dit : « je vous ai
parlé trois quarts d’heure », Il sort sa montre,
c’était bien ça, c’était le temps d’un cours
à l’université de Vienne ! Donc je viens de
vous rééditer le coup du Professeur Kreisel !
J’aimerais bien vos remarques !
Cyrille Deloro : Il y a six ans, lors de ma
soutenance de thèse, vous m’avez demandé
s’il y avait une psychiatrie lacanienne
Marcel Czermak : Oui !
Cyrille Deloro : Je vous avais répondu oui, et
j’ai même eu le sentiment que je vous avais
rencontré là-dessus, principalement. S’il y
a bien quelque chose qu’ils ne sont plus en
mesure d’entendre, à Sainte-Anne, c’est qu’il
y a une psychiatrie lacanienne. Ils ne savent
plus faire le rapport entre psychanalyse
et psychiatrie, parce qu’ils alient Lacan
à quelque chose qui ne serait plus de la
psychiatrie.
Marcel Czermak : c’est une grave question, à
laquelle je serais bien en peine de répondre…
Quand j’ai débarqué dans cet hôpital, il y avait
une consultation, avec des psychanalystes de
la S.P.P. : Renard, Mallet, Bourdier et d’autres…
Comme adjoints : Charles Melman, Edmond
Sanquer, voilà. Moi je suis venu après… Ca ne
posait pas de problème, ça faisait du débat,
ce n’est pas la même chose ! Moi, je n’ai pas
supplié Georges Daumezon pour qu’il me
téléphone un jour en me disant je vous prends
comme assistant et comme adjoint ! Le jour
où j’ai fait les papiers idoines, Daumezon
me dit : « on vous a pris à l’unanimité du
jury ! » Pourtant je n’avais pas beaucoup de
titres ni de travaux ou de services rendus…
A l’unanimité ! Là, j’apprends quoi ? On me
dit d’un côté : les lacaniens, on ne peut pas
7

parler avec eux ! L’un de mes chers camarades
de l’A.L.I. va raconter à l’étranger : « Marcel est
un type avec qui on ne peut pas travailler !
»… Inch Allah ! De l’autre côté - ça, c’était les
psychanalystes - pour les psychiatres, pareil !
Ca, c’est la question de l’objet a ! Comment,
en interne, vous devenez tricard ! Vos propres
camarades disent : « on ne peut pas travailler
avec lui ! »… C’est peut-être la dénition
même que donnait Lacan de l’objet a: Ca ne
joue pas le jeu, ça vous emmerde…
Moi, je n’ai pas toujours connu ça, c’est une
nouveauté qui s’est installée insidieusement,
et qui participe d’un mouvement général des
sciences, c’est-à-dire que la psychanalyse n’est
pas un isolat !
Cyrille Deloro : Vous leur auriez dit, ce soir-là,
qu’il y a une psychiatrie lacanienne, cela leur
aurait paru très poétique !
Marcel Czermak : C’est ce que m’a dit Maud
Mannoni ! Un jour, je fais un exposé et elle me
dit : « Ah, c’est très poétique ce que vous avez
raconté, mais c’est trop psychiatrique » ! Oui,
texto ! … Donc il y a évidemment beaucoup
de donneurs de leçons dans l’aaire… Texto…
Les gens de ma génération étaient tous
en analyse. Ils étaient tous tombés sur un
divan… On ne peut pas dire que cela ait servi
à grand-chose ! Comme je l’ai souvent dit, ils
attendaient l’illumination, un jour, sur le divan,
ils allaient comprendre ! Ils avaient tout jeté
par-dessus bord ! Tout ! La culture, la culture
classique, les éléments de la discipline de
l’histoire des sciences etc. « On fonctionne de
manière économique, avec la psychanalyse
on aura tout pigé ! » Le résultat, on le connaît !
Le week-end dernier, on lisait le Witz, avec
toutes les dicultés de Freud, énormes, des
pistes gigantesques… Mais d’être prises sur
la selle de la névrose, font que jusqu’à ce
jour - puisque Freud rapproche les enfants,
les psychotiques, les états toxiques, qui sont
hétérogènes - on a manqué le coche. Quand
je le dis à mes camarades qui s’occupent
d’enfants, ils se vexent… Ils me l’ont dit. Un
jour ou j’avais fortuitement à faire un exposé
sur la névrose infantile, je leur ai dit : la clinique
des enfants est une clinique molle… Ils se sont
tous vexés. Je pense aussi bien que la clinique
des adultes est molle, mais cela a vexé tout
le monde. Et qu’est ce qu’on me dit : « Tu sais
bien, nous aussi on reçoit des adultes ! » Mais
sur quel pied ? Avec quel outillage ? Voilà, des
choses traînent comme cela, y compris avec
des conits débiles ! A ce point qu’on ne peut
plus lire les grandes revues professionnelles,
que ce soit la revue de l’Association française
de psychiatrie ou d’autres. C’est devenu
illisible parce que faute de pouvoir simplier
les problématiques, on les a complexiées de
telle manière que c’est devenu illisible. Je ne
les lis plus, je les parcours et je les jette à la
poubelle.
Evidemment, maintenant il y a un problème
politique : le gouvernement nous demande
des comptes en permanence. L’accréditation,
c’est tous les trois ans !
Nicolas Dissez : je rajoute un mot à la suite
de ce qu’indique si justement Cyrille Deloro.
La remarque de Mannoni est transcrite dans
Ornicar, après le topo sur le déclenchement
des psychoses. Elle vous dit : « vous êtes resté
trop attaché à la médecine. »
Marcel Czermak : Oui ! Elle m’a sorti ça, j’avais
oublié !
Nicolas Dissez : ce qui montre la doxa de
l’époque, quand même. C’est-à-dire que
l’analyse devait se détacher du discours
médical. Quiconque avait nit son analyse,
quittait l’hôpital et allait s’installer. Si j’entends
bien la formule de psychiatrie lacanienne
que Cyrille propose - je ne l’aurais jamais
osée, mais je la trouve juste, et plus que ça -
c’est quand même l’esprit de Lacan quand il
donne sa conférence à l’école de médecine :
la psychanalyse doit subvertir la médecine et
la psychiatrie.
Marcel Czermak : Lacan dit dans cette
conférence : « je suis un missionnaire auprès
des médecins », si je ne me trompe pas…
Nicolas Dissez : oui ! Donc l’enjeu, c’est une
subversion de la psychiatrie, tout en y restant
lié.
Olivier Oudet : Si on considère la médecine
comme une science, cette subversion
régulière de la médecine, par le fait même
qu’elle est scientique doit avoir lieu. Ce qu’il
y a d’incroyable, c’est qu’elle ne peut pas avoir
lieu. C’est ce qui est saisissant. De toute façon,
l’interrogation conceptuelle, quand ça ne
marche pas, on ne l’accepte pas ! Qu’est ce
qu’a fait Freud ? Il a accepté d’être interrogé
par les hystériques et il s’est fait éjecter ! Le
dogme physico-chimique est d’une puissance
incroyable en médecine, armé - je pense - par
tout l’appareil de promotion…
Danièle Brillaud : Je ne comprends
pas pourquoi on continue à dire que la
psychanalyse serait scientique. Cela ne
me paraît pas être la bonne voie. Si la
science forclot le sujet, il est évident que la
psychanalyse, traitant le sujet, ne le forclot
pas, elle ne peut donc pas être scientique,
cela ne l’empêche pas d’être rigoureuse.
La science telle que je l’ai vue pratiquée
pendant vingt ans dans le service Ollier, ne
m’a pas du tout paru rigoureuse, alors que la
psychanalyse l’est.
Marcel Czermak : Vous avez travaillé pendant
vingt ans dans un service qui se piquait d’être
scientique !
Danièle Brillaud : Je leur laisse ! Je leur laisse
ce terme ! Il ne me fait pas envie.
Nicolas Dissez : On ne demande pas au
Droit d’être scientique. Les juges travaillent
tranquillement. Jamais on ne va leur dire que
leur discipline n’est pas scientique ! Ils savent
être rigoureux et on ne vient pas les ennuyer
avec la science !
Marcel Czermak : Donc ce sont des questions
de logique… C’est-à-dire que nous sommes
des cloches au regard des types de logiques
que nous mobilisons. Parce qu’après tout… Si
le sujet est forclos de la science, qu’il revient
entre les pattes des psychanalystes, qu’est ce
qui ferait que ce ne soit pas scientique…
C’est probablement une erreur de Lacan. Y
a-t-il moyen de scienticiser cette question de
l’objet et du sujet ? C’est peut-être aussi un des
enjeux de la psychanalyse. Alors, c’est d’une
autre science qu’il s’agit. C’est comme les
mathématiciens. Il y a les types qui marchent
avec les règles euclidiennes. S’ils ne font plus
des mathématiques euclidiennes, ce ne sont
plus des scientiques ! Il est quand même
avéré, qu’avec du non-euclidien, on faisait
des choses plutôt amusantes ! Comment
explique-t-on que le plus près soit le plus
éloigné et que le plus éloigné soit le plus
proche ? Comment peut-on pivoter d’espace
en un clin d’œil, etc., etc.
Je crois savoir que les mathématiciens
s’engueulent ! Simplement cela ne provoque
pas des réactions politiques, parce que,
évidemment, ça ne touche pas excessivement
la vie des ménages !… Je ne sais pas comment
vous vous êtes maintenue depuis plus de
vingt ans dans l’endroit qui nous était le plus
hostile, ce qui n’est pas vrai d’ailleurs ! Ils ont
été justement, plutôt généreux ! Et vous, on
ne vous a pas tuée !
Danièle Brillaud : on m’a laissé travailler
tranquillement, à condition que je n’aie
aucune responsabilité d’aucune sorte.
Marcel Czermak : On a l’autorité de la
responsabilité qu’on exerce et la responsabilité
de l’autorité ! On ne peut pas découpler
autorité et responsabilité !
Danièle Brillaud : il ne fallait pas qu’il soit
marqué que j’étais responsable d’unité.
Marcel Czermak : ce sont des entourloupes
bien connues, les aléas de la vie
administrative…
Luc Sibony : Juste une observation, quant
à ce qu’il en est de la psychiatrie à l’hôpital
aujourd’hui. On en vient à se demander
si la psychiatrie aujourd’hui est toujours
une discipline au sens où je vois bien que
mes collègues psychiatres ne savent plus à
quel saint se vouer : il y a du bon dans tout,
la remédiation cognitive, il y a des trucs
intéressants à prendre… La psychanalyse
ça nous apprend sur le névrosé et ça nous
parle…
Marcel Czermak : C’est formidable: «ça me
parle !» Il faudrait voir ce que ça dit !
Luc Sibony : je constate donc cette
impossibilité à se repérer, à s’arrimer.
Marcel Czermak : ce n’est pas leur faute, c’est
la faute de leurs maîtres ! Leurs maîtres, c’est
9
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%