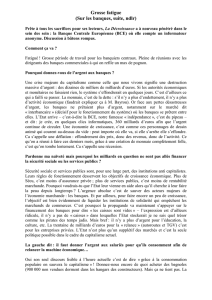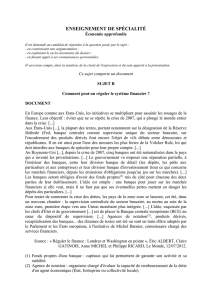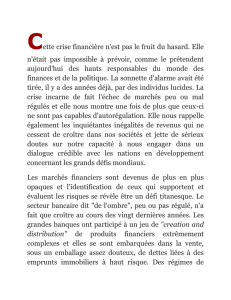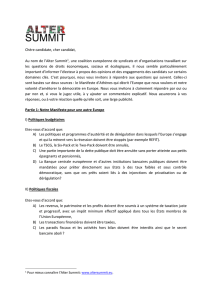Opportunistes mais pas cupides

3eme trimestre 2009 •53
Opportunistes
mais pas cupides
«Amalgamer cupidité et opportunité,
c’est confondre désir et activité sexuelle. »
Robert Reich, Supercapitalisme
dIdIer rIbadeau duMaS
Associé de Courcelles, conseil en stratégie
L’opinion maudit les banquiers et les innovations financières qu’on leur doit.Traders,
spéculateurs, arbitragistes,hedge funds,banques d’investissement, gestionnaires
d’actifs,banques privées,régulateurs et banques centrales,tous regroupés sous le
vocable réducteur de «banquiers»,voilà nommés les responsables de la crise.Àqui
attribuer les responsabilités ? Quelle part donner à chacun ? Et quel sens donner à
ce désordre?
Pour les uns, c’est la crise du libéralisme :Joseph Stiglitz a raison contre
Adam Smith. Pour d’autres, c’est la crise du capitalisme :Alain Badiou
prend sa revanche sur Francis Fukuyama. Pour d’autres encore, c’est une
crise éthique :Bernard Maris1condamne la cupidité des dirigeants d’en-
treprise et des spéculateurs que Plantu caricature un cigare au bec. Prenons un peu
de recul par rapport à des généralisations rapides, revenons aux faits, rappelons ce
qui fonctionne et ne fonctionne pas et expliquons pourquoi2.
Dérive ou progrès ?
En 2007, des doutes apparaissent sur la valeur de certains crédits dits «subprime ».
Ces crédits sont mal notés parce qu’accordés à des acquéreurs de biens immobiliers
dont on sait par avance queles revenussontinsuffisantspour qu’ils puissent les
1. Rédacteur en chef adjoint de Charlie Hebdoet économiste.
2. Cet article fait partie d’une série de réflexions mises sur le site de Courcelles Conseil (www.cconseil.fr), et sur
Débat&co (www.debateco.fr).

54 •sé °65
D : è d
rembourser.Les prêteurs parient quand même sur un remboursement :ils comptent
sur la plus-value qui sera réalisée un jour,dans un contexte de la hausse sans fin de
l’immobilier.
En somme,une spéculationimmobilièrealimentée par le crédit. Qu’y a-t-il de nou-
veau ?Premièreinnovation:les distributeursdeces prêts ne les gardentpas dans
leur bilan. Ilsles apportent àdes fonds montés par des banques qui les vendent àdes
investisseurs :d’autres banques, des compagnies d’assurance,des fonds de pension, des
gestionnaires d’actifs, des entreprises, des collectivités publiques, des particuliers, etc.
Deuxième caractéristique :les banquesqui transforment ces prêts en instruments
d’épargne y logent des tranches d’actifs de différentes sortes où les crédits risqués
voisinent avec des crédits de meilleure qualité.
Troisième particularité :les banques qui montent ces produits d’investissement pro-
cèdent à des arbitrages entre les différentes classes d’actifs dont les profils de risque
varient3.
Dernier point, ces fonds ne sont accessibles qu’à des investisseurs avertis qui doivent
attester de leur compétence et de leur expérience,ce qui conduit à relativiser certai-
nes protestations tardives d’investisseurs déçus par l’évolution de leurs placements ou
à s’interroger sur la responsabilité des intermédiaires qui les leur ont offerts.
Tant que le prix de l’immobilier américain continue de monter,il y a un marché
pour ces fonds. Faute d’un régulateur du marché immobilier,une bulle se forme;
comme toutes les bulles, elle est appelée à exploser un jour4.
La valeur de certaines tranches des fonds d’investissement comprenant des actifs
devenus toxiques se révèle inférieure à celle qui était escomptée.La baisse des cours
entraîne un gel des transactions. Certaines banques qui ont commercialisé des fonds
contenant ces actifs suspendent temporairement la cotation de ces produits ;d’autres
3. Les imperfections du marchéfont qu’à un moment donné la valeur relative de deux actifs peut se trouver en
décalage (l’un vaut plus cher – ou moins cher – que l’autre compte tenu de leurs niveaux de risques respectifs).
L’arbitragiste achète une classe d’actifs sous-cotée et vend l’autre. Lorsque le marchérevient à la normale,l’arbitra-
giste réalise un profit. Au passage, il contribue à repositionner les prix relatifs des deux actifs à leur bon niveau et il
apporte de la liquidité au marché. L’opérateur peut également proposer à des clients investisseurs les actifs dont les
rendements sont les plus élevés par rapport à leur niveau de risque.
4. Pour une dizaine de dollars, tous les économistes du monde peuvent se procurer A Short History of Financial
Euphoria,pénétrante analyse que John Kenneth Galbraith a publiée en 1990.

3eme trimestre 2009 •55
Opportunistes mais pas cupides
établissements maintiennent une cotation en prenant à leur charge les écarts consta-
tés. Parallèlement, la crise immobilière américaine se propage rapidement au-delà
des seuls achats effectués par des emprunteurs désargentés. Elle atteint des biens de
valeur,financés par des crédits qu’on croyait de qualité.
Les directions générales de banques qui n’en ont pas encore une conscience aiguë
développent une meilleureperceptiondelafragilité des modèles développéspar
leurs équipes et de la difficulté de valoriser des actifs composites. À la réaction de
leurs clients, elles prennent également conscience de l’impact sur leur image d’opé-
rations par lesquelles elles ontvendu des actifs plus rémunérateurs que les actifs sans
risque en prétendant qu’ils n’étaient pas risqués.
La communauté des banques prend enfin conscience que certaines d’entre elles sont
engagées dans le montage de fonds qu’elles devrontd’une manière ou d’une autre
reprendre dans leur bilan. La méfiance s’instaure;ces banques ne trouvent plus de
crédit pour se refinancer.L’Administration américaine organise le sauvetage de quel-
ques-unes d’entre elles jusqu’à la faillite de Lehman Brothers, sorte de répétition du
meurtre d’Abel par Caïn.
Alors, haro sur l’innovation financière?
Petit retour en arrière pour répondre à cette question, qui passe par un rappel des
travaux de trois économistes emblématiques :Fisher Black,Robert Merton et Myron
Scholes.
Dans les années1970, Fisher Black et MyronScholes mettent àjour la relation
entreleprixd’une option et les variations de prix du bien sur lequelelleporte
– ils inventent le modèle Black and Scholes, universellement utilisé par les traders.
Robert Merton contribue à cette découverte et sa collaboration lui vaut de partager
un prix Nobel d’économie avec MyronScholes en 1997 ;àcette date,Fisher Black
est déjà décédé,mais sa contribution est saluée par le jury.
Avec le modèle de Black and Scholes, le coup d’envoi est donné à une série d’inno-
vations financières majeures qui permettent de mieux couvrir les risques que courent
les banques, les compagnies d’assurance,les gestionnaires d’actifs, les entreprises et
les investisseurs de toutes sortes. Dans le domaine financier,il s’agit en particulier
des risques de variation du cours des devises, de variation des taux d’intérêt et d’in-
solvabilité des contreparties.

56 •sé °65
D : è d
Ces innovations financièressontdéveloppées dans des banquesd’investissement
puis dans des départements spécialisés des grandes banques universelles ;les ges-
tionnaires d’actifs les exploitent également ;des transfuges de ces établissements se
mettent à leur compte et créent des hedge funds qui se lancent, qui dans des opéra-
tions d’arbitrage, qui dans la gestion dite alternative, qui dans la spéculation.
En achetant et en vendant les instruments qui permettent ces couvertures, ces
établissements font parfois des profits, parfois des pertes. Les pertes peuvent être
importantes mais, pour conserver la confiance de leurs créanciers et des investisseurs,
ces établissements restent généralement discrets sur leur compte.Les profits peuvent
également être importants mais, à l’inverse,ils sont volontiers rendus publics par des
acteurs soucieux d’annoncer à leurs actionnaires et à leurs clients qu’ils tiennent les
promesses de haut rendement qu’ils leur ont faites.
Doit-oncondamner Fisher Black,RobertMerton, MyronScholes pour avoir décou-
vert des modèles économiques inconnus avant eux ?Doit-oncondamner les pionniers
de l’innovationfinancièreàcause de la crise ?Doit-oncondamner les banques qui ont
constitué des équipes et risqué des capitaux pour exploiter le potentiel des innovations
financières àleur profit et àcelui de leurs clients ?Doit-oncondamner les autorités
chargées de surveiller les banques, les opérations financières et les marchés ?
Ces questions font volontairement dériver la responsabilité de la crise des chercheurs
en finance vers les praticiens de la finance et des praticiens de la finance vers les
régulateurs. Pour aller plus loin dans l’analyse, rappelons maintenant quelques faits
qui relèvent de l’histoire des institutions et des systèmes financiers.
A long way
Le grand mouvement de dérégulationdes économies occidentales commence dans les
années 1970 avec la déréglementationdes transports aériens aux États-Unis. Le monde
de la finance n’est pas àlatraîne.Lemouvement s’accélèrepour lui avec le Big Bang par
lequel Mme Thatcher libéralise les activités financières sur la place de Londres en 1986. À
compter de cette date,les banques américaines font pressionsur l’Administrationdeleur
pays en menaçant de délocaliser leurs opérations àLondres. Le mouvement s’accélère.
Avant ces changements,l’activité des banques était corsetée par de nombreuses régle-
mentations. Dans notre pays,comme dans beaucoup d’autres, la création monétaire

3eme trimestre 2009 •57
Opportunistes mais pas cupides
était largement régulée via le contrôle de la distribution du crédit par les banques.
La masse totale des nouveaux crédits était fixée une fois par an. L’allocation de cette
masse entre les différents secteurs de l’économie était assurée par le gouvernement
via des institutions spécialisées dans l’agriculture, l’artisanat, l’hôtellerie,le logement,
la pêche,les PME, les coopératives, les exportations, etc. L’allocation des crédits était
administrée – les ministres se réservaient le droit d’annoncer les enveloppes, qui au
congrès des agriculteurs, qui à celui des artisans, etc.
Ce système avait ses avantages :c’était le politique qui orientait les moyens financiers
disponibles vers les secteurs qu’il entendait privilégier.Il avait ses inconvénients :les
critères économiques ne présidaient pas aux arbitrages entre les secteurs ni, nécessai-
rement, au choix des investissements. Autre inconvénient :l’encadrement du crédit
figeait les parts de marchéet supprimait la concurrence entre banques, aux dépens
des emprunteurs.
Dans les années 1980, l’encadrement du crédit est supprimé.La variation du taux de
la Banque centrale devient le principal levier de régulation de la demande de mon-
naie.EnFrance,les circuits de financement spécialisés
sont progressivement banalisés ;la décision d’autoriser
toutes les banquesàdistribuerlelivretAàpartirde
janvier 2009 montre le temps qu’il a fallu pour parcou-
rirlamajeurepartie du chemin. Le financement de
l’économie est le plus largement possible laissé à l’initia-
tive de banques ;lefinancement de la plupart des inves-
tissements dépend de leur rentabilité économique.
La dérégulation ne se traduit pas par une libéralisation
totaledes activitésbancaires, mais parune globalisa-
tion des contraintes qui leur sont imposées. Conscient
de l’importance des risques systémiques liés à la faillite
d’une banque –lesouvenir de celle du Kreditanstalt en 1931 hante encoreles
esprits –, le régulateurassortit l’exercice du métier de banquier d’une exigence de
fonds propres minimums. Le niveau des fonds propres requis est proportionnel aux
risquespris, catégorie de risques par catégorie.Ces risques sont modélisés –on
retrouve l’idée que les risques sont modélisables.
Dernier élément de la mutation des institutions financières :le Glass-Steagall Act,
institué par les États-Unis en 1933 pour distinguer les activités autorisées aux ban-
l déég
d
pp
bé
d
vé
b,
mp
gb
d
q
mpé.
l déég
d
pp
bé
d
vé
b,
mp
gb
d
q
mpé.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%