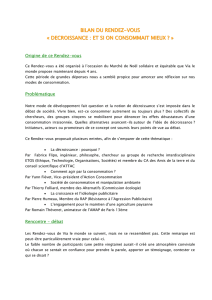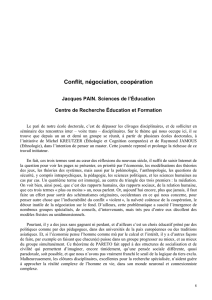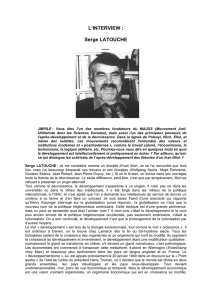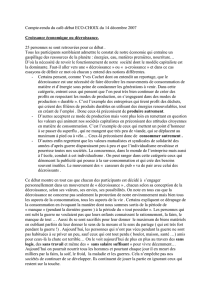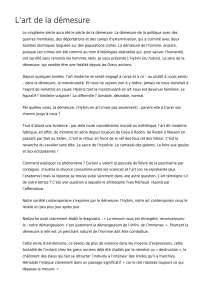Une question de taille Olivier Rey

Une question de taille
Olivier Rey
Les bonnes feuilles de l’ouvrage…
Le marché contient la violence, aux deux sens du verbe « contenir » ; le
marché prévient l’expression directe de la violence en médiatisant la
lutte pour se faire reconnaître par l’autre à travers l’acquisition de
« biens » ; mais cette lutte générale est aussi le premier carburant qui
fait tourner la machine. C’est pourquoi, si l’économie se grippe, si la
croissance qui adoucit les antagonismes s’évapore, la violence menace
de resurgir sous les formes les plus brutales. Quant au rythme de
consommation à maintenir sans cesse, il ne peut être atteint qu’au prix
d’un pillage et d’une destruction de la nature. Mais celle-ci s’épuise. Au
bout d’un moment, la violence « externalisée » et les passions déréglées
reviennent assaillir l’homme sous la forme d’un dérèglement des
équilibres naturels. La violence guette, d’autant plus terrible qu’on a
oublié dans l’intervalle les anciens accommodements avec elle.
***
Les ravages causés au monde ne sont pas seulement une source de
nuisances, ils nourrissent aussi le sentiment diffus d’un sacrilège au sein
même de sociétés qui prétendent en avoir fini avec le sacré. Significatif à
cet égard l’emploi du mot « pollution » ; Littré dans son dictionnaire

définissait ainsi le mot : « profanation, souillure. Certains péchés
d’impureté. »
Il ne s’agit pas d’être contre la technique mais contre ses métastases qui
se mettent à détruire les conditions les plus élémentaires
d’épanouissement. Le progrès technique a toujours été ambivalent. Que,
globalement, les avantages l’aient longtemps emporté sur les nuisances
ne signifie pas que tel soit le cas indéfiniment. Comme l’a noté Simon
Weil « plus le niveau de la technique est élevé, plus les avantages que
peuvent apporter des progrès nouveaux diminuent par rapport aux
inconvénients » -, jusqu’au moment où les inconvénients dominent.
Hormis la bonne volonté, rien ici-bas n’est absolument bon et, pour tout
type de technique, d’activité ou d‘organisation, il existe un seuil au-delà
duquel le développement devient contre-productif et nuit à la situation
qu’il était censé améliorer. La règle concerne non seulement le niveau
de développement mais aussi sa vitesse.
***
L’œil aérien embrasse trop vaste, il nous révèle un monde sans rapport
avec celui que notre corps est à même d’habiter, tout en nous dérobant
les détails qui sont pour nous véritablement signifiants. On peut,
éventuellement, mettre des noms sur certaines villes, montagnes,
rivières que l’on voit. La nature n’est pas faite pour être regardée de si
haut ni pour défiler derrière les vitres à la vitesse des trains rapides ou
des voitures sur l’autoroute car là aussi notre rapport au monde est
anéanti, parce que nous ne faisons plus partie du même espace que ce
que nos yeux nous donnent à voir.
***
L’école ne pourrait retrouver une certaine vigueur qu’en acceptant, au
préalable, un rôle limité. Ceux qui, au lieu de prôner comme Illich une
déscolarisation de la société, en appellent à une rescolarisation de

l’école, doivent comprendre que la première ne s’oppose pas à la
seconde mais en est une condition nécessaire. Car c’est la prétention de
l’école à être la grande éducatrice qui lui ôte désormais toute possibilité
de se démarquer du monde tel qu’il va. Elle ne saurait à la fois constituer
une zone à part, protégeant les jeunes d’une société entièrement livrée à
l’économie et à la consommation, et élargir toujours davantage son
emprise, ce qui finit fatalement par la mettre en phase avec ce qu’elle
prétendait tenir à distance.
***
Une société qui a récusé toute transcendance, tout lien positif au passé,
tout mythe et tout rite qui ménagent une place à la mort au sein de la vie
et réduit l’existence des personnes à la stricte période qui s’étend de la
naissance au décès, se dédouane de la détresse aride à laquelle elle
abandonne les mourants et leurs proches par un dernier baroud
thérapeutique - après quoi on n’en parle plus. Le coût de ce baroud
devenant considérable, au point de choquer la logique économique qui
veut que les ressources soient affectées, en priorité, au développement
des forces productives, la sympathie grandit envers les personnes
disposées à hâter leur fin par un suicide assisté : l’aliénation à la
technique et aux services est si complète que même le suicide doit être
pris en charge.
***
La dissociation entre fins et moyens, qui augmente fatalement avec la
division du travail, doit donc apporter de grands bénéfices pour être à
même de compenser les inconvénients qui lui sont inhérents. Et là
encore, au-delà d’un certain seuil, le bilan devient négatif. Quand la
spécialisation devient trop poussée, le clivage entre moyens et fins trop
extrême, l’obtention de la fin ne compense plus les sacrifices auxquels il
a fallu consentir dans la mise en œuvre des moyens, l’augmentation de

la production ne rattrape pas l’appauvrissement humain qu’à nécessité
son obtention.
N’est-il pas significatif que le premier souci d’une politique économique,
aujourd’hui, ne soit pas de satisfaire des demandes matérielles mais de
créer des emplois. La production, qui était le but du travail est devenue
un moyen d’en fournir. D’où le caractère hagard de la vie contemporaine.
Même les plus atroces débauches de consommation, pour ceux qui
peuvent s’y livrer, ne rendent pas ce qui a été perdu dans la dissociation
complète des moyens et des fins car la consommation laisse inassouvi
un besoin fondamental de l’être humain qui est d’agir, ou du moins d’en
avoir la possibilité.
Il est vrai que selon certains utopistes, les progrès de la technologie et
de l’automatisation pourraient faire régresser le temps de travail
nécessaire dans de telles proportions que l’existence se trouverait
presque entièrement vouée aux loisirs. Le malheur est que dans ce cas
la gratuité du loisir, qui fait une grande partie de son charme en
contraste avec les activités nécessaire, deviendrait une malédiction, tant
il est vrai que la liberté ne s’épanouit pas à l’écart de la nécessité mais à
son contact, ou du moins dans son voisinage permanent.
Les machines ne doivent pas être trop efficaces afin que puisse s’établir
un équilibre sain entre ce que nous tirons de l’industrie et ce que nous
avons besoin de faire par nous-mêmes. Les bons outils - ceux que Illich
nomme « conviviaux » -, sont ceux qui augmentent l’autonomie de la
personne. Les mauvais outils sont ceux qui ne sont plus à la mesure de
la personne et qui dépassent complètement ce que l’utilisateur est à
même de se représenter.
***
La propriété n’a pas disparu, loin de là, mais elle tend à se concentrer
toujours davantage au sein de grandes firmes qui, au lieu de vendre
quelque chose, donnent accès à des services qui, lorsqu’ils
s’interrompent laissent la personne parfaitement démunie : on devient
locataire de sa propre existence.

***
La taille de la société influe sur la formation du caractère. Plus la
personne est amenée dans ses activités quotidiennes à côtoyer des
individus nombreux et qu’elle connaît peu ou pas du tout, plus elle tendra
à développer envers eux de l’indifférence ou des conduites utilitaires.
C’est ainsi qu’une société trop étendue et trop ouverte, que certains
imaginent le meilleur antidote au repli sur soi, favorise au contraire
l’égoïsme.
Pour Léopold Kohr (auteur de « The breakdown of nations » publié en
1957), il n’y a pas de détresse sur terre qui puisse être soulagée sauf à
petite échelle. Dans l’immense tout s’effondre même le bien car, comme
il apparaîtra avec de plus en plus d’évidence, le seul et unique problème
du monde n’est pas le mal mais la taille excessive. C’est pourquoi par
l’union ou l’unification, qui augmente la masse, la taille et la puissance,
rien ne peut être résolu. Au contraire, la possibilité de trouver des
solutions diminue au fur et à mesure que le processus d’union avance.
L’unification c’est la solution de l’effondrement spontané.
Le système fonctionne qu’au pris de deux grands maux : le premier est
une homogénéisation, un nivellement du monde pour autant que l’argent
évalue de la même façon toute la diversité des choses.
Le second est une démesure intrinsèque. Aristote distinguait l’économie,
l’art de pourvoir aux besoins et au bien-être. Ce que nous persistons à
appeler économie est en réalité une économie déréglée parce qu’il n’y a
aucune limite à la richesse et à la propriété. Finalement, le renoncement
moderne à chercher à orienter la vie selon le bien pour ne s’en remettre
qu’aux désirs des individus, aux régulations du marché et aux principes
de sélection darwiniens n’est, sous l’emballage de discours experts,
qu’une forme de retour à l’animalité.
***
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%