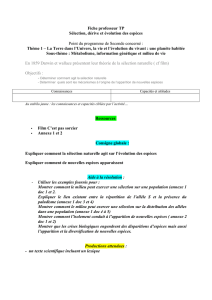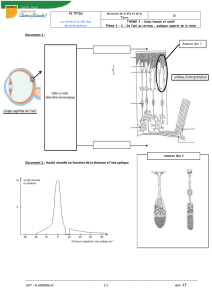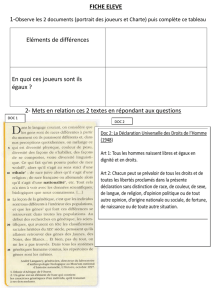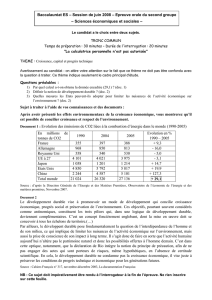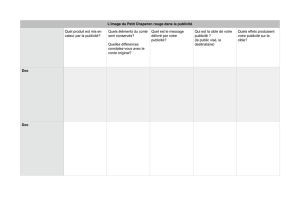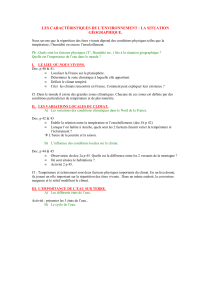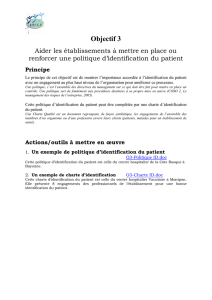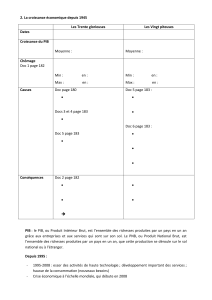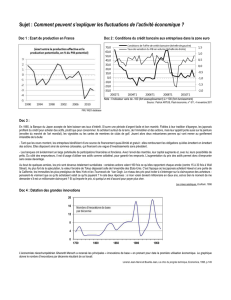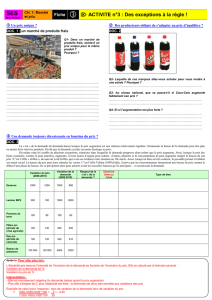Télécharger le fichier - Fichier

Regards historiques
sur le monde actuel
Histoire
Sous la direction de
Pascal ZACHARY
Lycée Henri-Poincaré, Nancy (54)
Vincent ADOUMIÉ
Lycée Dumont-d’Urville, Toulon (83)
Géraldine ANCEL-GERY Lycée Charles-Baudelaire, Cran-Gevrier (74)
Christian BARDOT Lycée Lakanal, Sceaux (92)
Catherine BARICHNIKOFF Lycée Carnot, Paris (75)
Fabien BÉNÉZECH Lycée Rouvière, Toulon (83)
Fabien CONORD Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand II (63)
Emmanuelle IARDELLA-BLANC Lycée Christophe-Colomb, Sucy-en-Brie (94)
Pascale JOUSSELIN-MISERY Lycée Charles-Baudelaire, Cran-Gevrier (74)
Sahondra LIMANE Lycée Albert-Schweitzer, Le Raincy (93)
Emmanuel MOUREY Lycée Jacques-Callot, Vandœuvre-lès-Nancy (54)
Étienne PAQUIN Lycée Henri-Poincaré, Nancy (54)
Jean-Yves PENNERATH Lycée Jean-Victor-Poncelet, Saint-Avold (57)
Corentin SELLIN Lycée de Costebelle, Hyères (83)
Alain VIGNAL Lycée Dumont-d’Urville, Toulon (83)
David YENDT Lycée René-Descartes, Saint-Genis-Laval (69)
Tles
L/ES
Auteurs
LIVRE DU PROFESSEUR

© H L
SOMMAIRE
THÈME 1 Le rapport des sociétés à leur passé
Chapitre 1 Le patrimoine : lecture historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Chapitre 2 Les mémoires : lecture historique
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
THÈME 2 Idéologies, opinions et croyances en Europe et aux États-Unis
de la fi n du xixe siècle à nos jours
Chapitre 3 Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne depuis 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Chapitre 4 Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France
depuis l’aff aire Dreyfus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Chapitre 5 Religion et société aux États-Unis depuis 1890
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
THÈME 3 Puissances et tensions dans le monde
de la fi n de la Première Guerre mondiale à nos jours
Chapitre 6 Les chemins de la puissance : les États-Unis et le monde depuis 1918 . . . . . . . . . . . . . . . 72
Chapitre 7 Les chemins de la puissance : la Chine et le monde depuis 1919
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Chapitre 8 Un foyer de confl its : le Proche et le Moyen Orient
depuis la fi n de la Première Guerre mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
THÈME 4 Les échelles de gouvernement dans le monde
de la fi n de la Seconde Guerre mondiale à nos jours
Chapitre 9 Gouverner la France depuis 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Chapitre 10 Le projet d’une Europe politique depuis 1948
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Chapitre 11 La gouvernance économique mondiale depuis 1944
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Chapitre 1 - Le patrimoine : lecture historique • 3
© H L
1 Le rapport des sociétés à leur passé
1 Le patrimoine : lecture historique p. 16-53
Thème 1 – Le rapport des sociétés à leur passé
Question Mise en œuvre
Le patrimoine : lecture historique Une étude au choix parmi les trois suivantes :
- le centre historique de Rome ;
- la vieille ville de Jérusalem ;
- le centre historique de Paris.
◗Nouveauté du programme de terminale
La question aborde sous un angle historique la notion de patri-
moine. Cette approche est nouvelle et doit permettre aux
lycéens, à travers l’exemple que le professeur choisira (Rome,
Jérusalem ou Paris), de poser les problématiques essentielles
liées à la lecture historique du patrimoine des villes anciennes.
L’histoire du patrimoine urbain n’est pas synonyme de l’étude
de l’histoire de la ville. Pour autant on ne saurait s’abstraire des
connaissances factuelles et chronologiques. C’est pourquoi les
études débutent par une double page « Repères » consacrée à
dresser un tableau synthétique de l’histoire plurimillénaire de
chacune des trois villes. La transmission du patrimoine se fait
toujours au présent, et c’est ce dernier qu’il s’agit de faire émer-
ger pour chaque époque, le regard de l’histoire permettant cette
mise à distance. Pour l’élève, il s’agit d’apprendre à voir.
◗Problématiques scientifi ques du chapitre
• Patrimoine et histoire
Le patrimoine est à décrypter, le paysage urbain ne parle pas de
lui-même. L’historien est le médiateur qui donne à comprendre
le bâti en le replaçant dans un passé restauré dans toutes ses
dimensions. L’histoire révèle les usages successifs que chaque
époque attribue au patrimoine des périodes qui l’ont précédée.
L’histoire montre que le patrimoine est constitué de morceaux
choisis, sélection faite à chaque époque pour des motifs qui
varient selon les enjeux que l’on prête au patrimoine. Pour com-
prendre la notion de patrimoine et son usage, celui-ci doit faire
l’objet d’une enquête historique. Les méthodes de l’historien
arrachent au vestige et à l’archive les éléments qui expliquent
l’action d’origine, l’élément déclencheur.
• Les villes anciennes
Les villes anciennes sont le fruit de contributions millénaires,
de couches successives qui forment des strates à l’origine d’un
patrimoine archéologique à découvrir. Elles sont formées d’une
partie visible et d’une autre enfouie. La dialectique entre ville
ancienne et ville nouvelle émerge à chaque époque. La superpo-
sition des époques conduit à détruire, à construire mais l’usage
fréquent du remploi, qui consiste à réutiliser dans une construc-
tion un élément architectural qui a appartenu à un édifi ce
antérieur, peut être considéré comme un fi l liant les époques et
les hommes. Le vandalisme dénoncé pendant la Révolution fran-
çaise oblige à s’interroger sur la conservation ou non des vestiges
d’un passé avec lequel on se considère en rupture. Comment se
défaire des emblèmes de la monarchie tout en conservant les
bâtiments ? L’évolution du patrimoine des villes est marquée par
de vastes entreprises de modernisation, d’interventions auto-
ritaires, sélection de modèles, éliminations d’éléments jugés
négligeables pour valoriser ceux qui s’accordent avec les impé-
ratifs nouveaux.
• Évolution de la notion
La notion de monument historique se construit progressivement
entre le xve siècle et la première moitié du e siècle. Celle de
patrimoine urbain historique est plus tardive et date du milieu du
e siècle. Les « secteurs sauvegardés », créés par André Malraux,
ont pour but d’amener le visiteur à découvrir le bâti dans son envi-
ronnement. Car ce n’est pas seulement la qualité du bâtiment qui
fait son intérêt mais également le tissu urbain auquel il est lié, qui
le rattache à une histoire, à des pratiques collectives. Les quartiers
anciens sont alors pris en compte dans leur globalité, constituant
des tissus dont la trame doit être traitée dans son ensemble. Cet
intérêt pour le patrimoine s’inscrit dans une volonté de se pré-
munir contre la perte de mémoire et la dilution d’une identité, et
c’est ainsi que ce fort désir de mémoire émerge pour faire face aux
mutations économiques et sociales contemporaines. La réfl exion
porte sur ce qui doit être préservé, comme témoignage excep-
tionnel ou signifi ant d’une époque, d’une société.
Le culte du patrimoine amène parfois à des versions d’un passé
qui se teinte de nostalgie. La dévotion au patrimoine ne fait pas
histoire.
Le concept est d’une grande richesse, les champs concernés
s’étendent du patrimoine matériel au patrimoine immatériel
mais le programme, par les choix des « Mises en œuvre », invite
à concentrer la réfl exion sur le patrimoine urbain. Il s’agit de
mettre en valeur les sens politique, culturel et sociétal qui, dans
leurs liens avec la mémoire collective, l’héritage national et
l’identité, forgent la compréhension des centres historiques des
trois villes du programme.
• Enjeux contemporains
Depuis les années 1960, les pays occidentaux portent davan-
tage d’attention à la notion de patrimoine, notamment à travers
les politiques culturelles qu’ils développent. Le patrimoine et
sa conservation s’inscrivent dans un cadre plus large, celui des
modalités politiques, culturelles, sociales par lesquelles une
société défi nit son rapport avec le passé et la conception de son
présent comme de son futur. Les villes anciennes fascinent par le
pittoresque de leurs monuments et de leurs rues mais les néces-
sités de la modernité et des besoins contemporains obligent à
s’interroger sur les usages du passé. Aujourd’hui, de nouveaux
usages sont assignés au patrimoine, il doit être rentable. Les
coûts de préservation, de conservation, de restauration, mènent
parfois à des choix qui soulèvent des oppositions, font appel à la
privatisation d’un patrimoine public. Les enjeux commerciaux ou
les concurrences mémorielles freinent parfois les investigations
critiques du passé.

4 • Chapitre 1 - Le patrimoine : lecture historique
© H L
La question est bien celle de savoir pour quel usage conserver
ou restaurer et quel état privilégier tout en s’aff ranchissant
des modes et des pressions. Le e siècle négligeait le e et
n’admirait que les bâtiments anciens ; le désintérêt du e siècle
pour l’architecture du e est largement lié à la méconnaissance
de techniques de conservation e caces pour l’architecture
métallique ; actuellement, la prime à l’ancien s’accompagne sou-
vent d’une certaine indiff érence pour l’actuel. Le patrimoine a un
rôle fédérateur, c’est un instrument de lien social et d’identité
collective, mais la vigilance est nécessaire car nul pays n’est à
l’abri de tentatives de récupération à des fi ns nationalistes ou
identitaires.
◗Quelques notions-clés du chapitre
• Patrimoine : le terme romain de patrimonium manifeste une
légitimité familiale qu’entretient le patrimoine. Le mot désigne
l’ensemble des biens, des droits hérités du père (quelquefois
par opposition, en ancien français, à matremoigne, matrimoine).
En France, la notion de patrimoine s’élabore au moment de la
Révolution française. L’État doit prendre en charge le patrimoine
de la noblesse et de l’Église, les deux ordres les plus riches, dans
le souci d’inventorier, d’identifi er, de reconnaître et d’inscrire au
crédit de la nation « qui donne une sorte d’existence au passé ».
S’élabore alors la notion d’un patrimoine supérieur aux vicissi-
tudes de l’histoire et digne d’échapper à la destruction, soit du
fait de la valeur des œuvres menacées, soit du fait de l’intérêt
pour l’éducation et pour l’histoire.
• Enjeux du patrimoine : concept évolutif qui se conjugue au
pluriel. Longtemps considéré comme une aff aire de spécialistes,
le patrimoine est aujourd’hui l’objet de manifestations qui ren-
contrent un public toujours plus nombreux, mais il ne peut se
résumer à une accumulation de monuments ou d’objets et doit
être mis à disposition de manière raisonnée. Une pédagogie du
patrimoine doit accompagner une politique culturelle refondée
pour éviter deux écueils majeurs : que la pression patrimoniale
soit non sélective, ce qui ferait du tout patrimonial un obstacle
à une cité vivante, et tendre vers un patrimoine qui favoriserait
les divisions au sein des sociétés.
◗Débat historiographique
L’intérêt grandissant pour le patrimoine convoque un champ de
plus en plus large, tout paraît patrimoine car tout est chargé
d’histoire et de société. Le concept est objet d’histoire récent,
Les Lieux de mémoire, de Pierre Nora, et les travaux d’André
Chastel ont jeté les bases d’un appareil critique. Certains dénon-
cent un culte du patrimoine qui se transforme en fétichisme
(Françoise Choay). Les débats liés aux questions patrimoniales
ont toujours été virulents, rappelons que les travaux de Viollet-
le-Duc voient encore s’opposer pourfendeurs et partisans, ou
comment les passions patrimoniales déclenchent d’épiques
joutes verbales ici, qui prennent parfois un caractère violent, là.
Les groupes d’intérêts, les pouvoirs de toutes sortes peuvent
instrumentaliser le patrimoine et en faire un espace qui divise. A
contrario, le patrimoine peut permettre la rencontre avec l’alté-
rité, les valeurs qui nous sont parvenues à travers le patrimoine
peuvent être utilisées pour construire.
◗Bibliographie sélective
Généralités et Paris
J.-Y. A, Patrimoine et histoire, Belin Sup, 1997.
P. B, Le Patrimoine : culture et lien social, Presses de
Sciences Po, 1996.
F. B, Des monuments historiques au patrimoine, du xviiie siècle
à nos jours, Flammarion, 2000.
P. B , M. N, Histoire du Palais Royal, Actes Sud,
2010.
F. C, L’Allégorie du patrimoine, Seuil, 1999.
Paris, une capitale dans l’histoire, Scérén, coll. Dévédoc, CNDP, 2005.
Y. L, L’Alchimie du Patrimoine, éditions de la Maison des
sciences de l’homme d’Aquitaine, 1996.
J. L G (dir.) Patrimoine et passions identitaires. Actes des
Entretiens du Patrimoine, Fayard, 1997.
F. L (dir.), Ville d’hier, ville d’aujourd’hui en Europe, Actes des
Entretiens du Patrimoine, Fayard, 2001.
P. N (dir.), Les Lieux de mémoire, t. I. et II, Gallimard, 1986.
P. N (dir.), Science et conscience du patrimoine, Actes des
Entretiens du Patrimoine, Fayard, 1997.
H. R (dir.), Le Regard de l’Histoire, Actes des Entretiens du
Patrimoine, Fayard, 2003.
M.-A. S, La France du patrimoine, Découvertes Gallimard,
1996.
Rome
M. A, Le Temps en ruines, Galilée, 2003.
A. A, Rome, Art et Archéologie, Scala, Florence, 2000.
« Fellini Roma », l’Avant-Scène Cinéma, n° 129, 1972.
« Rome et ses palais », Dossiers d’archéologie, n° 336, nov.-déc.
2009.
A. G, A. V, Rome, L’idée et le Mythe, du Moyen Âge
à nos jours, Fayard, 2000.
C. M, À la recherche de la Rome antique, Découvertes
Gallimard, 1989.
J. N, Rome, ville ouverte au cinéma, édition de L’Aube,
2010.
J.-N. R, Rome, Les Belles Lettres, 2002.
Jérusalem
J.-P. C, S.-A. S, Atlas des Palestiniens, un
peuple en quête d’un État, éditions Autrement, 2011.
Dossiers Archéologie, Jérusalem, 5000 ans d’histoire, n° 165-166,
nov.-déc. 1991.
F. E, A. N, Atlas géopolitique d’Israël, éditions
Autrement, 2008.
F. E, F. T, Géopolitique d’Israël, Point essais, 2006.
l. G, S. N, Dôme du Rocher, Albin Michel, 1996.
R. G, Les Mosquées, Novebook, 2006.
A. G, Vers la terre d’Israël, Découvertes Gallimard, 2008.
National Geographic Jerusalem, décembre 2008.
« Jérusalem, La ferveur et la guerre », Qantara, Magazine des
cultures arabe et méditerranéenne, Institut du monde arabe, 2009.
◗Sites internet
Rome
http://whc.unesco.org/fr/list/91 : site de l’Unesco.
http://fr.museociviltaromana.it/: site du musée de la civilisa-
tion romaine.
Jérusalem
http://whc.unesco.org/fr/list/148 : site de l’Unesco.
Paris
http://alpage.tge-adonis.fr/index.php/fr/: Alpage est un
programme de recherche, initié en 2006. Des historiens,
géomaticiens et informaticiens construisent ensemble un sys-
tème d’information géographique (SIG) sur l’espace parisien
préindustriel.
http://paris-atlas-historique.fr/1.html : ce site est dédié à la
représentation de l’évolution historique de Paris.
http://whc.unesco.org/fr/list/600 : site de l’Unesco.
Une vidéo très intéressante est consultable sur le site de
l’UNESCO à l’adresse suivante : http://whc.unesco.org/fr/
list/600/video
Introduction au chapitre p. 16-17
À travers l’exemple d’une grande ville ancienne, le programme
invite à s’interroger sur la place du passé dans les sociétés
contemporaines à travers l’étude du paysage urbain. Traiter de

Chapitre 1 - Le patrimoine : lecture historique • 5
© H L
ce que nous apprend la lecture du patrimoine par les historiens
sur les sociétés du passé est la question centrale. Il s’agit bien
de montrer comment les historiens interrogent le patrimoine et
quels outils ils élaborent pour le comprendre. Par ailleurs, si le
patrimoine est le résultat des choix faits à toutes les époques, il
est l’objet d’enjeux majeurs pour les sociétés du temps présent.
Ces enjeux ne sont pour autant pas du même ordre selon l’étude
choisie. Si Paris et Rome, malgré leurs particularités, partagent
un nombre important d’enjeux communs, la lecture historique
du patrimoine de Jérusalem invite nécessairement à une analyse
géopolitique de la situation du Moyen-Orient.
→Doc. : Détail de l’arc de Titus sur le forum antique de Rome,
fi n du ier siècle.
Le bas-relief de l’arc de Vespasien et de Titus à Rome rappelle
la prise de Jérusalem par les Romains en 70 et la destruction du
Temple. Les soldats romains portent en triomphe les objets pil-
lés dans le temple de Jérusalem en particulier le chandelier à sept
branches en or. On peut voir les ustensiles du Temple (le chan-
delier et les trompettes), portés en cortège par des légionnaires
romains couronnés de lauriers. La représentation du chandelier
à sept branches ne correspond pas exactement à celle qui en
était donnée au moment du règne d’Hérode.
→Doc. : La tour Eiff el illuminée par Citroën, 1925.
Inaugurée le 15 avril 1889, la tour Eiff el reçut 28 millions de
visiteurs dès les six premiers mois de son ouverture. Jugée
« monstrueuse et inutile », elle choqua à l’époque. Bâtie en deux
ans à l’occasion de l’Exposition universelle, elle fut, jusqu’en
1931, le plus haut bâtiment du monde. La tour Eiff el, aisément
reconnaissable à sa forme, dominant tout Paris, est omnipré-
sente sur de multiples supports et connaît immédiatement une
rapide et considérable fortune iconographique. Expression de la
France industrielle et de la République triomphante, monument
laïc et démocratique, objet de fi erté nationale, la tour Eiff el est
le symbole du progrès technique. À la veille de l’ouverture de
l’exposition internationale des Arts Décoratifs en 1925, le fabri-
cant d’enseignes lumineuses Jacopozzi vient proposer à André
Citroën de faire de la tour Eiff el une enseigne publicitaire. Elle
s’éteindra défi nitivement en 1935 lors de la reprise de l’entreprise
par Michelin. La tour Eiff el est le monument le plus visité de
Paris, elle reçoit chaque année 6 millions de visiteurs.
Repères p. 18-19
Rome
Il ne saurait être question de retracer en détail l’histoire pluri-
millénaire de Rome tant celle-ci est foisonnante et marquée par
nombre d’aff rontements et de conquêtes pour cette ville capi-
tale. Il s’agit ici de rappeler quelques-uns des moments-clés qui
jalonnent l’histoire de la ville pour mieux comprendre les enjeux
politiques et religieux que revêt l’histoire du centre historique de
Rome sans cesse remanié.
→Doc. : La Rome antique vue à l’époque moderne.
Le Colisée est visible à travers les trois colonnes remontées du
temps de Castor et Pollux, les Dioscures. La présence de per-
sonnages et la reconquête de la nature sur la pierre donnent à
ce tableau une vision romantique des ruines dont le succès sera
immense au e siècle.
→Doc. : Le centre historique de Rome.
La « Rome historique » est comprise dans l’anneau des murs
d’Aurélien (e siècle) : la Rome de l’Antiquité et du bas Moyen
Âge, ainsi que celle qui vit le jour entre 1500 et 1600. Elle
condense la majeure partie des témoignages architecturaux
du passé. La Rome contemporaine s’est peu à peu superposée
à cette Rome monumentale. Rome est aussi la capitale d’un
État dit « moderne » et ne peut être traitée comme un grand
monument historique à préserver, soumis à des contraintes et à
des normes. Il faut faire coexister d’exceptionnels témoignages
historiques et artistiques avec les fonctions et les besoins d’une
ville moderne.
→Doc. : Plan du centre historique de Rome.
Centre historique de Rome, les biens du Saint-Siège situés
dans cette ville bénéfi cient des droits d’extra-territorialité tout
comme Saint-Paul-hors-les-Murs. Le site du patrimoine mon-
dial, étendu en 1990 jusqu’aux murs d’Urbain VIII, comporte
quelques-uns des principaux monuments de l’Antiquité tels que
les forums et le mausolée d’Auguste, les colonnes de Trajan et de
Marc Aurèle, le mausolée d’Hadrien, le Panthéon, ainsi que les
édifi ces religieux et publics de la Rome papale.
Étude 1 p. 20-23
Rome, une mise en scène de la puissance sans cesse
renouvelée
Rome se prête tout particulièrement à l’étude historique du
patrimoine du fait de l’ancienneté de l’occupation humaine et
de l’imbrication des époques à travers les monuments. Deux
moments phares de l’histoire de Rome sont ici privilégiés : la
Rome antique et la Rome papale. L’accent est mis sur des élé-
ments-clés du patrimoine : le rôle du pouvoir et des mécènes
pour faire de Rome tour à tour la ville maîtresse d’un vaste
empire et la capitale de la chrétienté. Il s’agit aussi de montrer
que le regard porté sur le passé varie à chaque époque et que la
Rome d’aujourd’hui ne restitue pas celle d’hier.
. Qu’est-ce que la lecture historique du forum nous
apprend de la Rome antique ? p. 20-21
→Doc. : Les vestiges du forum.
Le Forum romain se développe progressivement à partir du
esiècle av. J.-C. Pendant plus de 1 000 ans, il fut le cœur de
la vie spirituelle, politique et commerciale de la ville. Pavé, cet
immense espace ouvert s’enrichit progressivement d’un certain
nombre de bâtiments, de statues, de colonnes, de temples et de
sanctuaires, d’arcs de triomphe qui témoignent de la grandeur
de Rome. À partir du e siècle ap. J.-C., il fut peu à peu délaissé.
Utilisé comme forteresse au Moyen Âge, pillé puis abandon-
né, il est devenu « champ aux vaches » (Campo Vaccino). Les
seuls édifi ces conservés furent ceux transformés en église. S’y
côtoient des édifi ces d’époques diff érentes rendus uniformes
par le temps.
→Doc. : La colonne Trajane sur le forum antique, IIe siècle.
La colonne de Trajan est haute de plus de 30 m. Elle est consti-
tuée de 17 cylindres de marbre. La colonne devait servir de tombe
à l’empereur, ses cendres y furent placées dans une urne. Elles
furent volées au Moyen Âge. Sur l’extérieur de la colonne, se
déroule une spirale recouverte de bas-reliefs racontant les deux
guerres conduites au début du IIe siècle par Trajan contre les
Daces. La précision des détails est extrême (2 500 personnages).
La largeur des bandes augmente au fur et à mesure que l’on va
vers le haut, de sorte que du bas, elles apparaissent toutes de
même dimension. Un escalier en colimaçon occupe l’intérieur.
Des terrasses permettaient, à l’époque, d’admirer les bas-reliefs ;
elles sont évoquées dans le document 4 (l. 24 à 28). Une petite
chapelle fut construite bien plus tard, adossée au soubassement
de la colonne, appelée Saint-Nicolas-de-la-Colonne, dont le clo-
cher était dans la colonne elle-même. Elle fut démolie en 1500
par ordre de Paul III. Autour de 1587, la statue de Trajan sur le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
1
/
156
100%