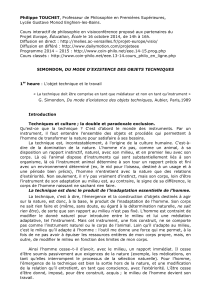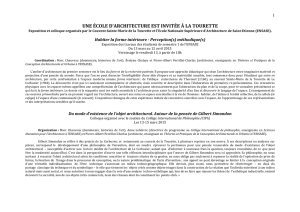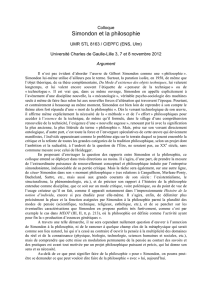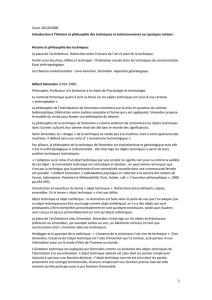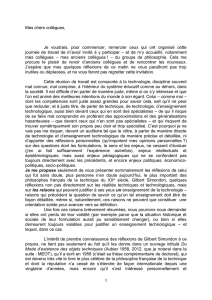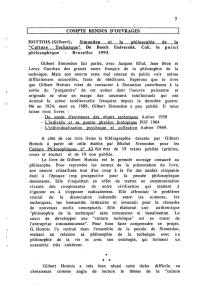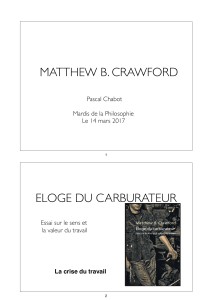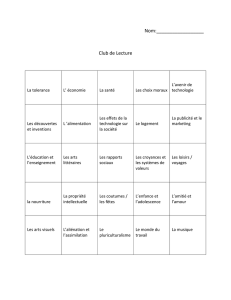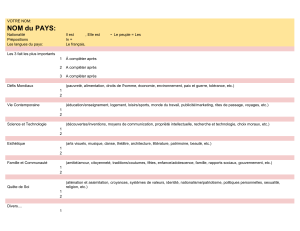Télécharger au format pdf

Apprendre à devenir technicien :
un pan oublier de la citoyenneté ?
Sébastien Charbonnier
dans M. Fabre et P. Mustière (dir.), Jules Verne. Science, technique et société : de quoi sommes-nous
responsables ? Nantes, Coiffard Éditeur, 2010, p.349-361.
La réalité de l’expérience technique, pour le maximum d’individus, est à la fois triviale et obscure :
j’allume mon ordinateur, je téléphone, je prends ma voiture, je nettoie mon linge. Et ça marche !
« Tant mieux », pensera-t-on… Mais prenons le temps d’interroger ce rapport que nous
établissons quotidiennement dans l’usage des objets techniques. Loin des figures fantasmées de la
robotique1, c’est bien plutôt dans les objets techniques ordinaires que se jouent les plus décisifs
choix pour notre liberté et notre émancipation. Qu’en faisons-nous, qu’en attendons-nous, en
quoi dépendons-nous d’eux ? Qui est le maître dans ce rapport homme-machine ? C’est à
considérer cet ordinaire qu’on s’autorisera à penser le problème de la « responsabilité citoyenne »
vis-à-vis de la technique.
1 – Les vertus de la culture technique
En guise de point de départ, je propose de prendre au sérieux cette invitation de Gilbert
Simondon, assurément l’un des plus grands philosophes de la technique :
Il peut se développer un goût technique, comparable au goût esthétique et à la délicatesse morale. Bien des
hommes se conduisent de manière primitive et grossière dans leur relation aux machines, par manque de
culture. La frénésie de possession et la démesure d’utilisation des machines est comparable à un véritable
dérèglement des mœurs. Les machines sont traitées comme des biens de consommation par une humanité
ignorante et grossière, qui se jette avec avidité sur tout ce qui présente un caractère de nouveauté
extérieure et factice, pour le répudier aussitôt que l’usage a épuisé les qualités de nouveauté.2
Si la technique pose un problème, selon Simondon, ce n’est donc pas en elle-même. Trop
souvent, la technique est personnifiée et condamnée comme si elle possédait une volonté propre
et un devenir autonome – encore une fois, le fantasme du robot qui se retourne contre son
créateur est récurrent. Le diagnostic du « trop de technique » n’est pas pertinent : la technique
n’est pas en excès elle-même, elle est en défaut pour nous. Le problème posé par Simondon
concerne les possibilités de la technique pour nos usages : c’est strictement un problème
d’éducation à la technique. L’objet technique n’est absolument pas dangereux en soi, le danger
1 Plaisant dans le domaine de la science-fiction, l’association de la machine technique à l’idéal-type du
robot de plus en plus perfectionné témoigne de notre ignorance de la technique, ignorance qui se
transforme en images fantasmées et magiques des possibilités de la technique. Cf. Gilbert Simondon, Du
Mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958, p.10-11.
2 Gilbert Simondon, L’Individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Million, 2005 (1958),
p.521.

provient uniquement du mésusage humain ; il faut ajouter : ce mésusage n’est pas d’abord dans ce
qu’on en fait – potentialités destructrices de la technique –, mais dans notre ignorance de son
fonctionnement. Ce dernier point constitue un drame beaucoup moins perceptible, mais
infiniment plus réel. Les peurs de la bombe atomique accaparent beaucoup plus facilement
l’attention que les dangers d’utiliser sa voiture sans être capable de comprendre le
fonctionnement de son moteur ; c’est pourtant à ce deuxième genre de danger que Simondon
voulait nous rendre sensibles ! Avec un demi-siècle de recul, le devenir de nos sociétés lui donne
raison : la guerre atomique reste un scénario de science-fiction, mais l’aliénation technique et
économique aux moyens de transport est une réalité quotidienne qui touche une grande partie de
la population. Par exemple, le calcul de la vitesse généralisée d’une voiture permet de voir que,
sous le masque du progrès, ce moyen de transport a aliéné la plupart de ses usagers.3 Par ce calcul
beaucoup plus réaliste sur l’efficacité d’un moyen de transport, la voiture se retrouve derrière le
vélo : l’ignorance du fonctionnement technique de la voiture accule son utilisateur à devoir
travailler plus pour payer un objet technique qui lui est devenu complètement obscur – son
entretien, sa durée de vie, ses réparations sont hautement monnayables. Ce qui est vendu, ce n’est
plus un objet en tant qu’outil technique, c’est la sujétion elle-même. J’achète une expérience ou
un sentiment (pouvoir rouler vite !). C’est l’expérience elle-même qui devient marchande : la
médiation technique de cette expérience, complètement ignorée du consommateur, devient en
fait un pur prétexte à lui faire dépenser son argent. L’objet s’efface devant le service acheté : on
peut bien m’« offrir » un téléphone portable dès lors que je me lie par un contrat qui me
ponctionne mensuellement de l’argent pour que je puisse faire l’expérience de la
« communication ».4
Contre les clichés sur la froideur de la technique, Simondon nous interpelle sur le fait que c’est
l’oubli de la technique qui nous accule à un isolement de plus en plus absurde et une vie de plus
en plus marchandisée. Au contraire, l’enjeu d’une vie plus riche et plus libre passe par une
éducation à la culture technique. Simondon sait très bien que cette exigence de liberté va à
l’encontre de ce qu’il appelle « l’humanisme facile », cette désagréable pédanterie « cultivée » qui
fait fond sur l’opposition dualiste de l’intellectuel et du manuel. À ce titre, la culture technique
possède déjà plusieurs vertus curatives.
(a) Elle protège de certains schèmes symboliques de la division du travail social : si mon vélo a un
problème, je peux le réparer moi-même ; je n’ai pas l’idée de laisser cette tâche « subalterne » à un
individu dont le travail est implicitement dévalorisé par la culture anti-technique.
(b) Devenir un citoyen-technicien est une perspective qui vaut critique d’un partage devenu
consensuel entre le travail d’un côté, et le loisir de l’autre. Si j’ai un problème avec mon vélo, je
peux le saisir comme l’occasion joyeuse d’apprendre et de comprendre ! Le terme « problème »
n’est plus synonyme d’ennui, il est l’amorce d’un processus de pensée : « alors, qu’est-ce qui est
déréglé ? d’où provient le dysfonctionnement ? » Une panne devient l’occasion d’une petite
enquête joyeuse qui sollicite mes puissances de penser et de faire. Mais nous n’avons pas que cela
à faire, objectera-t-on ! Voilà peut-être le vrai problème : quelle hiérarchie implicite admettez-
vous avec autant d’évidence pour rejeter l’occasion de goûter l’événement, la surprise ? Peut-être
êtes-vous pressé parce que vous devez aller au travail, ce travail dont le salaire est indispensable
pour rembourser le crédit de la voiture… De fait, l’aliénation à des conditions de travail pénibles
a renforcé, depuis au moins un demi-siècle, la dichotomie entre travail et loisir dans l’esprit des
Occidentaux. Pourquoi les plaisirs de l’usage technique (écouter sa musique le soir, rouler avec sa
voiture le week-end) sont-ils aujourd’hui perçus comme des loisirs qui ne doivent surtout pas être
3 La vitesse généralisée d’un moyen de transport se distingue de sa vitesse moyenne. Celle-ci se calcule en
divisant la distance parcourue par le temps nécessaire pour parcourir cette distance ; celle-là s’obtient en
ajoutant au dénominateur le temps consacré en travail pour payer le moyen de transport.
4 Cf. Slavoj Zizek, Le Spectre rôde toujours. Actualité du Manifeste du Parti communiste, Paris, Éd. Nautilus, 2002
(1998), p.73-76.

« pénibles », « prise de tête » ? On a payé un objet pour qu’il marche, et l’on repaiera (de plus en
plus rapidement !) pour en racheter un autre – parce qu’il casse très tôt, ou bien parce que j’en
suis las très tôt. La perspective de devoir apprendre pour me servir d’un objet technique est vécue
comme rédhibitoire… S’est établie implicitement une règle de proportion inverse : la pénibilité
du travail (synonyme d’effort, de fatigue, de déplaisir) permet d’obtenir de l’argent ; cet argent
doit pouvoir permettre, en retour, d’acheter des biens synonymes de pur repos, de pur plaisir.
Depuis plusieurs décennies, la technicisation des conditions du divertissement s’est opérée dans
une ignorance technique voulue et réclamée des consommateurs. Par exemple, le réglage d’une
platine était valorisé et participait de l’éducation de l’oreille du mélomane en même temps qu’il
supposait une certaine connaissance technique ; et cette connaissance se perfectionnait justement
par le moment dit « de détente » qui était en même temps un moment d’apprentissage et de
labeur joyeux. Or, c’est ce rituel de préparation à l’écoute qui a sonné comme le glas de l’écoute
analogique.5 Pour des raisons complexes, la technique est associée dans l’imaginaire collectif à
quelque chose de froid, de difficultueux : bref elle signifie plus spontanément déplaisir que
jouissance. Or, la culture technique est une activité, elle se pratique ; tout le problème est qu’elle est
vécue de plus en plus comme un spectacle : on contemple passivement ses résultats et ses
(in)succès, on entend dire ses prouesses – dans tous les cas on lui demeure étranger.
(c) La technique est une pratique entière : elle est activité de l’esprit et du corps – qu’elle refuse
d’opposer. En ce sens, la technique est moniste : je ne peux penser que dans la mesure où mon
corps pense aussi loin que mon esprit. Cette idée, qui peut choquer certains, est pourtant un
acquis majeur de l’ethnologie (pensons aux « techniques du corps » analysées par Marcel Mauss)
et déjà Platon faisait ce parallèle strict qu’un certain usage scolaire de la pensée tend à nous faire
oublier :
Ne jamais mouvoir l’âme sans le corps, ni le corps sans l’âme, pour que, se défendant l’une contre l’autre,
ces deux parties préservent leur équilibre et restent en santé. Il faut donc que le mathématicien, ou
quiconque applique intensément son esprit à quelque étude, donne aussi en compensation des
mouvements à son corps, en pratiquant la gymnastique, et que, inversement, celui qui accorde le plus clair
de ses soins à façonner son corps fournisse à son âme des mouvements compensatoires, en pratiquant la
musique et à tout ce qui relève de la philosophie, s’il veut être qualifié à juste titre de beau et de bon.6
(d) Contrairement à une image courante, la culture technique fait de nous des généralistes. La
compétence technique ne signifie pas spécialisation : c’est la division du travail social qui accule
les techniciens à toujours plus de spécialisation, rendant les individus dépendants les uns des
autres pour des services payants. À l’inverse, l’esprit de la culture technique renvoie à l’idée
antique d’apprentissage mutuel en vue d’une autarcie : l’objectif est de se rendre plus forts les uns
les autres (s’apprendre des techniques en partageant ses compétences), et non pas plus faibles
(monnayer ses compétences d’autant plus cher qu’autrui est ignorant : on a alors intérêt à
préserver l’ignorance technique en général). C’est au quotidien que la « politesse de la technique »
s’apprend. La puissance positive de la technique se pense donc par son apprentissage permanent
au sein d’une éducation polytechnique, bref comme une perspective de libération (que peux-tu
faire grâce à la technique ?) et non de responsabilisation.
5 Pour filer cet exemple, le retour en force du vinyle aujourd’hui invite à l’optimisme quant au désir des
citoyens de se réapproprier les conditions techniques de la joie de vivre.
6 Je rappelle que l’art, chez les Grecs, se dit « technè ». Platon, Timée, 88b-c, Paris, GF, 1999, p.213 (trad.
modifiée) ; et dans le même état d’esprit : Les Lois, VII, 807c-d. Sur l’importance de la formation sportive dans
l’éducation philosophique chez Platon comme culture technique du corps, cf. le bel article de Robert Muller,
« Gymnastique et civilisation : l’exemple des Lois de Platon », dans Denis Moreau et Pascal Taranto (dir.),
Activité physique et exercices spirituels. Essais de philosophie du sport, Paris, Vrin, 2009, p.179-195.

2 – L’ambiguïté de la responsabilisation : conseiller sans former réellement
Prendre la question par la perspective de l’éducation permet de rappeler la divergence entre
morale et éthique : la première responsabilise en disant ce qu’il faudrait faire, mais elle ne donne
pas les moyens concrets pour mieux faire ; la seconde est d’abord une réflexion sur les conditions
de modifications de notre comportement – c’est pourquoi toute bonne éthique est d’abord une
éthologie, c’est-à-dire une juste explication des raisons pour lesquelles nous nous comportons
comme nous le faisons.
Or, la technique suscite souvent, de la part des philosophes, des considérations moralisantes plus
que des analyses précises sur ce que nous pouvons faire avec elle. Jacques Bouveresse rappelle ce
triste fait : l’histoire de la philosophie n’est pas très riche en philosophes technophiles, la
technophobie l’emporte largement. Or, « si, comme le dit le lieu commun, on ne parle bien que
de ce que l’on aime, il ne faut certainement pas s’étonner que les philosophes parlent
généralement si mal de technique. J’entends par là qu’ils en parlent mal comme on parle mal de
quelqu’un que l’on n’aime pas et, également, comme on parle mal d’une chose que l’on ne
connaît pas. »7 D’où les tableaux plus ou moins alarmistes dans lesquels les « penseurs »
s’attribuent le rôle aussi creux que vaniteux de « gardiens des valeurs ». Mais la confrontation que
l’on suppose entre l’éthique et la technique n’a pas besoin de prendre la forme qu’on lui attribue
le plus souvent aujourd’hui, avec, d’un côté des techniciens irresponsables et prêts à tout et, de
l’autre, des censeurs moraux, au nombre desquels figurent généralement ce que Jean-Pierre Séris
appelle les « philosophes-prêtres », qui protestent de façon symbolique et parfaitement inefficace :
« Ce sont les demi-habiles, voire les ignorants, qui croient que les techniciens ne savant pas ce
qu’ils font. »8
Déplacer le problème, c’est d’abord ne pas construire un personnage du technicien farfelu et
exotique – le savant fou à un extrême, le travailleur misérable de l’autre. L’un des enjeux de
l’éducation polytechnique tout au long de la vie est de renvoyer dos-à-dos le mépris et
l’obscurantisme : être « technicien » renvoie à une fonction sociale et politique essentielle du
citoyen – et non à des métiers qu’un euphémisme méprisant réserve aux travaux dégradants, ni à
des fonctions ésotériques qu’une mythologie contemporaine réserve à l’inconscience des
puissants. Nous sommes tous des techniciens : nous passons nos journées à user des objets
techniques, nous appréhendons le monde à travers des objets techniques – portez-vous des
lunettes par exemple ? Le réel danger pour nous provient de ce que nous sommes acculés à la
posture complètement passive d’usager pur, incapable d’entendre le fonctionnement de l’objet
technique usité.
Les vertus de la technique (sens originel de la technique : prolongation pensée du corps humain)
ne peuvent conserver leur sens que si l’intelligence des conditions de production et d’utilisation
demeure conjointe. Cette conjonction ne peut se réaliser effectivement que dans la pratique
quotidienne, et non dans des « exceptions » qui sont des « excursions » exotiques dans « le monde
de la technique », présenté d’emblée comme étrange et étranger. Or, aujourd’hui, la perspective
d’apprendre renvoie, plus ou moins consciemment, à la pénibilité des apprentissages scolaires et
professionnels. Dès lors, la sensibilisation aux « problèmes de la technique » est souvent vécue
sous l’angle de la culpabilisation – « tu ne sais pas en user donc tu es irresponsable » –, et non
comme une puissance de libération à conquérir. On en arrive aux plus étranges comportements !
Prenons un exemple : une propagande récente fait acheter aux « citoyens responsables » des
7 Jacques Bouveresse, « Les philosophes et la technique », dans Essais IV, Marseille, Agone, 2004, p.110.
8 Jean-Pierre Séris, La Technique, Paris, PUF, 1994, p.311.

ampoules basse consommation.9 Bel exemple de marketing dont l’enjeu est de créer de manière
complètement ad hoc une demande qui doit absorber l’offre de production. Or, une connaissance
technique des matériaux utilisés et des conditions de fabrication de ces ampoules permettrait
d’éviter aux consommateurs de se lancer à corps perdu (et avec toute la bonne volonté du
monde) dans des achats parfaitement inutiles. Le professeur Aloïs Blouseblanche résume très
bien le malentendu :
Les ampoules fluorescentes consomment à l’éclairage autour de cinq fois moins d’énergie. Leur durée de
vie est en outre environ dix fois plus longue. « C’est génial ! », me direz vous. Mais encore une fois,
comme pour les automobiles, le bilan écologique officiel est conclu uniquement à partir de l’utilisation de
l’objet et non de l’ensemble de son cycle de vie, c’est-à-dire la fabrication, l’utilisation et la destruction.
C’est là que cela se complique pour notre ampoule fluorescente. D’abord sa fabrication nécessite au moins
cinq fois plus d’énergie que la précédente. De plus, la quantité d’énergie utilisée pour extraire et
transformer des minerais rares n’entre pas dans ce bilan. Autre élément : comparée à l’ampoule
fluocompacte, l’ampoule classique fait figure de produit quasiment « bio » ; elle est composée de fer, de
sable (le verre) et de vide (dans l’ampoule). Notre « miracle technologique », lui, contient du plastique, du
plomb (dans le verre), des composants électroniques, mais aussi dans le tube des poudres fluorescentes et
un gaz à base de vapeur de mercure. Ces lampes constituent ensuite un déchet dangereux (interdiction
absolue de les jeter dans votre poubelle !) qui s’ajoute aux montagnes de déchets non recyclables et
toxiques sous lesquelles croule notre belle société.10
Cet exemple est typique de notre rapport à la technique. On considère l’objet technique dans un
halo : il n’a pas de genèse (conditions de fabrication) et pas de vie à part entière (comportement
dans le temps, corruption) ; il est évalué pour ses qualités et vertus instantanées : ce qui donne
une parfaite définition de l’objet magique. Au lieu de vouloir apprendre, c’est-à-dire de se situer
dans une perspective de formation tout au long de la vie, on attend la solution technique pour
résoudre un problème sans rien avoir à changer de soi-même.11 C’est toute la différence entre
l’éducation au geste critique en tant que modification de soi (activité) et la critique purement
verbale (et mal informée) comme culpabilisation des autres (passivité). Croire qu’« économiser
l’énergie » consiste à dire du mal des centrales nucléaires et acheter des ampoules « basse
consommation », c’est être aux antipodes de ce que Simondon appelle la « délicatesse morale » :
celle-ci suppose une culture technique réelle qui vaut transformation de nos gestes quotidiens, et
non pas responsabilisation et culpabilisation accompagnées de gestes contradictoires – qui ne
font que témoigner dramatiquement du fait que nous perdurons dans notre ignorance crasse de la
réalité technique.
9 Que l’écologie arrive à la conscience des citoyens sur le mode de la propagande et nullement par les voix
de la raison, il suffira pour s’en convaincre de regarder les mécanismes à l’œuvre dans les campagnes
publicitaires et les films catastrophes sur ce thème.
10 Article paru sous le pseudonyme d’Aloïs Blouseblanche dans le journal La Décroissance, février 2010.
11 On peut dégager ici un corolaire qui définit précisément l’essence de la publicité : la publicité est ce qui
fait croire que l’acquisition d’un objet technique vaut possession immédiate des propriétés vantées de
l’objet technique – schème religieux de la conversion, par opposition à celui de la formation. Si j’achète
une voiture, je suis un mâle séduisant et respectable ; si j’achète des Kinder pour mes enfants, je suis ce
parent modèle, profondément bon et bienveillant. Le premier symptôme de l’absence de culture technique
est la religiosité participative (au sens de Lévy-Bruhl) dans la possession d’objets publicisés. Les analyses
sur la technique publicitaire sont malheureusement trop rares en philosophie, à l’exception du petit joyau de
Gilbert Simondon, « L’effet de halo en matière technique : vers une stratégie de la publicité », Cahiers de
l’I.S.E.A., (Série M, 7), p.55-69.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%