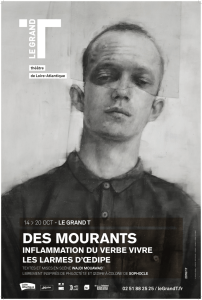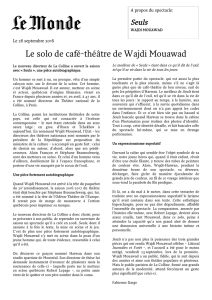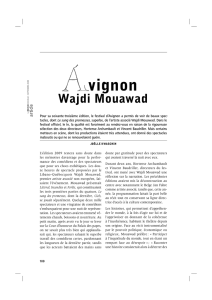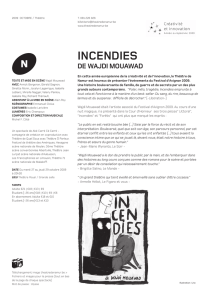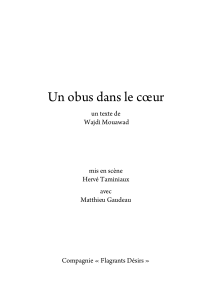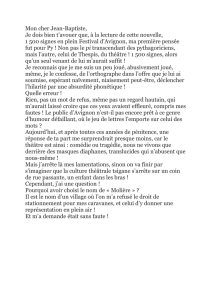Voyage - Festival d`Avignon

Wajdi Mouawad
Hortense Archambault Vincent Baudriller
Voyage
pour le Festival d’Avignon 2009
Festival d’Avignon
Wajdi Mouawad Hortense Archambault Vincent Baudriller
Voyage
Pendant deux ans, pour concevoir le Festival
d’Avignon 2009, Hortense Archambault et
Vincent Baudriller ont fait aux côtés de Wajdi
Mouawad, artiste associé de cette 63eédition,
un voyage à travers ses territoires géogra-
phiques, artistiques et imaginaires. Pour témoi-
gner de ce dialogue, ils ont rassemblé dans ce
livre des lettres qu’il leur a écrites au fil du
temps et un entretien réalisé en mars 2009,
reprenant les sujets de leurs conversations à
Avignon, Montréal et Beyrouth ; comme un
puzzle à reconstituer pour vous accompagner
dans votre traversée du Festival.
P.O.L / Festival d’Avignon
Ne peut être vendu
ISBN : 978-2-84682-336-4
714850-7
Couve_Avignon2009:Mise en page 1 8/06/09 12:01 Page 1

Voyage
pour le Festival d’Avignon 2009

Wajdi Mouawad
Hortense Archambault Vincent Baudriller
Voyage
pour le Festival d’Avignon 2009
P. O. L
Festival d’Avignon
Propos recueillis
par Antoine de Baecque
le 31 mars 2009

7
Pendant deux ans, pour concevoir ce Festival
d’Avignon, nous avons fait aux côtés de Wajdi
Mouawad, artiste associé de cette 63eédition, un
voyage à travers ses territoires géographiques, artis-
tiques et imaginaires. Pour témoigner de ce dialogue,
nous avons rassemblé dans ce livre des lettres qu’il
nous a écrites au fil du temps, et un entretien réalisé
en mars 2009, reprenant les sujets de nos conversa-
tions à Avignon, Montréal et Beyrouth; comme un
puzzle à reconstituer pour vous accompagner dans
votre traversée du Festival.
Hortense Archambault et Vincent Baudriller,
directeurs du Festival d’Avignon

9
Prologue
Il y a d’abord eu des spectacles de Wajdi Moua-
wad, puis des rencontres à leur suite, une manière
habituelle de faire connaissance entre un artiste et
un directeur de théâtre. Nous fûmes vite surpris
par la richesse et la facilité de nos échanges,
d’abord autour de la question de la narration, avec
cet artiste familier du récit, nourri par une culture
orientale qui pense le monde en le racontant, puis
par la culture nord-américaine qui s’est réappro-
prié l’écriture de l’histoire depuis le XXesiècle.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
1
/
55
100%