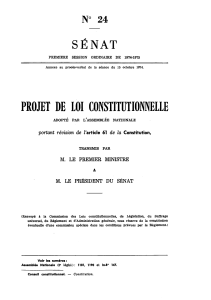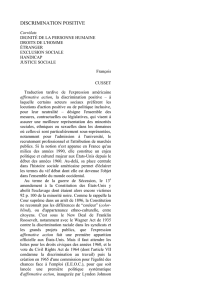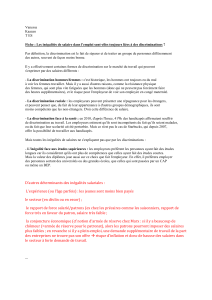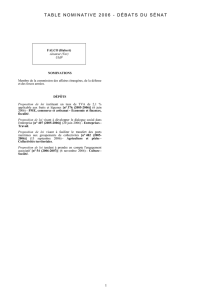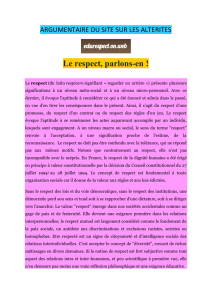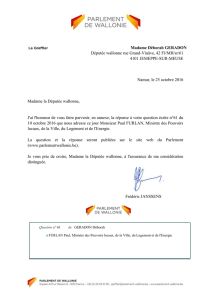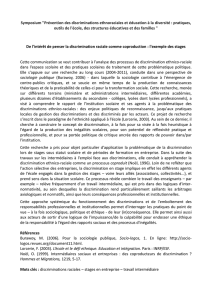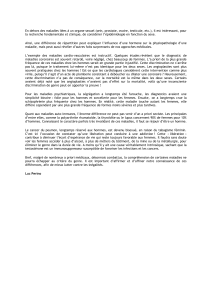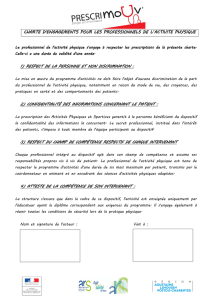Pouvoirs n. 111.qxd

REVUE FRANÇAISE D’ÉTUDES CONSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES
DISCRIMINATION
POSITIVE
N° 111

SOMMAIRE
DANIEL SABBAGH 5
La tentation de l’opacité: le juge américain
et l’affirmative action dans l’enseignement supérieur
JACQUELINE COSTA-LASCOUX 19
Les échecs de l’intégration, un accroc au contrat social
GWÉNAËLE CALVÈS 29
Les politiques françaises de discrimination positive:
trois spécificités
BRUNO PERREAU 41
L’invention républicaine.
Éléments d’une herméneutique minoritaire
ANNE LEVADE 55
Discrimination positive et principe d’égalité en droit français
ÉLÉONORE LÉPINARD ET LAURE BERENI 73
La parité ou le mythe d’une exception française
BERNARD TOULEMONDE 87
La discrimination positive dans l’éducation:
des ZEP à Sciences po
THOMAS KIRSZBAUM 101
La discrimination positive territoriale:
de l’égalité des chances à la mixité urbaine
FRANÇOIS STASSE 119
Pour les discriminations positives

SOMMAIRE
ALAIN-GÉRARD SLAMA 133
Contre la discrimination positive.
La liberté insupportable
CHRONIQUES
ABEL HERMEL 147
Étude d’un parti politique français: l’UMP
ROBERT HANICOTTE 159
Priorité au Sénat
REPÈRES ÉTRANGERS
(1er avril – 30 juin 2004)
PIERRE ASTIÉ, DOMINIQUE BREILLAT
ET CÉLINE HISCOCK-LAGEOT 177
CHRONIQUE CONSTITUTIONNELLE FRANÇAISE
(1er mai – 30 juin 2004)
PIERRE AVRIL ET JEAN GICQUEL 193
Summaries 219

LA DISCRIMINATION POSITIVE EST ÉTUDIÉE PAR
LAURE BERENI, doctorante en sociologie au Laboratoire de sciences sociales de l’École nor-
male supérieure et à l’Université René-Descartes-Paris V. Ses recherches portent sur le mou-
vement des femmes et la représentation politique en France depuis les années 1970.
GWÉNAËLE CALVÈS, professeur de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise. Elle anime,
avec Daniel Sabbagh, au CERI (Centre d’études et de recherches internationales), le groupe
de recherche «Politiques anti-discriminatoires». Elle a publié La Discrimination positive
(PUF, « Que sais-je?», 2004).
JACQUELINE COSTA-LASCOUX, directrice de recherche au CNRS, CEVIPOF à Sciences po.
Elle dirige l’Observatoire statistique de l’immigration et de l’intégration, a participé à la
Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité, et à la Commission du débat
national sur l’avenir de l’école. Elle a publié Les Trois Âges de la laïcité (Hachette, 1996), Les
Hommes de Renault-Billancourt. Mémoire ouvrière de l’Île Seguin. 1930-1992 (Autrement,
2004).
THOMAS KIRSZBAUM, sociologue, chercheur associé au CARAS (Université d’Évry-Val
d’Essonne). Ses travaux portent notamment sur la discrimination positive territoriale, étudiée
dans le cadre d’une comparaison du développement communautaire américain et de la poli-
tique de la ville française.
ÉLÉONORE LÉPINARD,doctorante en sociologie au Centre d’études des mouvements sociaux
(EHESS Paris), chercheuse invitée à l’Institute for Research on Women, à l’Université de
Rutgers aux États-Unis. Elle achève sa thèse, «L’égalité incertaine. Stratégies de légitimation
et mise en œuvre de la parité en France».
ANNE LEVADE, professeur de droit public à l’Université Paris XII. Elle dirige le Centre de
recherches communautaires (CERCO-CDE). Elle a publié notamment «L’objectif de valeur
constitutionnelle, 20 ans après. Réflexion sur une catégorie juridique introuvable», Mélanges
Pactet, Dalloz, 2003; «Quel avenir pour l’Europe? Réflexions croisées sur l’avant-projet et
le projet de Constitution européenne», RAE, 2001-2002, n° 7. Elle prépare actuellement, en
codirection, un commentaire, article par article, du projet de Constitution européenne.
BRUNO PERREAU, maître de conférences à Sciences po et chargé de cours à l’Université Paris
XII. Il a publié «Faut-il brûler Legendre? La fable du péril symbolique et de la police fami-
liale», Vacarme, n°23, automne 2003, «Le personnel (est) politique. Professions et pouvoirs
politiques à travers une sélection de travaux contemporains», Comprendre, n° 3, octobre
2002, L’Homosexualité (Librio, 2005).
DANIEL SABBAGH, chargé de recherches au CERI-Sciences po, auteur de L’Égalité par le
droit. Les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis (Economica, «Études poli-
tiques», 2003, prix François-Furet 2004).
ALAIN-GÉRARD SLAMA, professeur d’histoire à Sciences po Paris. Il a publié notamment Les
Chasseurs d’absolu. Genèse de la gauche et de la droite (Grasset 1980, rééd. «Pluriel»), L’An-
gélisme exterminateur. Essai sur l’ordre moral contemporain (Grasset 1993, rééd. «Pluriel»),
La Régression démocratique (Fayard 1995, rééd. Perrin, 2002), La Guerre d’Algérie. Histoire
d’une déchirure (Gallimard, 1996), Chronique des peurs ordinaires, journal de l’année 2002
(Seuil, 2003).
FRANÇOIS STASSE, docteur en économie, conseiller d’État. Il a publié notamment La Véri-
table histoire de la Grande Bibliothèque (Seuil, 2002) et L’Héritage de Mendès France (Seuil,
2004).
BERNARD TOULEMONDE, agrégé des facultés de droit, ancien directeur des Affaires générales
et de l’Enseignement scolaire, ancien recteur des académies de Montpellier et de Toulouse,
inspecteur général de l’Éducation nationale. Dernière publication: Le Système éducatif en
France (La Documentation française, 2003).

DANIEL SABBAGH
LA TENTATION DE L’OPACITÉ :
LE JUGE AMÉRICAIN
ET L’AFFIRMATIVE ACTION
DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
AUX ÉTATS-UNIS, LA «DISCRIMINATION POSITIVE » (affirmative
action) désigne l’ensemble des mesures qui octroient aux
membres de groupes ayant été soumis dans le passé à un régime juri-
dique discriminatoire un traitement préférentiel dans la répartition
de certaines ressources. Les groupes en question sont les Noirs, les
«Hispaniques», les descendants des populations autochtones (Native
Americans), les femmes, et parfois les Asiatiques. Les trois domaines
d’application du dispositif sont l’emploi, l’attribution de marchés
publics et l’admission dans les universités. Dans tous les cas, l’objectif
est de remédier à la sous-représentation statistique des membres de ces
groupes dans la population de référence. Plus précisément, l’expres-
sion «traitement préférentiel », employée ici sans aucune intention
polémique, se rapporte à une situation dans laquelle (si l’on s’en tient
au cas de figure simplifié de l’opposition binaire entre deux groupes
raciaux1préalablement délimités) un candidat noir N1 se trouve
TC À CHANGER
5
POUVOIRS – 111. 2004
1. Aujourd’hui, de manière générale, l’usage du mot «race» dans le discours public aux
États-Unis n’implique pas que le locuteur croie en l’existence des races en tant que catégories
anthropologiques. Le terme s’analyse plutôt comme une périphrase implicite désignant les
groupes antérieurement soumis à la discrimination la plus systématique sur le fondement d’une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
1
/
224
100%