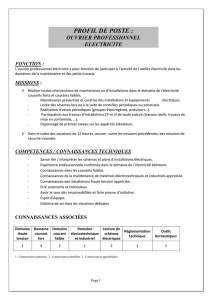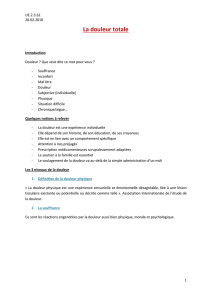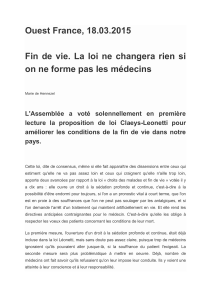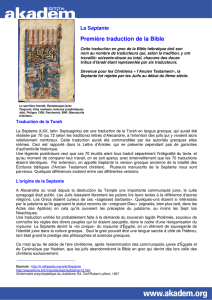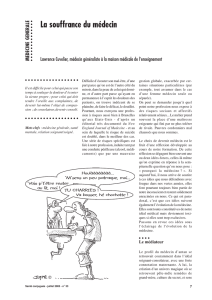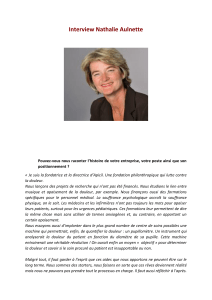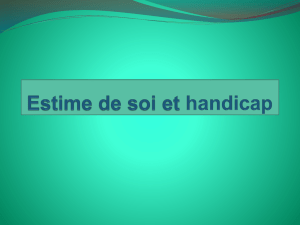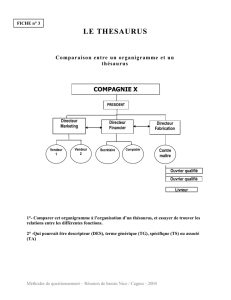Exposé de Monsieur Alain Max Guénette, professeur à la

ExposédeMonsieurAlainMaxGuénette,professeuràlaHauteécoledegestionArc,Delémontet
Neuchâtel,le22nov.2014lorsduForumœcuméniqueromandàLausanne.
Titredelajournéed’échangeetdedébat2014:«Travaillerensemble».
Cetexte,quireprenddesboutsd’élémentsécritsparl’auteur,estrédigéexclusivementàl’endroit
despersonnesprésentesàlaréuniondeLausannedu22novembre.Ilnedevraitenaucuncasêtre
diffuséplusloin.
L’auteurrestedisponiblepourcontinuerledialogueentreprisle22nov.dernierourépondreàdes
questionsspécifiques.
1. Introduction
L’idéecentraledéfendueiciestcelled’unbasculementdanslesannées1980oùl’entreprisevue
commeunespacecollectifd’innovationa(re)faitplaceàuneconceptiondel’entreprisevuecomme
unespacederelationsmarchandes–oùsevendets’achètedutravailnotamment.Unretourau
19èmesiècleenquelquesorte,avantlarévolutiontaylorienne!Avecletraitementindividualisédes
salarié∙e∙sdanslesannées1980,lapsychologisationprendslepassurlesconsidérations
organisationnellesetletravail,pourtantcollectifparessence,estvidédecettedimensionetréduità
êtreenvisagéentermesdequantitéplutôtquedequalitéempêchantprécisémentle«travailler
ensemble».
2. Dequelquestendanceslourdes
2.1. Évolutiondesorganisations
Ilestutiledecomprendrelanaturedubasculementquis’estproduitdanslesannéesseptanteet
quatre‐vingt,soitàlafindelapériodedecroissanceextraordinaireditesdes«Trenteglorieuses».
Lesannéesseptantesontmarquéesparunecontestationdumodèlefordien‐taylorien,desouvriers
entreautresemployésaspirantàêtreconsidéréscommeautrechosequedesimplesrouages.Le
courantdel'améliorationdesconditionsdetravails’impose.Entémoignentlesgrèvesd'ouvriersde
partetd’autredel’Atlantique(Renault,GeneralMotorsnotamment).Lesréactionsdiffèrent
cependantavec,d’uncôté(auxÉtats‐Unis)lesreprésentantsd’entreprisespréférantprendreàleur
compte,ensel'appropriant,leproblèmedelasantéautravail,afind’éviterunerevendication
syndicale.D’unautrecôté(enFrance),leproblèmeétantprisenmainparl'Étatautraversd’une
institutionnalisationcentralisée.
Lesannéesquatre‐vingtetnonantesontcellesdel’oublidelaquestiondelasanté.Placeestlaissée
auxdébatsautourdenouveauxmodesdegestion,notammentlagestioninstrumentaliséedes
compétencespourparticiperàl’anticipationenmatièred’emploietpourgérerl’implicationdes
salariésdansdesentreprisesmoinsintégréesqu’auparavantetoùlemodedecontrôleparla
disciplinemontreseslimites.Onchercheàdépasserladivisiontropfortedutravailquimontrerait
seslimitesentermesd'efficacité,àpromouvoirlaflexibilité.Onpréfèreaborderlaquestiondelafin
dutravailplutôtquecelledesconditionsdetravail.
Ladécenniedesannéesdeuxmillevoitréapparaîtrelaproblématiquedelasanté,affrontantune
contradiction:comment,eneffet,alorsquel’onaassistéàunmouvementdeprogrèstechnique,à
traversnotammentl’automatisationetl’information,peut‐oncomprendrequelasantédes
personnesautravailsesoientaggravée?Commentlasociétémodernea‐t‐ellepuengendrertantde
maladiesetdepathologiesnouvelles?Pourquoietcomment,ensomme,latertiarisationde

l’économiepéjore‐t‐ellelasantéautravail?(Diversesmanifestations,telqueleCongrèssuissede
santédanslemondedutravail,événementbiannuel,ontainsivulejour.)
Pourrépondreauxquestionsposéesdansleparagrapheprécédent,mettonsenparallèlel'évolution
desstratégieséconomiquesaveclesmodèlesd'organisationquilesaccompagnentdepuislafindela
secondeguerremondiale,puisévaluonscequiachangédansletravaildel'employé,del’ouvrieren
l’occurrence,danssonrapportautravail.
2.2. Delastratégieéconomiqueetdurôleouvrier
Lapriseencomptedecequel’ondemandeauxpersonnesdepuislesannéesseptanteestillustréeici
àtraversletravailouvrier.
Lemodèletaylorienrépondaitàunelogiqueéconomiquedeproductionoùlademanderenvoyaità
desbiensde1eréquipement.Ilfallaiteneffetreconstruireausortirdesguerresmondiales.Letravail
del’ouvrierétaitceluid’un«expert»dansundomainespécialisé.Danslesannéesseptante,la
demandeestdevenueunedemandederenouvellement.Nousentronsdanscequel’onappelle
aujourd’huiune«économiedelavariété»danslaquelleleclientdictesapréférence.L’ouvriern’est
alorsplusseulementunexpertmaisdoitfairefaceàlapolyvalenceaurisquedelamaîtrisedeson
«expertisemétier».Illustronscettenouvelleformedeprofessionnalismeennousappuyantsurle
cahierdeschargesd'un«soudeur»:
Soudeurdansle
modèle
taylorien‐
fordien
…passage…Soudeuraujourd’hui
Savoirsouder
Détaildes
opérationsde
soudure
Conséquence:gain
enexpertise
annéeaprès
année
Possible
ou
pas
possible
?
Savoirsouder
Autocontrôle(vendeurdesontravail)
Ranger/Nettoyer(norme5S)
Maintenancede1erniveau(normeTPM)
Réuniond'équipeautonome
Écritdansuncahierlesproblèmesrencontrés
(cognition)
Êtreprésàêtredérangépouraideruncollèguede
l'équipeautonome
Conséquence:augmentationdelaflexibilitéaudétrimentde
l'expertise.
L’arrivéed’unedemandeditedeconsommationsuitcettedernièretendance.Pours’adapteràla
mondialisation,lesentreprisesdoiventsanscesseinnoverpourêtrecompétitivesetrenouvellent
régulièrementunbienafindedynamiserlemarché.L’ouvriercessed’êtreexpertdesondomaineet
seretrouveencontinuelleadaptation.Ilnesevoitplusseulementqualifiérelativementàlamaîtrise
desatâche(cadence,norme),d'autresfacteursfaisantleurapparition:activitéscognitives,
flexibilité.Certesletravailestmoinsdangereuxetmoinspéniblequ’auparavant,mais,enmême
temps,lamaintenance,lescontrôles,lesréparations,lesréponsesauxincidents,obligentàdes
effortsetdesposturesdifficiles,nonprévusparlaconception.
Ceprofessionnalismed’ungenrenouveaurequiertdescompétencesnouvelles,letravail
s’intensifiant,voiresedensifiant.Laflexibilisationdevientdeplusenplusuneobligationimposéepar
lesmodesd'organisation.
2.3. L'hyper‐compétitivité
Lechangementorganisationneletstratégiquedesorganisationsaconduitàlacréationdenouvelles
formesdemanagementetd’organisation.Lemondeactueldelaconcurrences'esttellement

complexifiéque,pourêtrecompétitif,ilfautnonseulementdominerentermesdecoûts,maisaussi
dequalité,d'innovationetdedélais.C’estcephénomènequel’onappellehyper‐compétitivitéetqui
touchetouslesdomaineséconomiques,touteslesorganisationsjusqu’àcellesdusecteurpublic.
Pourfairefaceàcettedonneéconomique,lesfonctionsdirigeantesspécialisées(DRH,Finance,etc.),
ontélaborédesoutilspropresàleursdomainesdecompétences.Lacréationdetelsoutils(juste‐à‐
temps,démarchesqualité,équipesautonomes,etc.)engendredesdifficultésdanslamesuresoùils
ontétéélaboréspardesexpertspourdesexpertsetqu'ilspeuventparfoisengendrerdes
contradictionssicen’estdesparadoxes(enrequérant,parexemple,polyvalenceetexpertiseàla
fois).Enconséquence,lesmanagersseretrouventfaceàdesoutilshypercomplexesetn'arriventplus
àvoirlacohérencedel'ensemble.Le«middlemanager»seretrouveconfrontéàappliquerdes
normesdansleseulbutderemplirlesobjectifssurlesquelsilserajugé.Sontravailgagnedoncen
complexitéetenintensité–les3C(contraintes,contradictionetconflitlogique)–,cequipeutnuireà
sasantéetdefaitleconduireàtransmettrelatensionqu’ilressentàsonéquipe.Lesresponsables
RH,quidevraientàcetégardaiderlesdirectionsàrégulerlestensionsetlescontradictions,sont
souventdépassésetsereplientparfoissurunehypothétiqueposturestratégique.
Lespériodesdefortchangementorganisationnel(hyper‐performance)provoquentdèslorsune
augmentationdesmaladiesliéesautravail,parexemplelestroublesmusculo‐squelettiques(TMS)et
autrespathologiesémergentes.Cesdeuxfacteurs,couplésàl'augmentationprogramméedela
duréedelavieprofessionnelleetauvieillissementdelapopulationactive,menacentàmoyenou
longtermelesorganisations.
2.4. Évolutiondelasubjectivité
Lesdiagnosticsportantsurl’individualismecontemporainnemanquentpas.AvecHuguesPoltier,
philosopheàl’UniversitédeLausanne,dansunouvragecollectifquenousdirigions,intitulé«Travail
etfragilisation.Lemanagementetl’organisationenquestion»paruen2004,nousnousbasionssur
l’idéedéfenduavantnouspard’autres,queleprocessusdedémocratisationvadepairavecun
doubleprocessusd’individualisationetdefragilisation.Àl’individuhypermoderneou
hypercontemporainselonlesdénominations,toutestdonnéd’emblée,commejamaisauparavant
dansl’Histoiresansdoute,maiscetindividudoitpourtanttoutreconstruire.Cettesituationne
favorisepaslatranquillitéd’espritetrisqueplutôtd’entraînerLafatigued’êtresoi,pourreprendrele
titredel’ouvragedenotrecollègueAlainEhrenberg.
Prisdanslanormedelaresponsabilitédesoi,aveccommeimpératifdes’assumermatériellement
parunerémunérationacquiseparletravail,l’individusedéfinitàpartirdel’activitéautraversde
laquelleils’inscritdansunmilieusocioprofessionneldéterminéet,dumêmecoup,conquiertune
identitéàmêmedeluiprocurerlareconnaissancedesautres.Lesindividushyper‐contemporains,ou
hypermodernes,sedéfinissentcommedes«travailleurs»enceciquel’emploiestl’accèsà
l’émancipationmatérielle(jesuissouverainsurl’emploidemonrevenu),àl’identitésocialeetenfin
àlasécurité(rentevieillesse,protectioncontrelespériodesdechômage,etc.).Àl’individucomme
figurenormative,répondainsicelledutravailcommemoded’insertionobligé.Étantdonnéecette
centralitédel’emploicommevecteurd’indépendanceetd’émancipationfinancièreetstatutaire
dansnossociétéditedel’«éthiquedutravail»,l’individuseremetsansdouteàunedépendance
nouvelle,grossedemenaces,écrivions‐nousHuguesPoltieretmoi.
Danscettemêmeligned’analyse,unautreauteur,notreamileDr.Jean‐PierrePapart,estimequ’une
exigenced’initiativeetdemaîtriseprofessionnellequiestlamarquedenotresituationd’individus
hyper‐contemporains(denotrehypermodernité),estvenuesesurajouteràl’exigencedediscipline
etlaculpabilité,notionsquirenvoyaientellesàlamodernité.Danssonouvrageintitulé«Santé
mentale.Plaidoyerpourlasécuritéhumaineetlesdroitsdel’homme,ilécrit:«Cetteexigence
renforceauniveaudumilieudutravaill’exigenceculturelledeneconstruiresonidentitéqu’àpartir
dechoixexclusivementréflexifs,avecunenvahissementdessubjectivitéspardesquestions
obsédantesdugenre:‘Est‐cequemafonctioncorrespondbienàmescompétences?’,‘Suis‐jebien

traitéavectoutlerespectquejemérite?’,etc.Questionsquiprennenttropsouventlatêteetqui
finissentparrendrelavieparticulièrementfatigantepourconfinersouventàl’impuissance.Quand
l’idéologiedelaréalisationdesoi‐mêmecondamnelesujetàuntravailpermanentsurlui‐même,
quandl’identitéassignéeaudépartnecorrespondplusàl’identitéqu’ilconvientd’acquérir,lebesoin
dereconnaissanceestinfini.»
Letableausuivantesttirédel’ouvragementionnédeJ.‐P.Papart.
3. Critiquesdesorganisationsdutravail
3.1. Malaiseautravail…
Sociologues,médecinsdutravailetpsychologuesdutravailn’ontpasmanquédemettreenreliefles
atteintesàlasantéproduitesparlesorganisationsdutravailmodernes.Pourcertains,ilya
souffranceautravailparceque,alorsquel’ondemandedelacréativitédansdesorganisations
devenuesflexibles,lesoutilsdemanagementetnotammentlagestiondescompétencesbrident
précisémentlepotentielcréatifdespersonnesengagées.PourlesociologuePhilippeZarifianpar
exemple,noussommespassésd’unesociétédisciplinaireàunesociétédecontrôle,lamodulationde
l’engagementluiparaissantêtreaucœurdecebasculement.D’uncôtélafacenégative,les
personnessomméesdes’auto‐mobiliserdansunmondeéconomiquedevenuinstable,sontsoumises
àn’êtrequ’unmorceaudecapital,forcédesevaloriserparlui‐même:unmondeoùletravailentant
queteltendàdisparaître!Del’autrelafacepositive,oùl’onprendraitlamesuredecequesignifie
leditbasculemententermesdecoordinationdansunesociétédel’engagementcréatif.
Pourd’autres,telqueleDr.PhilippeDavezies,médecindutravail,l’impactdel’accroissementdes
exigencesderentabilitéimposéesparlesattentesderendementdesactionnairessurl’organisation
dutravailetsurlaqualitédevieautravaildestravailleurs.Lesinjonctionscontradictoiresquipèsent
sureux,parmilesquellesl’injonctionàfaireduchiffre,contraindraitlestravailleursànégligerla
Subjectivité
Dimensions
santé / travail
Trad it io nnelle
Dite « moderne » Hypercontemporaine
Idéologie
co mp or t em e nt a l e
Fatalité Discipline Initiative
Maîtrise
Agent socio-
économique
Le « paroissien » L’Individu-sujet Le Soi réflexif
Affect dominant
Foi Sens du devoir Affirmation narcissique
Evitement affectif
Souffrance psychique
Peur
Anxiété
Fatigue
Sentiment causal de la
souffrance
Danger
Honte Culpabilité Impuissance
« J’ai la haine »
Intention sociale
Normes incorporées
Obéissance
Honneur
Normes intériorisées
Emancipation Normes égoïques
Maîtrise désymbolisée
« Empowerment »
Objet pathologique
Autonomie Identification Identité
Mode défensif
Vagabondage Alcoolisme
Violence familiale Dépendances
BPD
Mode idéologique de
réaction La grâce « Faut assumer » Résilience

qualitédeleurtravail,mettantenpérillesensdeleurengagement,et,par‐delà,leuridentité
professionnelleetleurestimedesoi.«Danslescabinetsmédicaux,observelemédecin,lessalariés
seplaignentmoinsdel’intensificationquedeladégradationdelaqualitéetdusensdeleurtravail».
Lesmécanismesdedéfensequemobilisentlestravailleurspoursupporterdeschosesdifficilesdans
letravailvisentleplussouventàmettrelapersonne«àl’abridel’impactémotionneldeson
activité»,cequilaconduitàdévelopperdesattitudesdefroideur,derigidité,d’indifférencevoirede
dénigrementàl’égarddesescollègues.
D’autresencoreapportentdesexplicationssurlacrisedutravailetdelamontéedesouffrance.La
lecturedel’ouvragedePierreFarron«Dis,pourquoitutravailles»paruen2012apporteàcetégard
moultéclairages.
J’aimeraispourmapartmettrel’accentsurtroispoints:
1. Latendanceàmettrelafautesurlesindividusaulieud’interrogerl’organisationdutravail.
Ona,àtraversleseuloutilvéritablementnouveaudepuisplusdeseptanteans,celuide
gestiondescompétences,affirméunmodegestionindividualisantoùl’onmetlafautesurles
individusd’éventuelsmanquesdeperformance,avantmêmedechercheràsavoirsi
l’(in)organisationdutravailn’estpasresponsableduditmanquedeperformance.Autrement
dit,onmetlafautefacilementsurlesindividusd’emblée.Signedecettetendanceà
l’individualisationetàlapsychologisation,lephénomèneducoaching.
[Pédagogiquementparlant,c’estd’ailleurslaraisonpourlaquelle,dansnosenseignements
enmatièredeRH(Ressourceshumaines),mescollèguesdelaHegArcetmoiinsistonssur
l’importancequidoitêtremisesurl’organisationdutravailavanttoutechose.
L’individualisationdutraitementdessalariésdepuislesannéesquatre‐vingtn’aquetrop
permiseneffetquelesformesdepsychologisation,voireaujourd’hui,demédicalisation,
primentdanslemondedesorganisations.]
2. Lanécessitédeco‐construirelaprescriptiondutravaileuégardàl’irruptionduclient,oude
l’usager,dansleprocessusdeproductiondebiensoudeservices.
Lepassaged’uneéconomiedelavariété(«deuxièmeéquipement»commeditplusavant)et
lesorganisationsdetypeproduit‐processquisontcourantesdésormais,ontmisaupremier
planl’importanceduclient,del’usager.Ilestnécessairedecomposeravecleclientou
l’usager,desortequesil’onenestempêché,ilyadesrisquesdesouffrance.
Cequ’aessentiellementapportéaudébutduvingtièmesièclel’ingénieuraméricainFrederik
Taylor,c’estunevisionintégrédel’entrepriseavecl’importanceaccordéeàcequel’on
appellele«bureaudesméthodes».L’«expert»dutravailyassurelaprescription
permettantl’exécutiondutravail–biensûr,l’onsaitqu’ilytoujoursunécartentrecequiest
prescrit,latâchepensée,etcequiestréalisée,l’activitéréelledetravail.
Cequiachangé,c’estqu’aujourd’huilestravailleurssontfaceauclient,ouàl’usagerdansle
casdesservicespublics,etqu’ilsdoiventco‐construirelaprescriptiondevenueplusricheque
naguère.Quandcelaneleurestpaspermis,qu’ilneleurestpaspermisdeco‐construirela
prescription,alorsilyaempêchementd’agiret,finalement,souffrance.
[Celam’estapparucriantlorsd’uneinterventionentoutefindusiècledernierdansune
institutiondumondesocio‐sanitaire,alorsquejedevaisrépondreàunreprésentantsyndical
quimedemandaitpourquoidanslesmilieuxindustrielsouventlaviolenceautravailétait
plusforteetl’onsouffraitsansdoutemoins.Maréflexionm’aconduitàprendreencompte
cetteidéequelorsquel’ondevaitprendreencompteleclient,oul’usager,ilfallaitpouvoir
co‐construirelaprescription,cequenepermetpassouventlesorganisationsdutravail
demandantlacoopérationmaisenmêmetempslarendantplusdifficile.]
3. L’absenced’unDroitdel’entreprise.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%