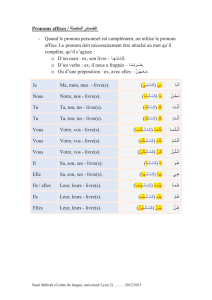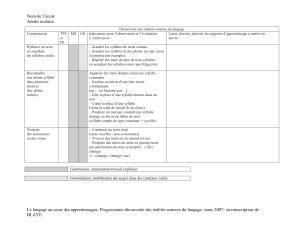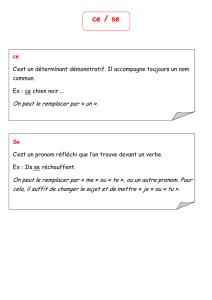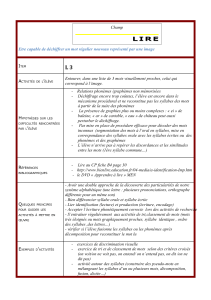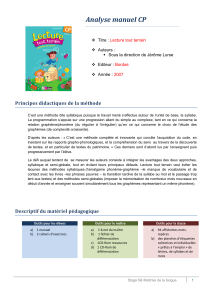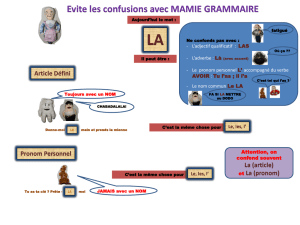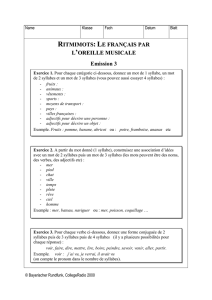LIRE au CP et au CE1


CP
Connaître le nom des lettres et l’ordre alphabétique
Distinguer entre la lettre et le son qu’elle transcrit ; connaître les
correspondances entre les lettres et les sons dans les graphies simples et
complexes
Savoir qu’une syllabe est composée d’une ou plusieurs graphies, qu’un mot est
composé d’une ou plusieurs syllabes ; être capable de repérer ces éléments
(graphies, syllabes) dans un mot
Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules d’imprimerie,
minuscules et majuscules cursives
Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique de la lecture d’un texte ; le texte,
la phrase, le mot ; le début, la fin, le personnage, l’histoire
2

CP
Lire aisément les mots étudiés
Déchiffrer des mots réguliers inconnus
Lire aisément les mots les plus
fréquemment rencontrés (dits mots-
outils)
Lire à haute voix un texte court dont les
mots ont été étudiés, en articulant
correctement et en respectant la
ponctuation
Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ;
trouver dans le texte ou son illustration
la réponse à des questions concernant le
texte lu ; reformuler son sens
Écouter lire des œuvres intégrales,
notamment de littérature de jeunesse
Lire silencieusement un texte en déchiffrant
les mots inconnus et manifester sa
compréhension dans un résumé, une
reformulation, des réponses à des questions
Lire silencieusement un énoncé, une
consigne, et comprendre ce qui est attendu
Participer à une lecture dialoguée :
articulation correcte, fluidité, respect de la
ponctuation, intonation appropriée
Écouter et lire des œuvres intégrales courtes
ou de larges extraits d’œuvres plus longues
Identifier les personnages, les événements
et les circonstances temporelles et spatiales
d’un récit qu’on a lu
Comparer un texte nouvellement entendu
ou lu avec un ou des textes connus (thèmes,
personnages, événements, fins)
Lire ou écouter lire des œuvres intégrales,
notamment de littérature de jeunesse et
rendre compte de sa lecture
CE1
3

4

Rappelons brièvement que :
•l’approche synthétique, exclusive dans les méthodes dites « syllabiques », procède des
parties vers le tout : on combine les valeurs sonores des lettres pour former des syllabes
que l’on fusionne ensuite pour produire des mots ;
•l’approche analytique, { l’œuvre notamment dans les méthodes dites « globales »,
procède { l’inverse : du tout aux parties, c’est-à-dire des mots aux syllabes puis aux lettres
et à leur(s) correspondance(s) avec les sons.
SYNTHESE
(dominante dans les
approches syllabiques)
MOT
SYLLABES
GRAPHEMES/PHONEMES
ANALYSE
(dominante dans les
approches globales)
Tiré de « APPRENDRE A LIRE A L’ECOLE, Goigoux, Cèbe, Retz, 2007 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%
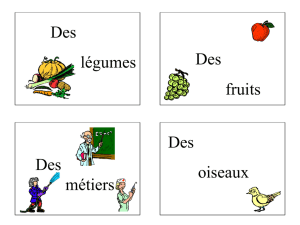
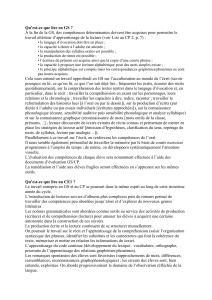
![révisions [k] [s] [z] – Exercices CM1](http://s1.studylibfr.com/store/data/007647580_1-d0ac28f4c67655ab45f51e9cf8de5896-300x300.png)