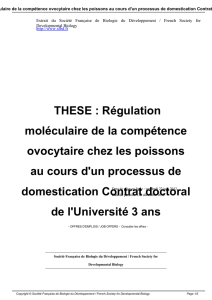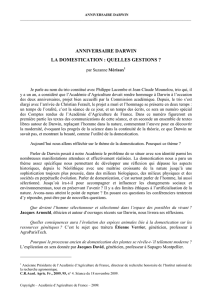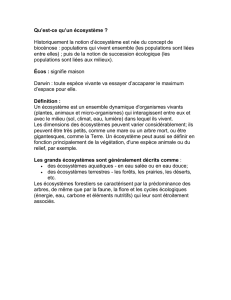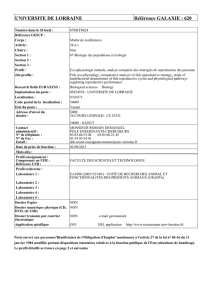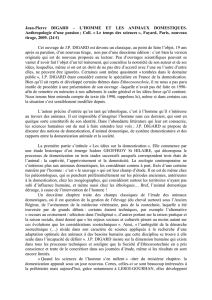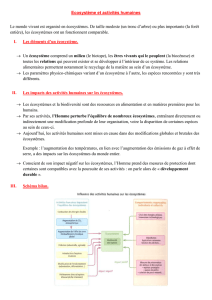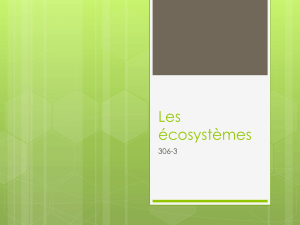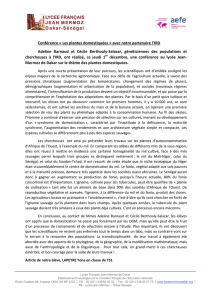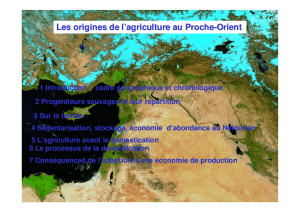Article (Published version) - Archive ouverte UNIGE

Article
Reference
De la nature aux images de la nature
RAFFESTIN, Claude
Abstract
Les sociétés ne connaissent la nature qu'à travers l'idée qu'elles se font de son utilisation. Il
n'y a pas de connaissance pure de la nature mais une connaissance définie par ce qu'on
cherche à en tirer. Il n'y a donc pas de description de la nature mais une construction
d'images de la nature en fonction d'une culture. L'arraisonnement de la nature comme disait
Heidegger a pour objectif une utilisation. Les sociétés déclenchent deux processus pour
utiliser, et donc connaître de leur point de vue, la nature : à savoir la domestication et la
simulation. Le processus de domestication part d'une échelle 1/1 pour découper des images
de la nature à l'échelle 1/n (n étant plus grand que 1). Il en résulte des hypertrophies ou des
atrophies. En somme, par la domestication, les sociétés caricaturent la nature donnée et
produisent une nouvelle nature, un modèle en quelque sorte adapté à leurs besoins. Par la
simulation, à l'inverse, elles partent d'éléments pour créer des images 1/n qui sont
développées jusqu'à l'échelle 1/1. Alors que jusqu'au XVIIIe siècle, la domestication a été le
processus le [...]
RAFFESTIN, Claude. De la nature aux images de la nature. Espaces et Sociétés, 1996, no.
82-83, p. 37-52
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:4384
Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.
1 / 1

De la nature aux images de la nature
Claude Raffestin
Université de Genève, Département de géographie
Illusion et réalité de la nature...
E sortirons-nous donc jamais de ce drame, noué dès qu'il y a eu
des hommes, et qu'il faut bien nommer l'illusion naturaliste,
celle-là même qui consiste à rechercher, évidence trompeuse, ce
que l'homme aurait trouvé en partage dès l'origine, dès les
commencements... ? Mais quelles origines et quels commencements ? Un
moment et un lieu où l'homme n'aurait aucune part comme dans ces
innombrables cosmogonies et cosmologies, dont les débris jonchent
l'histoire, autrement dit laissent des traces dans nos langages. Notre
manière de parler du soleil qui « se lève et se couche » appartient
davantage à la cosmologie de Ptolémée qu'à celle inaugurée par
Copernic...
N
Nos langues sont pleines de ces constructions qui ne sont rien d'autre
que des images produites par l'homme pour calmer ses angoisses devant
les mystères. L'homme « produit » l'idée de nature — qu'il s'agisse de
la physis des Grecs ou de la natura des Latins — pour affirmer sa
présence et son rôle. Paradoxalement, on peut prétendre que « l'homme
sera "naturisé" le jour où il assumera pleinement l'artifice en renonçant
à l'idée de nature elle-même, qui peut être considérée comme une des
principales "ombres de Dieu", sinon comme le principe de toutes les
idées contribuant à "diviniser" l'existence (et à la déprécier ainsi en tant

3 8 ----------------------------------------------------------------Espaces et sociétés
que telle)»1. Pour Rosset, ce jour n'a guère de chance d'advenir car
l'illusion naturaliste est « apte à se recomposer un visage nouveau chaque
fois qu'il advient à l'un des masques de tomber en désuétude »2. Si l'idée
est sans cesse renaissante c'est bien qu'elle représente ce point fixe
originel, cette matrice dont l'homme a besoin pour produire des mythes
qui lui rendent supportables la fragilité des choses qu'il crée et
l'apparente malédiction qui caractérise le déroulement destructeur de son
processus vital. Si l'idée de nature est indispensable à l'homme c'est
moins pour s'en distancer que pour fonder la légitimation de son action
sur quelque chose, en l'occurrence la nature, quand bien même le terme
recouvre des éléments d'une variété considérable. L'histoire de l'idée de
nature est, en somme, l'histoire des peurs et des incertitudes des
différentes sociétés. A cet égard, Moscovici, il y a un quart de siècle, avait
très justement vu le problème et il lui aurait suffi de mettre le titre de son
ouvrage au pluriel pour lui conférer tout le poids des différences utiles3 .
Il n'y a pas une mais des « histoires » humaines de la nature, de la même
manière qu'il n'y a pas une mais des classifications des objets naturels
qui sont des expressions culturelles des rapports humains à l'extériorité.
Ces histoires tournent autour d'un axe que Georges Perec aurait appelé
PENSER/CLASSER. Les choix opérés, qui s'incrustent dans la langue qui
joue alors le rôle de mémoire, dénotent des échelles spatiales et
temporelles qui ne sont pas immédiatement observables mais qui sont
repérables à l'analyse et qui connotent des orientations culturelles à
travers la structuration des ensembles de phénomènes. Ces derniers, dans
la logique de nos connaissances actuelles, peuvent être assimilés à ce que
nous appelons aujourd'hui des écosystèmes qui, à la surface de la Terre,
sont tous reliés par des rapports d'échelle spatio-temporels. Les notions
d'intersection et d'inclusion, de relation et d'interaction, de flux et de
réseau, sont probablement les plus utiles pour approcher les questions
d'écosystèmes et d'échelles. Cela dit les écosystèmes ne sont, en fait, que
des images d'une réalité imparfaitement connue mais que chaque culture
formalise pour son propre compte et considère comme la NATURE.
De ces écosystèmes nous ne possédons qu'une connaissance
imparfaite et très partielle quand bien même nous connaissons, ou
croyons en connaître, les mécanismes généraux. Les images que nous en
avons ne sont que la résultante de l'usage que nous en faisons. Cela
revient à dire que nos images sont très lacunaires et que la précision de
nos constructions ne progresse qu'à l'occasion de crises, c'est-à-dire de
ruptures. On pourrait imaginer une théorie des lacunes qui aurait pour fil
conducteur, non pas ce que les sociétés utilisent mais justement ce
qu'elles n'utilisent pas dans un écosystème donné. Ce serait, en somme,
l'image en creux de la nature. L'idéal, évidemment inatteignable, serait
1.
Clément Rosset,
L'anti-nature,
PUF, Paris, 1990, p. 5.
2.
Ibi
d.
3.
Serge Moscovici,
Essai sur l'histoire humaine de la nature,
Flammarion, Paris,
1968.

De la nature aux images de la nature---------------------------------------------------- 3 9
de pouvoir observer synchroniquement des sociétés « au travail >> dans un
même écosystème. Ce n'est, on s'en doute, guère possible. Le moyen
d'avoir une idée de cela consiste, avec tous les défauts que la méthode
peut comporter, à analyser les corpus linguistiques pour repérer ce qui est
nommé ou non nommé, ce qui est l'objet ou non de constructions
syntagmatiques. L'observation diachronique est évidemment plus facile
mais beaucoup moins intéressante car les grilles culturelles se situent à des
niveaux différents, donc non immédiatement comparables. L'intersection
entre un écosystème naturel et un système culturel conditionne une ou
des images dont chacune possède une certaine probabilité de se produire
et qui s'enracine dans l'intentionnalité des divers acteurs. A chaque
image est lié un risque qui entretient des rapports étroits avec ce qu'on
néglige, autrement dit avec les lacunes. L'intention, toujours partiale,
découpe ce qui lui paraît utile dans un ensemble non entièrement connu,
d'où le risque. Toute culture génère du risque par le fait même qu'elle
est incapable de tout prendre en compte. Comment le pourrait-elle
d'ailleurs puisqu'elle se projette dans un ensemble de choses qu'elle ne
connaît que par les images partielles qu'elle a construites ? On se
souviendra de cette expérience dénommée « Biosphère 2 » qui a été une
tentative de créer un ensemble d'écosystèmes habités par quelques
scientifiques pendant plusieurs mois et complètement isolés du reste de la
planète. Que l'expérience ait été partiellement un échec n'est pas le
problème. Celui-ci est ailleurs. Il est dans le fait que les difficultés
rencontrées dans ce modèle réduit résultent de la non prise en compte de
certains facteurs ignorés à l'origine de l'expérience. Même si la cause du
manque d'oxygène semble avoir été élucidée après coup, d'autres
questions n'ont pas été résolues. L'intérêt de cette expérience n'en
demeure pas moins d'une portée considérable puisque grâce à elle, il a
été possible de mettre en évidence les lacunes de notre connaissance de la
nature.
Ce qui, en tout cas, va de soi, mais il faut le répéter car ce n'est ni
compris ni vraiment accepté, c'est qu'aucune société, aucun groupe ne
cherche véritablement à connaître ce qu'il est convenu d'appeler «la
nature ». La relation est toujours d'utilisation, d'appropriation, de prise
en compte à travers une intention d'usage et non pas à travers une
volonté de connaissance : c'est le fameux « arraisonnement » de la nature
dont parle Heidegger". L'arraisonnement a pour objectif de dériver les
forces, les énergies, les matières mais absolument pas de comprendre
indépendamment de toute utilisation. C'est le mode de dévoilement de la
technique. L'intention est toujours, dans un système culturel, de
retrouver, sous forme d'un gain, le coût consenti. Cela revient à dire,
contrairement à ce que l'on entend fréquemment, qu'il n'y a pas de
connaissance pure qui serait complètement détachée de toute
préoccupation utilitaire. L'existence même d'une culture rend caduque
4. Martin Heidegger, Essais et conférences, TEL Gallimard, Paris, 1958, p. 26.

40 --------------------------------------------------------- Espaces et sociétés
l'idée d'une connaissance pure, puisque les intentions de connaître sont
formulées à partir d'un système d'actions dont l'objectif est de
contribuer à sa propre pérennité. En conséquence, les décisions prises le
sont toujours par rapport à cet horizon sur lequel se profile la survie ou la
mort. Les sociétés ne s'organisent que pour durer, éternellement,
pourrait-on ajouter. Ne serait-ce pas cette fiction qui permet de répéter
inlassablement les mêmes gestes, les mêmes processus et de nourrir les
mêmes croyances... jusqu'aux premières ruptures ?
D'un point de vue métaphorique, on pourrait prétendre que les
sociétés sont devant la nature comme devant une infinité de pièces de
puzzle dont elles ne choisissent que celles qui correspondent à une
intersection utile dans leur modèle culturel, à un moment donné —
l'évolution étant réservée — et dans des conditions données. Pour
demeurer, encore un peu, dans le domaine de la métaphore, le modèle
culturel est une sorte de filet qui retient certaines pièces et en laisse passer
d'autres. Mais les filets ne sont jamais tissés une fois pour toutes et de
surcroît ils se déchirent sans être réparés mais restructurés dans leur
ensemble. Rien n'est modifié partiellement mais entièrement à travers les
relations qu'entretiennent les hommes avec les choses d'une part et avec
eux-mêmes d'autre part. Ainsi « l'homme est muni d'un imprévisible
pouvoir d'intervention qui lui permet tout à la fois de consolider ou de
ruiner les constructions naturelles »5. Mais ce qu'il convient d'ajouter,
relativement à ce pouvoir imprévisible, c'est l'ignorance dans laquelle il
est de ce qu'il consolide ou ruine dans la nature puisque sa
préoccupation n'est jamais autre chose que d'assurer la continuité de son
action à travers « l'idée de nature servant toujours l'instance non
naturelle qui accompagne son apparition »'. C'est assez dire que l'idée de
nature est profondément paradoxale puisqu'elle sert à fonder, à justifier
et à légitimer les relations que les hommes entretiennent avec ce qu'ils
dénomment « la nature », dont les images leur sont fournies par leurs
modèles culturels au cœur desquels réside la nécessité des besoins.
Instance éternellement cachée, dissimulée et emprisonnée, la nature ne
ressortit donc qu'à l'idée et en cela même, n'en déplaise à beaucoup, elle
ne saurait être qu'une création anthropocentrique essentielle mais
néanmoins relative.
L'arraisonnement de la nature est pourtant allé si loin que les images
héritées ont subi des modifications majeures que l'on peut déchiffrer
dans la vulnérabilité critique de la nature « qui n'avait jamais été
pressentie avant qu'elle ne se soit manifestée à travers les dommages
causés. Cette découverte, dont le choc conduisait au concept et aux débuts
d'une science de l'environnement (écologie), modifiait toute la
représentation de nous-mêmes en tant que facteur causal dans le système
plus vaste des choses»7, L'Homo Faber s'est emballé et «sa création
5. Rosset, op. cit., p. 13.
6. Ibid., p. 15.
7. Hans Jonas, Le principe de responsabilité. Les éditions du cerf, Paris, 1993, p. 24.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%