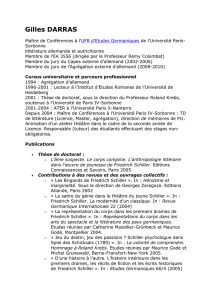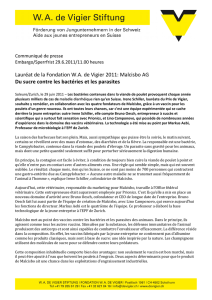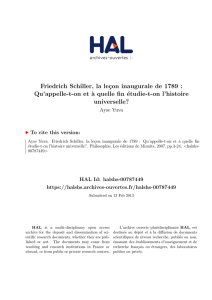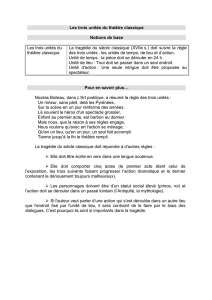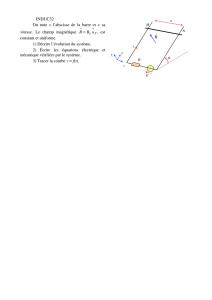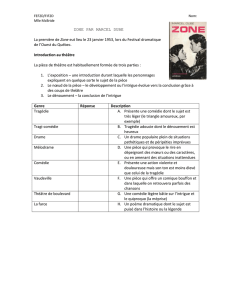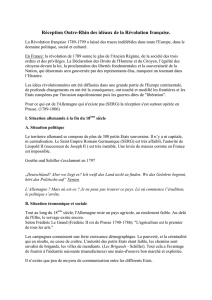« Wallenstein » et le romantisme français

Revue germanique internationale
22 | 2004
Friedrich Schiller. La modernité d’un classique
« Wallenstein » et le romantisme français
Bernard Franco
Édition électronique
URL : http://rgi.revues.org/1036
DOI : 10.4000/rgi.1036
ISSN : 1775-3988
Éditeur
CNRS Éditions
Édition imprimée
Date de publication : 15 juillet 2004
Pagination : 161-173
ISSN : 1253-7837
Référence électronique
Bernard Franco, « « Wallenstein » et le romantisme français », Revue germanique internationale [En
ligne], 22 | 2004, mis en ligne le 01 septembre 2011, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://
rgi.revues.org/1036 ; DOI : 10.4000/rgi.1036
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
Tous droits réservés

« Wallenstein »
et le romantisme français
BERNARD FRANCO
Comme l’ont montré les études très exhaustives de Fernand Baldensper-
ger et d’Edmond Eggli1, Goethe et Schiller ont été les deux principaux
modèles allemands du romantisme français. Schiller demeure cependant
peut-être le véritable modèle dramaturgique2, et sa présence dans le réper-
toire français correspond largement à une réalité scénique. Schiller est tra-
duit et joué très tôt en France, sous la forme de mélodrames. L’exemple le
plus célèbre est le Robert, chef de brigands de Lamartelière3, qui suivait de
peu la traduction sous le titre Les Voleurs proposée par Bonneville et Friedel
dans leur anthologie du Nouveau Théâtre allemand, parue en 12 volumes
entre 1782 et 17854. La notoriété de Schiller avait atteint un tel seuil qu’il
fut déclaré citoyen français par la Révolution, sous le nom de Gille ! Au
Théâtre des Variétés-Étrangères, fermé par Napoléon en 18085, Schiller est,
à côté de Kotzebue, l’auteur allemand le plus joué. Kotzebue, dont la
dramaturgie est méprisée par Schiller et Goethe, est tenu par Mme de Staël
comme le « talent théâtral »6le plus pur en Allemagne, et son Adelaide
161
Revue germanique internationale, 22/2004, 161 à 173
1. Fernand Baldensperger, Goethe en France ; étude de littérature comparée, Paris, Hachette, 1904 ;
Edmond Eggli, Schiller et le romantisme français, Paris, J. Gamber, 1927 ; Genève, Slatkine Reprints,
1970, 2 vol.
2. Voir sur ce point E. Eggli, ibid., t. II, p. 136 sq.
3. La pièce est d’abord publiée à Paris chez Maradan et Barba, en 1793, et rééditée
en 1799. En 1822, elle paraît de nouveau dans la Suite du Répertoire du théâtre français. Enfin en 1838,
elle connaît une nouvelle édition en vol. séparé à Paris, chez Barba. Sur cette pièce, voir François
Labbé, Jean-Henri-Ferdinand Lamartelière (1761-1830). Un dramaturge sous la Révolution, l’Empire et la
Restauration ou l’élaboration d’une référence schillérienne en France, Berne, Peter Lang, 1990.
4. Cette première traduction, dans le douzième volume du Nouveau Théâtre allemand, est
publiée chez Duchesne en 1785. La pièce paraît de nouveau en 1800, à Paris, dans le premier
tome de la Bibliothèque germanique et Bibliothèque universelle éditée par Frédéric Cramer.
5. Renée Lelièvre, Le Théâtre des Variétés-Étrangères (1806-1807), Revue d’histoire du théâtre, t. XII,
no3, janvier-mars 1960, p. 193-309.
6. De l’Allemagne (1813), Paris, Garnier-Flammarion, 1968, 2 vol., seconde partie,
chap. XXIII, « Faust », t. I, p. 7.

von Wolfingen, traduite et publiée en français en 18221, inspire même Hugo
dans la célèbre scène des portraits d’Hernani. Mais il est significatif que la
première adaptation de Wallenstein en français, celle que Constant propose
en 1809, sous le titre de Wallstein, ait finalement été un projet destiné à
l’édition, dont la création n’a pu aboutir. Plutôt que de faire jouer Wallen-
stein sur une scène française, Constant s’était en effet proposé de donner un
exemple du tragique propre à la dramaturgie allemande. En outre, l’idée
d’une réalisation scénique de la pièce a bien germé dans son esprit, mais fut
vite abandonnée. Le 25 février 1808 déjà, Constant écrit à Barante : « Ma
tragédie est fort ajournée, quant à la représentation au moins. [...] J’avais eu
tort de réunir à la fois Talma et d’autres. Talma n’a vu que son rôle, et les
autres ont reçu son impression. »2Cette rencontre avec Talma et sa troupe
a fait penser à Constant que la pièce de Schiller n’était pas propre à être
jouée sur une scène française : « Les morceaux les plus littéralement traduits
de l’allemand ont été les plus critiqués. »
La période classique de Schiller ne semble donc pas au premier abord
la plus aisée à transposer sur la scène française. En 1805, la polémique
autour de la Phädra de Schiller et la comparaison avec la pièce de Racine,
tenue pour emblématique de toute la dramaturgie française, ont alimenté
la critique. Ainsi dans son numéro du 8 mars 1806, le Journal de Paris
s’indigne que l’éditeur allemand de la traduction ait pu juger « la copie
supérieure à l’original ». La condamnation sévère de la pièce de Schiller,
jugée indigne de celle de Racine, témoigne sans doute d’une réticence du
goût français à l’égard d’une dramaturgie encore contestée. Mais surtout
s’opère ici un glissement par rapport à la fortune des Brigands : ce n’est en
effet plus l’auteur du Sturm und Drang qui sert de référence, mais celui du
classicisme de Weimar. Et ce caractère moins étranger est sans doute la
raison pour laquelle Schiller est l’objet de critiques plutôt que d’éloges. Il
pourrait paraître paradoxal de poser que le mélodrame, né en France
d’après les théories de Rousseau, tire son principal héritage du Sturm und
Drang et des Familien- et des historische Gemälde. Du reste, ces deux voies,
celle du Sturm und Drang et celle des Gemälde, étaient, en France, plus ou
moins mises sur le même plan. Mme de Staël, dans l’image monolithique
de l’Allemagne littéraire qu’elle s’était constituée, ne déclarait-elle pas,
avec une fierté narquoise, avoir logé Schlegel et Kotzebue dans la même
chambre de son château de Coppet3? Face à ces deux sources du mélo-
drame, la dramaturgie du classicisme de Weimar a pu former un modèle
162
1. Dans la série des Chefs-d’Œuvre des Théâtres étrangers publiée chez Ladvocat.
2. Lettre citée par Carlo Cordié, « Il “Wallstein” di Benjamin Constant nelle testimonianze
dell’autore », in Studi in onore di Carlo Pellegrini, Biblioteca di « Studi Francesi », vol. II, Turin, 1963,
p. 421.
3. « J’ai mis dans la même chambre Schlegel et Kotzebue, comme il convient à une étran-
gère qui ignore les querelles. » Lettre de Mme de Staël à Wieland du 31 mars 1804, citée par la
Comtesse de Pange, Auguste-Guillaume Schlegel et Madame de Staël d’après des documents inédits, Paris,
Albert, 1938, p. 90.

pour le drame romantique, et le modèle de Wallenstein a présenté un enjeu
à la fois dramaturgique et théorique.
D’une certaine façon, ces deux modèles représentés par la dramaturgie
schillérienne ne sont pas si étrangers l’un à l’autre. D’abord parce que la
dette du drame romantique à l’égard du mélodrame est évidente : Pixeré-
court, secrètement admiré par Hugo, transposait le Guillaume Tell de Schil-
ler sous la forme d’un mélodrame au moment même où Wallenstein était
l’objet de plusieurs traductions. Ensuite parce que l’amalgame possible de
la dramaturgie du Sturm und Drang et des tableaux de Kotzebue et Iffland,
filiation d’ailleurs affirmée par A. W. Schlegel dans ses Cours sur l’art drama-
tique et la littérature, constituait une des causes de l’orientation de Goethe et
de Schiller vers une dramaturgie classique. Dans les Xenies, ceux-ci s’en
expliquent et dénoncent chez Kotzebue et Iffland l’absence d’art. Cette
inflexion classique, fondée entre autres par le projet de réécrire certaines
pièces en vers, ou de puiser des sujets dramatiques dans le classicisme fran-
çais, ne se veut tout de même pas retour en arrière.
Dire que le drame romantique français a puisé plutôt à la source du
classicisme de Weimar ne conduit pas à évacuer la présence de la drama-
turgie du Sturm und Drang. Une pièce comme Hernani (1830) doit sans
doute beaucoup aux Brigands, auxquels elle reprend, en particulier, le
motif du marginal, une nouvelle définition du héros dans une action tou-
jours inachevée, un rapport problématique à la figure du père, une rela-
tion équivoque à la société. Hernani doit sans doute à Don Carlos le dédou-
blement de son intrigue, à la fois sentimentale et politique, et donc du
genre, puisque le tragique s’enracine dans une intrigue de drame bour-
geois. Mais là où le Schiller du Sturm und Drang laissait irrésolue cette
hétérogénéité fondamentale, les deux intrigues sont très étroitement cou-
sues ensemble chez Hugo. Car c’est le dénouement de l’intrigue poli-
tique, le retour en grâce d’Hernani auprès de Charles Quint, qui pro-
voque la jalousie de Don Rui Gomez et la mort des personnages dans la
scène finale. Une telle rationalisation du modèle du Sturm und Drang per-
met d’éclairer le besoin d’un modèle classique que l’on puisse ne pas dire
tel dans le contexte de la réception française. Effaçant, dans sa source
allemande, la distinction des courants et des écoles, l’image française de
l’Allemagne littéraire a en effet construit un modèle aussi homogène
qu’artificiel.
Ainsi peut donc s’expliquer l’apparent paradoxe que la source alle-
mande du romantisme français ait été le classicisme de Weimar. Wallenstein
propose un schéma qui apparaît comme un universel. Là aussi, l’intrigue
politique se double d’une intrigue sentimentale, mais celle-ci n’éclipse pas
« le grand, le gigantesque destin, qui élève l’homme en l’accablant »1, dont
parlaient Goethe et Schiller pour réhabiliter le classicisme. Les deux in-
163
1. Schiller et Goethe, Xenien, 1798, p. 207-259, in Schiller, Sämtliche Werke, 5 Bde, Bd. III,
München, Winkler-Verlag, 1968, p. 258.

trigues, en outre, sont indissolublement liées, assurant la profonde cohé-
rence de l’ensemble.
L’importance du drame historique classique est fondatrice pour la
théorie du drame romantique en France. La pièce est adaptée par Cons-
tant dès 18091, dans une édition précédée d’une préface dont le rôle,
l’impact et surtout l’audace ont eu une importance fondamentale pour la
genèse du drame romantique en France. Vingt ans après son adaptation,
en 1829, Constant réédite lui-même ses « Réflexions sur la tragédie de
Wallstein et sur le théâtre allemand », sous une forme remaniée, pour en
faire un de ses Mélanges de littérature et de politique. Significativement, cette
seconde édition intervient à un moment où le modèle allemand a cessé
d’être une nouveauté en France et où s’est développé le débat sur la néces-
sité d’une nouvelle forme tragique.
Les remaniements de cette seconde édition sont eux-mêmes le signe
d’une évolution de la réception du modèle de Schiller, évolution qui est
particulièrement perceptible dans le discours critique français sur Wallen-
stein. Comme l’a montré en particulier Charles Mazouer2, la seconde ver-
sion de ce texte a pour principal apport de mettre en place une nouvelle
définition du tragique, lui ôtant sa signification transcendante et envisa-
geant le héros dans le contexte de l’univers social. Constant montre que
l’ordre social et l’action de la société sur l’individu sont, à l’époque
moderne, « tout à fait équivalents à la fatalité des anciens »3. Ils répondent
à la nature même du genre dramatique, définie par « la force morale de
l’homme combattant un obstacle »4.
Une telle redéfinition du tragique par Constant pouvait apparaître
nécessaire à une époque où s’estompe la vision du tragique. Dans les
années 1820 florissent par exemple des traductions de Schiller qui vont
dans ce sens. Tel n’est certes pas le cas de la grande entreprise de Barante
qui publie, chez Ladvocat, ses Œuvres dramatiques de Schiller en 1821. La
préoccupation tragique reste encore au premier plan du Don Carlos adapté
par Soumet sous le titre d’Élisabeth de France et elle demeure dans le Fiesque
d’Ancelot. Mais Pixerécourt d’abord, puis Sedaine et Guétry font de Wil-
helm Tell des mélodrames. Le choix même de la pièce témoignait d’une
volonté de placer au premier plan une Providence qui abolissait le
tragique.
Comme le soulignait Constant dans ses « Réflexions [...] », le sujet de
la pièce, la guerre de Trente ans, représentait un épisode fondateur dans
l’histoire allemande, ainsi que dans la conscience du public. En outre la
structure est double chez Schiller : dans une véritable dramaturgie du
164
1. Wallstein. Tragédie en cinq actes et en vers, Édition critique [...] par Jean-René Derré, Paris,
« Les Belles Lettres » [1965].
2. Voir « Le groupe de Coppet et la réflexion sur la tragédie », Littératures classiques, no48,
printemps 2003 : Jeux et enjeux des théâtres classiques (XIXe-XXesiècles), p. 36.
3. Réflexions sur la tragédie, in Œuvres, éd. citée, p. 952.
4. Ibid., p. 938.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%