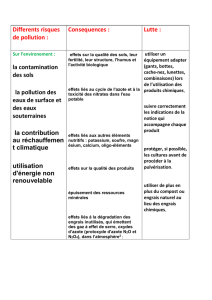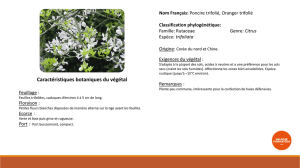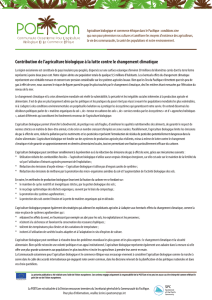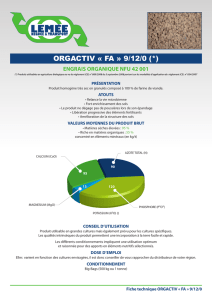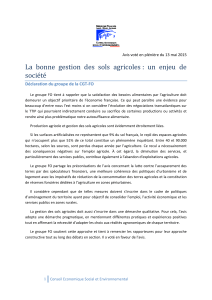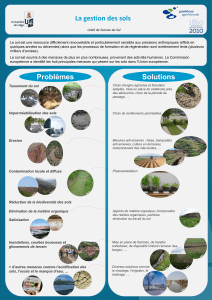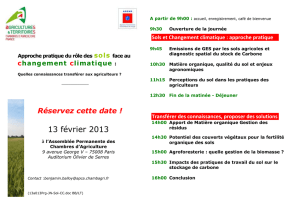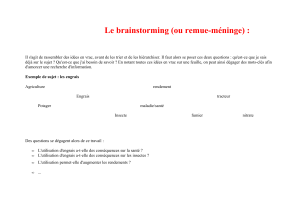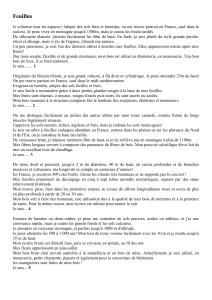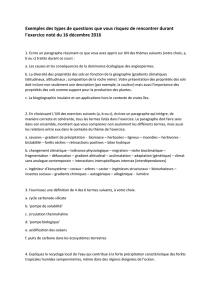Module 5: Conservation des sols gestion de la fertilité des sols des

CURRICULUM D’APPRENTISSAGE
PRODUCTION ET POST PRODUCTION DU RIZ
Module 5:
Conservation des sols
gestion de la fertilité des sols
des exploitations agricoles.

SOMMAIRE
SIGLES ET ABRÉVIATIONS.................................................................4
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION.......................................................5
II. OBJECTIFS DU MODULE.................................................................6
III. PUBLIC CIBLE..................................................................................6
IV. DURÉE DU MODULE........................................................................6
V. DÉROULEMENT.................................................................................6
5.1 Séance de facilitation 1:
Aptitude des sols à la riziculture...........................................................7
5.2 Séance de facilitation 2:
Techniques de préservation et de fertilisation des sols en riziculture......13

3
SOMMAIRE
SIGLES ET ABRÉVIATIONS.................................................................4
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION.......................................................5
II. OBJECTIFS DU MODULE.................................................................6
III. PUBLIC CIBLE..................................................................................6
IV. DURÉE DU MODULE........................................................................6
V. DÉROULEMENT.................................................................................6
5.1 Séance de facilitation 1:
Aptitude des sols à la riziculture...........................................................7
5.2 Séance de facilitation 2:
Techniques de préservation et de fertilisation des sols en riziculture......13

4
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Al Aluminium
DRS Défense et Restauration des Sols
cm centimètre
Fe Fer
kg kilogramme
Mn manganèse
NAzote
ONG Organisation Non Gouvernementale
PPhosphore
pH potentiel Hydrogène
Si Silicium
ttonne
Ha hectare
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le sol est la partie arable de la terre servant de support aux cultures pour leur maintien et leur
alimentation en eau et en éléments nutritifs. Il représente le support de la production agricole. C’est
le réservoir d’eau et de nutriments pour la culture. Tout ce qui est donné à la culture est d’abord
apporté au sol pour que les plantes les reprennent via leur système racinaire.
Le concept de conservation du sol en riziculture renvoie à l’idée que le sol doit garder ses propriétés
de contenant (structure, statut physico-chimique) pour une bonne aptitude à la riziculture. Les
exploitants rizicoles y arrivent à travers les pratiques agricoles et de DRS1.
Les sols de par leur nature (structure et texture) et la composition humifère seraient favorables à
telles ou telles cultures, on parle de vocation agricole des sols. La riziculture est favorable sur des
sols lourds à moyens, avec une bonne activité organo-minérale, on parle de plus en plus de sols
paddy (sols de riziculture).
La gestion de la fertilité est un concept qui consiste à apporter de façon optimale les nutriments
complémentaires au sol pour une production agricole orientée vers l’efcience.
La conservation des sols et la gestion de la fertilité est indispensable pour une riziculture durable et
productive.
Les concepts obéissent à des techniques culturales innovantes, des comportements de producteurs
qu’il importe d’apprendre aux exploitants en vue d’une bonne réussite des projets agricoles
notamment ceux de l’irrigation de proximité. Ce module est conçu à cet effet. Il comprend deux
séances de facilitation
Séance de facilitation 1 : description de l’aptitude des sols en riziculture
Séance de facilitation 2 : application des techniques de préservation et de fertilisation des
sols en riziculture
Chaque séance de facilitation comprend les éléments suivants :
Objectifs d’apprentissage,
Démarche d’animation,
Temps nécessaire,
Matériels, appareils et outillages.
DRS : Défense Restauration des Sols.

5
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le sol est la partie arable de la terre servant de support aux cultures pour leur maintien et leur
alimentation en eau et en éléments nutritifs. Il représente le support de la production agricole. C’est
le réservoir d’eau et de nutriments pour la culture. Tout ce qui est donné à la culture est d’abord
apporté au sol pour que les plantes les reprennent via leur système racinaire.
Le concept de conservation du sol en riziculture renvoie à l’idée que le sol doit garder ses propriétés
de contenant (structure, statut physico-chimique) pour une bonne aptitude à la riziculture. Les
exploitants rizicoles y arrivent à travers les pratiques agricoles et de DRS1.
Les sols de par leur nature (structure et texture) et la composition humifère seraient favorables à
telles ou telles cultures, on parle de vocation agricole des sols. La riziculture est favorable sur des
sols lourds à moyens, avec une bonne activité organo-minérale, on parle de plus en plus de sols
paddy (sols de riziculture).
La gestion de la fertilité est un concept qui consiste à apporter de façon optimale les nutriments
complémentaires au sol pour une production agricole orientée vers l’efcience.
La conservation des sols et la gestion de la fertilité est indispensable pour une riziculture durable et
productive.
Les concepts obéissent à des techniques culturales innovantes, des comportements de producteurs
qu’il importe d’apprendre aux exploitants en vue d’une bonne réussite des projets agricoles
notamment ceux de l’irrigation de proximité. Ce module est conçu à cet effet. Il comprend deux
séances de facilitation
Séance de facilitation 1 : description de l’aptitude des sols en riziculture
Séance de facilitation 2 : application des techniques de préservation et de fertilisation des
sols en riziculture
Chaque séance de facilitation comprend les éléments suivants :
Objectifs d’apprentissage,
Démarche d’animation,
Temps nécessaire,
Matériels, appareils et outillages.
DRS : Défense Restauration des Sols.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%