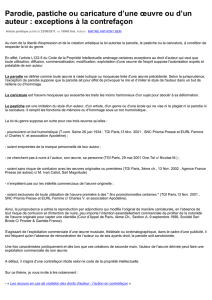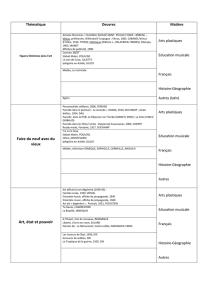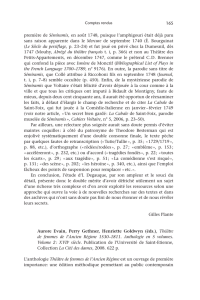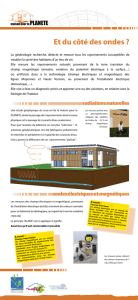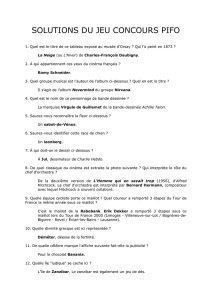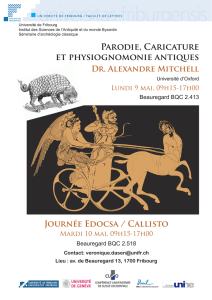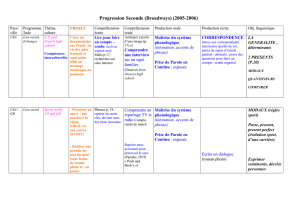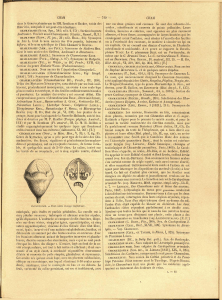La bande dessinée au siècle de Rodolphe Töpffer (12)

La bande dessinée au siècle de
Rodolphe Töpffer (12)
. (Suite de la publication de la thèse de Camille Filliot. > Présentation et table des
matières ici.)
B. Théâtre, littérature, poésie
Avec le récit de voyage ou d’aventures comme point d’appui, la bande dessinée ne
s’écarte pas trop du registre comique puisqu’elle continue de côtoyer des genres
parallèles également humoristiques. Elle n’hésite pourtant pas non plus à
s’emparer de domaines plus éloignés et à tirer les flèches de la satire en direction
d’un texte singulier, voire d’un trait d’écriture.
1. Actualité théâtrale
À côté de la formidable expansion des usages de l’image, de la littérature à bon
marché et de l’accès à la lecture du journal, le XIXe siècle connaît un
accroissement sans précédent de l’activité théâtrale. De l’affranchissement du
drame romantique des règles de la dramaturgie classique à l’imposante
propagation des salles de Boulevard, le spectacle théâtral s’ouvre au public et
devient un divertissement à la fois mondain et populaire, prisé dans tout Paris.
Comme le voyage touristique ou la partie de campagne, il est un élément de la vie
sociale, qui prend une intensité particulière dans les années 1870-1880, sous
l’effet du décret du 6 janvier 1864 supprimant l’autorisation préalable à
l’ouverture d’un théâtre. Principale distraction culturelle des Français à partir du
Second Empire, le théâtre croise l’histoire en images par son objectif essentiel,
celui du divertissement et du comblement de ce nouveau temps de loisir et de
sociabilité, en fonction duquel l’aménagement urbain et le marché de l’industrie
sont spécifiquement pensés. Le faste de la modernité parisienne s’illustre par
cette activité où le regard domine : en allant au spectacle ((Aller au spectacle, en
respectant les règles d’un calendrier hebdomadaire (lundi et vendredi à l’Opéra,
mardi au Français, samedi au Nouveau Cirque) fait partie de cet emploi du temps

de la vie parisienne, dont nous avons parlé au sujet des planches chronologiques ;
J. Csergo, « Extension et mutation du loisir citadin, Paris XIXe – début XXe siècle »,
L’avènement des loisirs : 1850-1960, 2001, p. 133.)), l’on va voir la scène comme
l’on se donne à voir, à l’instar de l’album d’images ostensiblement posé sur la
table du salon. Le Théâtre de Divertissement ou le Théâtre de Boulevard
(vaudeville, mélodrame, comédie d’intrigue, drame bourgeois, opéra comique)
rejoint la bande dessinée par la place faite au comique et à la satire ainsi que par
l’importance accordée au visuel, en convoquant tous les arts du spectacle
(pantomime, acrobatie, danse, musique, costumes, décors impressionnants, etc.).
L’interdépendance des arts graphiques et des arts du spectacle se manifeste, plus
encore, par le biais de nombreux transferts de la page à la scène et vice-versa. En
sont les parfaits témoins Joseph Prudhomme, cette caricature du bourgeois
français imaginée par Henry Monnier vers 1830 (et dont on retrouve le caractère
fat et les raisonnements absurdes chez nombre de nos anti-héros graphiques),
d’abord en lithographie puis comme personnage de pièces qu’il écrit et joue, et
Robert Macaire, figure récurrente du criminel incarnée pour la première fois au
théâtre par Frédéric Lemaître (1800-1876) en 1823 et qui devient, sous le crayon
de Daumier, l’objet de caricatures parues dans Le Charivari de 1836 à 1838
((Évoquant à ce sujet une « forme de mutation transmédiale », Marie-Ève
Thérenty précise que le personnage est également chanté dans Le Robert
Macaire, chansonnier grivois (1835) et mis en texte, entre autres, dans une série
de physologies de James Rousseau, voir « Un comique “trans” : Robert Macaire.
Transmédialité et transgénéricité d’une figure nationale », Insignis, n° 1, mai
2010, [en ligne],
http://s2.e-monsite.com/2010/05/15/1047939un-comique-trans-marie-eve-therenty
-pdf.pdf (consulté le 15.05.2016).)).
Le théâtre, également, dans la variété des formes qu’il prend alors, rencontre
directement la séquence graphique par le biais du discours critique. Dans le
cadre d’une autonomie générique acquise par la critique au sens large, s’établit
effectivement une tradition littéraire et graphique de critique théâtrale diffusée
essentiellement par les journaux, lesquels contiennent généralement une rubrique
« théâtre » réservée à l’annonce et aux commentaires des spectacles. La
séquence dessinée n’est que l’une des formes prises par ce discours graphique
sur le théâtre, elle reste d’ailleurs minoritaire. Prenant l’exemple du journal La
Vie parisienne, Jean-Claude Yon ((J.-C. Yon, « La critique au crayon : l’exemple de
La Vie parisienne (1865-1867) », Le Miel et le fiel. La critique théâtrale en France

au XIXe siècle, M. Bury et H. Laplace-Claverie, Paris : Presse de l’Université Paris-
Sorbonne, 2008, pp. 69-87.)) donne les différents types d’utilisation de l’image : il
cite les « images anecdotiques » qui consistent en l’évocation des costumes de
scène, les « comptes rendus en image » et les « tableaux synoptiques », c’est-à-
dire des constructions graphiques présentant en une page un jugement
synthétique sur une pièce. Le récit graphique entre dans la seconde catégorie,
bien que Jean-Claude Yon (qui n’en fait pas mention) précise que « le compte
rendu en image présente une très grande variété de cas », où « rares sont les
articles où les images et le texte se partagent à égalité le discours critique ».
Encore faut-il se méfier de « l’imbrication typographique du texte et des images
[qui] est parfois un faux-semblant car elle n’implique pas nécessairement une
synergie entre eux, les deux discours étant alors plutôt parallèles que concertés »
((Ibidem, p. 79 et p. 76.)). Dans ces sortes de parodies graphiques que nous avons
relevées dans Le Journal amusant, certaines portent effectivement à confusion
mais, parfois, ces « chroniques théâtrales » – l’une d’elles porte ce sous-titre au
singulier – répondent aux critères d’une histoire en images où des liens
sémantiques unissent étroitement les dessins légendés. À propos des planches
liées au théâtre qu’Albert Robida donne dans la presse (La Vie parisienne, La
Caricature), Sandrine Doré ((S. Doré, « Albert Robida, critique en image de
l’actualité théâtrale des années 1870-1880 », Albert Robida, du passé au futur. Un
auteur-illustrateur sous la IIIe République, Amiens : Encrage ; Paris : Les Belles
Lettres, 2006, pp. 37-56.)) étudie également cette forme répandue de critique en
images, qu’elle divise en quatre catégories : la simple juxtaposition d’images
(forme récapitulative, la plus courante), le récit linéaire (forme narrative héritée
de la formule du Journal amusant) ((Un exemple est constitué par une planche de
Stop qui parodie la pièce de Victorien Sardou, Thermidor (Le Journal amusant,
14.02.1891). À première vue, le dispositif s’apparente à celui d’une bande
dessinée : une succession d’images accompagnées d’une à cinq lignes de texte. À
la lecture, le texte aussi court puisse-t-il être n’est cependant pas scindé, il ne se
réfère pas clairement à une image spécifique. Les figures semblent effectivement
fonctionner en parallèle au texte, comme l’illustration de la scène qu’il décrit. Il
ne s’agit pas à proprement parler de cases, non seulement parce que les images
ne dialoguent pas mais parce que le texte ne se plie pas à la segmentation que la
bande dessinée suppose généralement. La lecture de haut en bas, et non de
gauche à droite, est un indice supplémentaire de la nature de cette page qui
relève, malgré les apparences, du texte (très abondamment) illustré.)),

l’amalgame de deux pièces (procédé de condensation induisant une mise en page
ramassée) et la forme dialoguée qui se présente comme une parodie du genre
dramatique. Si elles ne sont pas uniquement dialoguées (un narrateur peut
introduire les répliques et raconter l’histoire), les séquences dessinées se
présentent en effet comme des parodies, obligées de simplifier et condenser
l’intrigue pour tenir dans le format d’une ou deux pages. Ce sont des parodies à
l’ironie mesurée toutefois, car l’exercice vise plus le commentaire ludique,
l’adaptation comique en vue d’attirer le lecteur ayant assisté à la représentation
ou en ayant entendu parler, que la critique acerbe. Il s’agit le plus souvent non
pas de railler mais de prolonger (ou préparer) le plaisir de la sortie théâtrale,
même si le terme « compte rendu » utilisé pour ce genre d’écriture au second
degré signale une distance critique.
Dans les années 1880 dans Le Journal amusant, Louis Morel-Retz (sous le
pseudonyme Stop) est le principal signataire des parodies théâtrales. Il est en
territoire connu puisqu’il réalise à côté de son œuvre de caricaturiste les textes
de plusieurs opérettes et saynètes (comme Le Sicilien et l’Amour peintre, écrite
en 1877) et qu’en tant que costumier, il collabore à la réalisation de pièces
musicales. D’une manière concise et simultanée, la séquence parodique lui
permet de commenter la façon dont est menée l’intrigue, le jeu des acteurs, les
qualités de la mise en scène (scénographie caricaturée par l’image) tout en
détournant la pratique même de la critique dramaturgique : l’adaptation de la
pièce d’Albert Delpit, Le Fils de Coralie ((Représentée le 16 janvier 1880 au
Théâtre du Gymnase et parodiée dans Le Journal amusant du 7 février 1880.)), est
un « compte rendu fantaisiste » (Le Journal amusant, 07.02.1880). Dans cette
séquence théâtrale, comme dans d’autres, Stop use en effet du procédé typique
de la bande dessinée comme de la caricature, la syllepse de sens. Dans le cadre
d’une parodie dramaturgique, le pied de la lettre dédouble le rire qui n’a plus
seulement la pièce pour objet mais la tournure prise par la nouvelle histoire
présentée. L’image sort soudain de son rôle d’imitation, d’artefact de la scène
pour servir l’esprit de facétie de la reprise. Lorsqu’il évoque le destin de Coralie,
« belle petite retirée du service après avoir considérablement rôti un balai dont
Montjoie a quelque peu tenu le manche » (l’expression « rôtir un balai »
signifiant « mener une vie de débauche »), Stop représente les deux personnages
autour d’un feu, occupés à brûler un balai. L’image suivante appuie l’effet
aberrant par son abstraction, elle symbolise la supplication de Coralie – ancien
viveur, Montjoie a reconnu Coralie qui s’est réfugiée en province sous un faux

nom – par une montre sombrant dans une eau encadrée de montagnes tandis que
le texte pastiche la réplique, « Reconnaissance : Ne me perdez pas, dit-elle ;
toutes les eaux d’un fleuve ne laveraient pas une heure de ma vie passée ! – Cette
image hardie le décide à se taire » ((La critique rejoint ici celle de Zola écrivant à
propos des deux premiers actes de cette pièce, qu’il trouve bien menée mais à la
moralité obscure : « Je ne fais des réserves que pour la langue ; c’est trop écrit,
avec des enflures de phrases, tout un dialogue qui n’est point vécu », Le
Naturalisme au théâtre : les théories et les exemples, Paris : G. Charpentier,
1881, p. 321.)). Oubliant sa qualité de double de la scène, le dessin se fait aussi
artificiel, aussi abstrait et inapproprié que le style ampoulé. Focalisant sur la
forme de la chronique, la syllepse en image permet alors de rendre visibles les
invraisemblances et les excès dramaturgiques. Ainsi de Michel Strogoff jonglant
au sens propre, sur la simili scène graphique, avec des obus – Michel Strogoff,
mélodrame en cent soixante tableaux et quatre clous, mais sans la plus petite
pointe d’amour, par MM. Dennery et Jules Verne (fig. 88). L’effet comique
associant texte et image perd toutefois de sa fonction critique, au bénéfice d’un
comique gratuit, lorsque la concrétisation repose sur un calembour, tel le « rat-
d’eau » qu’empruntent les personnages du roman mis en scène par Jules Verne et
Adolphe Dennery. En tant que pièce à grand spectacle, louée pour la richesse des
décors et les effets de mise en scène, Michel Strogoff, qui est d’abord un roman
d’aventures, est la cible idéale de la parodie graphique. Les images s’enchaînent à
vive allure, selon une logique parataxique, marquée à l’aide d’une abondance de
tirets (« Ils arrivent à Kolyvan », « Il rencontre sa mère », « Elle lui joue
admirablement sa scène du Prophète »), ou à l’inverse hypotaxique (« Mais l’émir
Ali-Baba », « Cependant Strogoff », « Par un de ces hasards comme on n’en voit
qu’au Châtelet », « Pendant ce temps ») ; et à la fin : « On croit la pièce finie ; pas
du tout, il y en a encore », « Les Tartars reçoivent une véritable pile de Volga. –
Strogoff est fait caporal, le succès est général ». Parmi cette succession d’actions,
les changements de décors à vue, dont la qualité visuelle est soulignée par
l’encadrement des images, font rupture : « Là est planté le premier clou », la
réception impériale à Moscou n’est plus qu’un alignement de chevaux de bois et
de balais. Le panorama mouvant des rives de l’Angara se signale également par le
rendu graphique du mouvement où les conifères et une maison sont dotés de
jambes, à la manière de la case évoquée plus haut de Mr Boniface. Si Stop
souligne en guise de conclusion le plébiscite remporté par cette représentation,
comme une autre pointe ironique, c’est que l’imitation par le biais de la bande
dessinée n’est possible, dans le cadre d’un journal, que lorsque la pièce est
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%
![Analyse des discours COURS8[1].](http://s1.studylibfr.com/store/data/003402930_1-2c3b3134c5ae82d983c987d5914495b2-300x300.png)