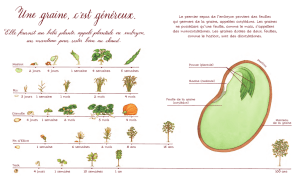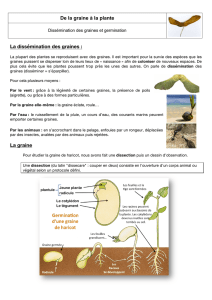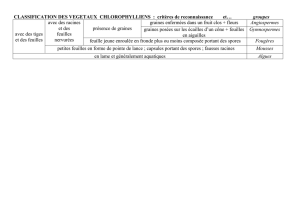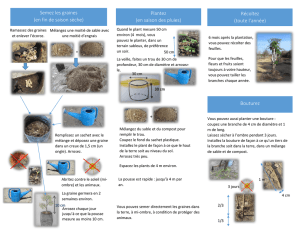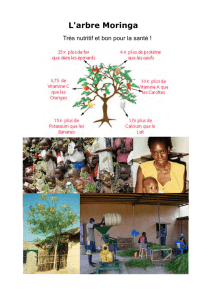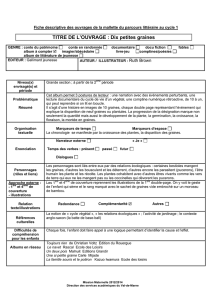Mémoire

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
Faculté des Sciences Biologiques et des Sciences Agronomiques
Département de Biologie
Mémoire
En vue de l’obtention du diplôme de Magister en Biologie
Option : Interactions Plantes-Animaux dans les Ecosystèmes Naturels et Cultivés.
Présenté par : Melle ABRAZ Fatma
THEME
Soutenue le : 10 /11 /2015, devant le jury composé de :
Présidente : Mme Sadoudi-Ali Ahmed D. Professeur, UMMTO
Promoteur : MrKellouche A. Professeur, UMMTO
Examinatrice : Mme Medjdoub-Bensaad F. Professeur, UMMTO
Examinatrice : Mme Aouar-Sadli M. Maître de conférences (A), UMMTO
Examinatrice : Mme Taleb-Toudert K. Maître de conférences (B), UMMTO
Etude de l’activité biologique des extraits de quelques
plantes aromatiques à l’égard d’un insecte ravageur des
grains stockés, Callosobruchus maculatus (Coleoptera :
Bruchidae).

I
Remerciements
Je remercie Dieu le tout puissant de m’avoir donné le courage et la force qui m’ont
permis, de mener ce travail à terme, lui seul sait à quel point j’ai souffert et combien de
sacrifices que j’ai consenti afin d’y parvenir. Je ressentais l’aide divine à chaque moment de
désespoir, il illuminait ma voie et il guidait mes pas perpétuellement. Dieu merci.
Tout d'abord je voudrais témoigner ma très grande reconnaissance à mon promoteur
MrKellouche A., professeur exerçant à la faculté des sciences biologiques et des sciences
agronomiques pour avoir bien voulu m'accepter dans son laboratoire d'Entomologie
Appliquée de l'Université M.M.T.O et m’accorder l’honneur de diriger ce travail de
recherche, ainsi que pour ses conseils, sa sagesse et sa disponibilité, parfois même durant ses
périodes de vacances. Je profite à travers ses quelques lignes lui rendre hommage pour sa
rigueur scientifique, son talent de pédagogue et sa générosité que tous ses étudiants et ses
collègues lui reconnaissent. Merci MrKellouche.
Je remercie très profondément Mme Sadoudi-Ali Ahmed D., professeur à
l'U. M.M.T.O et chef de département de la Biologie Animale et de la Biologie végétale pour
m’avoir fait l’honneur d’accepter la présidence de ce jury, malgré ses multiples obligations.
Qu’elle trouve ici mes sincères impressions de gratitude, de respect et d’admiration.
Il m’est aussi agréable de remercier Mme Medjdoub-Bensaad F., professeur à
l'U. M.M.T.O qui a bien voulu accepter de juger ce travail. En tant que responsable de la Post-
Graduation (2012/2013), je vous remercie très sincèrement de nous avoir donné la chance
pour la graduation.
Que Mme Aouar-Sadli M., maître de conférences (A), trouve ici l’expression de ma
profonde reconnaissance et mes sincères remerciements, pour m’avoir fait l’honneur d’être
examinatrice de ce travail.
Mes remerciements vont aussi à Mme Taleb-Toudert K., maître de conférences (B),
pour l’attention qu’elle a bien voulu porter à ce travail, en qualité d’examinatrice. Je suis
particulièrement honorée par votre participation à ce jury.
Je voudrais associer à ces remerciements le professeur MrHouali K., vice doyen
chargé de la Post-Graduation, de la recherche Scientifique et des Relations Extérieures, qui
nous a ouvert grandement sa porte à chaque situation de détresse. Merci MrHouali, "l’ange
gardien des étudiants", comme je vous surnommais depuis toujours, pour les cours
d’immunologie et même d’anglais que vous m’avez prodigués et qui m’ont servi de véritable
support. Vous avez le talent d’un vrai pédagogue. Vous avez tout mon respect et ma
reconnaissance.

II
Je remercie Mme Bachouche qui m’a fait l’analyse statistique des données. Merci de
m’avoir réconfortée dans mes moments de doute. Qu’elle trouve ici l’expression de ma
profonde reconnaissance.
Ma reconnaissance va aussi à Sabrina Bounoua, à Tinhinane Laoudi et à Djamila
Naamane pour l’aide qu’elles m’ont apportée. Merci de m’avoir toujours écoutée et
conseillée. Que dieu vous aide à réaliser tout ce dont vous rêvez.
Je tiens à exprimer mes sincères gratitudes à l’inspecteur de sciences naturelles, Mr
Staïhi S. Qu’il me soit ici permis de lui rendre hommage pour ses grandes qualités humaines.
Je vous remercie très sincèrement pour m’avoir écoutée, conseillée et rassurée.
Mes remerciements les plus chaleureux sont aussi destinés à l’être que je chéris le
plus au monde "ma maman", à mes frères et sœurs ainsi qu’à mes adorables neveux et nièces
pour leur amour et leur soutien moral qui m’ont servi de puissants appuis.
Mes remerciements s’adressent également à :
- Tous les enseignants qui nous ont assuré l’année théorique de la PG, pour leurs
souplesses et leurs compréhensions ainsi que tous les étudiants (es) de ma promo.
- Tout le personnel du laboratoire d'Entomologie Appliquée de l'U. M. M. T.O.
- Tous les élèves du lycée Omar Toumi de Tigzirt, plus particulièrement les classes 2S1,
1S4et 2Lp (promo 2012/2013) ainsi que 3M (promo 2014/2015), qui m’ont armé sans
qu’ils le sachent, du courage dont j’avais besoin lors de fortes pressions auxquelles
j’étais soumise.
- Tout le personnel du lycée Omar Toumi de Tigzirt notamment à papa Tawtaw (Mr
Touatioui), mon ex-enseignant de sciences naturelles qui, à ce jour, supporte le lourd
fardeau des classes d’examen (BAC), alors qu’il est normalement temps que je m’en
charge. Je lui dois plus que je ne saurais dire.
Enfin, je suis reconnaissante envers tous ceux et toutes celles qui de loin ou de près
ont contribué, avec un geste aussi petit qu’il soit, à l’aboutissement de cette réalisation.

III
Dédicaces
Je dédie ce travail à la mémoire de mon très cher papa qui a consenti d’énormes sacrifices
pour la réussite de ma formation et de mon éducation. J’aurais tant aimé que tu sois parmi nous à
ce moment. Que dieu t’accorde sa miséricorde.
A la source de ma tendresse, ma chérie maman ainsi qu’à mes frères et sœurs.
A mes adorables neveux et nièces (Samir, Sofiane, Zili, Kenza et Sara).
A mes cousins et cousines.
A tous mes élèves.

Liste des tableaux
IV
Tableau 1 : Noms scientifiques de C. maculatus depuis Fabricius (1775) jusqu’à Bridwell
(1929)………………………………………………………………………………………..... 9
Tableau 2 : Durée (en jours) des différents états et stades larvaires…………………………12
Tableau 3 : Résultats du test de NEWMAN et KEULS concernant l’effet des facteurs poudre
et dose sur la longévité des adultes de C. maculatus…………………………………………28
Tableau 4: Résultats du test de NEWMAN et KEULS concernant l’effet des facteurs poudre
et dose sur la fécondité des femelles de C. maculatus……………………………………….29
Tableau 5 : Résultats du test de NEWMAN et KEULS concernant l’effet du facteur dose sur
le taux d’éclosion (%) des œufs de C. maculatus…………………………………………....30
Tableau 6 : Résultats du test de NEWMAN et KEULS concernant l’effet du facteur poudre
sur le taux de viabilité (%) des adultes de C. maculatus…………………………………….31
Tableau 7 : Résultats du test de NEWMAN et KEULS concernant l’effet du facteur dose sur
le taux de germination des graines de V. unguiculata………………………………………32
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
1
/
69
100%