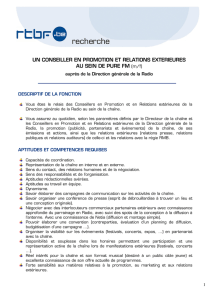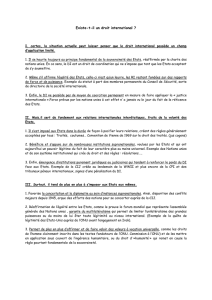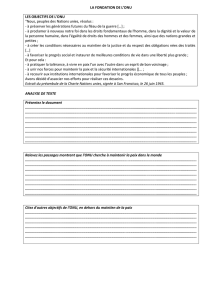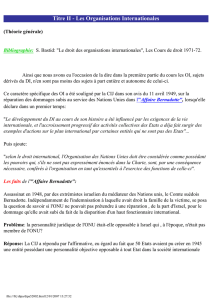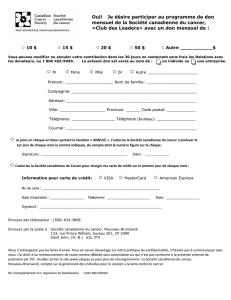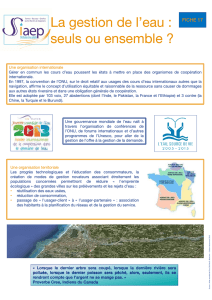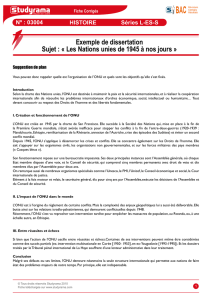LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE CANADIENNE À L`ÉGARD DE LA

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE CANADIENNE
À L’ÉGARD DE LA DÉCOLONISATION DE L’AFRIQUE
DE 1945 À 1960
Par
Thessa Girard-Bourgoin
Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales à titre
d’exigence partielle en vue de l’obtention de la maîtrise en histoire
Université d’Ottawa
© Thessa Girard-Bourgoin, Ottawa, Canada, 2013

i
- RÉSUMÉ -
Cette thèse porte sur l’évolution de la politique étrangère canadienne à l’égard de la
décolonisation de l’Afrique entre 1945 et 1960. Ce sujet est quasi-ignoré dans la
littérature savante, mais est tout de même important puisqu’il pose les bases des relations
entre le Canada et les pays africains qui émergent de la décolonisation.
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les relations diplomatiques entre le
Canada et le continent africain sont inexistantes. Ne détenant aucune colonie, le Canada
laisse l’entière responsabilité aux empires coloniaux présents sur le territoire. À contre
courant, peu à peu au cours des années 1950, le continent oublié devient un acteur
important sur la scène internationale que le Canada ne peut plus négliger. En 1960,
l’Assemblée générale de l’ONU adopte la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux
pays et peuples coloniaux, résolution entérinée par le Canada. D’une absence de politique
en 1945 à une adhésion complète au principe de décolonisation en 1960, le Canada se
façonne une politique coloniale dans le nouvel ordre mondial.
Qu’est ce qui arrive durant ces quinze années d’effervescence en politique étrangère
canadienne pour expliquer cet intérêt croissant envers le phénomène de décolonisation
africaine? Durant cette période, l’approche canadienne quant à la décolonisation de
l’Afrique est influencée par quatre éléments (les États-Unis, le Commonwealth, l’ONU et
l’OTAN) qui, d’une manière indirecte, interagissent avec les intérêts du Canada.
Finalement, cette thèse permet de démentir le mythe à l’effet que la politique étrangère

ii
canadienne, par rapport à l’enjeu colonial, est menée par des valeurs altruistes. Au
contraire, nous affirmons que ce sont les circonstances résultant de la guerre froide qui
expliquent les raisons pour lesquelles le Canada se dote d’une politique pour répondre à
la décolonisation africaine et non pas la conséquence d’une volonté politique d’appliquer
le concept d’auto-détermination des peuples.

iii
- REMERCIEMENTS -
Écrire cette thèse de maîtrise ne s’est pas avéré une tâche simple. Durant ces cinq
années à temps partiel, je dois avouer qu’il y a eu des hauts et des bas. Pourtant, j’ai pu
réaliser ce travail grâce aux encouragements et à l’appui de ceux qui m’entourent.
D’abord, je remercie mon directeur de thèse au département d’histoire de l’Université
d’Ottawa, Serge Durflinger, pour ses judicieux conseils. Sa compréhension quant à ma
situation personnelle m’a donné l’indépendance dont j’ai eu besoin pour rendre possible
cette réalisation. De plus, je dois mentionner le support et la flexibilité de mes patrons et
de mes collègues aux ministères des Affaires autochtones qui m’ont permis d’aisément
concilier le travail et les études. Par ailleurs, je remercie Kathy et Philippe pour avoir
attentivement lu ma thèse pour m’apporter une critique constructive dans mes périodes de
blocage. Je dois faire une mention spéciale du travail assidu de Bernadette qui a lu, relu et
encore relu ma thèse pour apporter les révisions et corrections nécessaires pour élever
mon texte à un niveau supérieur. Son enthousiasme face à mon projet m’a apporté la
motivation requise durant certains moments de découragement. Ensuite, je remercie ma
famille et, tout spécialement, mes parents pour leur support inconditionnel ainsi que pour
m’avoir fourni les qualités requises dans la vie pour être tenace devant ce lourd travail.
Finalement, je remercie mon mari, Philippe, pour sa patience, sa présence et son amour
ainsi que pour avoir toujours été là pour prendre soin de moi.

iv
- TABLE DES MATIÈRES -
RÉSUMÉ i
REMERCIEMENTS iii
TABLE DES MATIÈRES iv
TABLE DES ANNEXES vi
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLES vii
INTRODUCTION…………………………………………………………………..1
Historiographie.…………………………………………………………….….......3
Méthodologie…………………………………………………………………….10
Contenu de thèse.………………………………………………………………...12
CHAPITRE UN : La période de prise de conscience : 1945 - 1949……………....16
1.1 L’avènement de l’internationalisme dans la politique étrangère
canadienne d’après-guerre…………………………………………………...17
1.2 La création de l’ONU…………………………………………………….…..22
1.3 La possible existence de territoires non-autonomes au Canada……………...28
1.4 L’alignement entre les États-Unis et le Royaume-Uni………………………34
1.5 Les défis d’être non-colonisateur et membre du Commonwealth……….…..38
1.6 La disposition des colonies italiennes………………………………………..43
1.7 Le changement de garde à Ottawa…………………………………………...49
CHAPITRE DEUX : La période d’hésitation : 1949 - 1954……………………...55
2.1 Les incidences de la création de l’OTAN……………………………………56
2.2 L’importance des relations canado-françaises……………………………….64
2.3 L’intérêt grandissant de l’URSS envers l’Afrique…………………………...67
2.4 Les contradictions dans la politique étrangère canadienne…………………..70
2.5 L’ONU menacée par l’enjeu colonial………………………………………..78
2.6 La nécessité de demeurer en équilibre……………………………………….85
2.7 Les divisions entre les alliés quant à la stratégie de compromis……………..93
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
1
/
189
100%