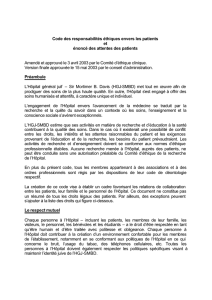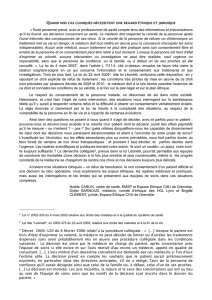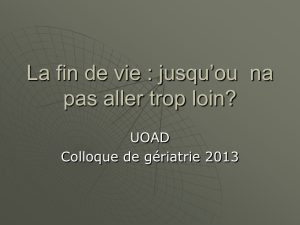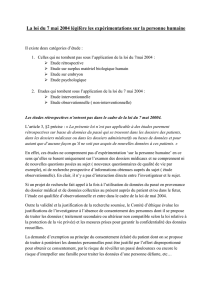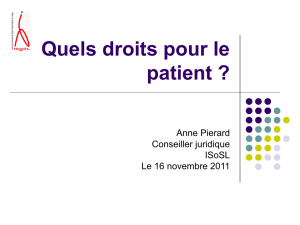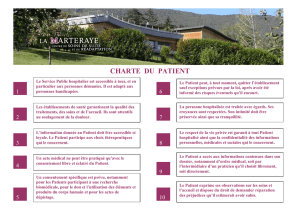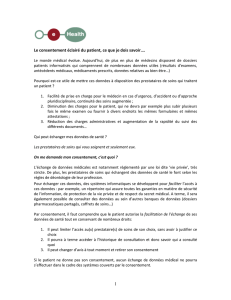Considérations éthiques sur l`accès aux traitements

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
International Bioethics
Committee (IBC)
Comité international
de bioéthique (CIB)
Distribution: limitée CIP/BIO.501/96/4
Paris, 22 décembre 1996
Originale : anglais
Considérations éthiques sur l’accès aux traitements,
expérimentaux et l’expérimentation sur des sujets humains
______________
Rapporteurs : Harold Edgar* et Ricardo Cruz-Coke**
* Directeur du Julius Silver Program in Law, Science and Technology, Columbia University, New York.
** Directeur de l’Unité de génétique, Hôpital J.J. Aguirre, Université du Chili.

Introduction
Le présent rapport a été rédigé en vue de faciliter les discussions au sein du Comité
international de bioéthique (CIB) sur le thème « Accès aux traitements expérimentaux et
protection des droits de la personne humaine ». Il s’agit principalement de déterminer si des
individus ou des groupes ont le « droit » de bénéficier de traitements expérimentaux, ou du
moins d’y avoir accès sans ingérence excessive des autorités, et dans quelle mesure. La
revendication d’un tel droit remet-elle en question les principes et les pratiques qui sous-
tendent la recherche biomédicale sur des sujets humains ?
Bien que s’inspirant de communications plus courtes rédigées par des membres du
CIB, cette étude n’est, d’aucune façon, un rapport du Comité. Elle n’a été précédée d’aucune
réunion préliminaire et la session annuelle du CIB a fourni la première occasion d’une vaste
consultation. Un excellent travail a toutefois déjà été réalisé sur ces questions et des thèmes
voisins sous les auspices d’autres organisations internationales, en particulier dans le cadre
des efforts conjoints de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Conseil des
organisations internationales des sciences médicales (CIOMS). Les rapports publiés à l’issue
des conférences de ces institutions et les International Ethical Guidelines for Biomedical
Research Involving Human Subjects (Genève, 1993) [Principes directeurs d’éthique concernant
les recherches biomédicales sur des sujets humains, désignées ci-après par le sigle IEG]
constituent des guides indispensables. Plusieurs membres du Comité international de
bioéthique ont participé aux travaux de l’OMS et du CIOMS.
La Section I du présent rapport décrit et analyse succinctement quelques-uns des
problèmes que pose l’accès aux traitements expérimentaux. La Section II examine les
positions adoptées à cet égard par les principaux textes juridiques internationaux et documents
relatifs aux questions d’éthique.
Il convient de souligner d’emblée une conclusion générale sur laquelle tout le monde
s’accorde. L’égalité d’accès aux traitements expérimentaux suscite d’intéressantes
interrogations (malgré l’absence de consensus sur le point de savoir si l’intérêt que peut
présenter un traitement de ce type pour un individu entraîne pour lui le droit d’en bénéficier).
Mais, d’un point de vue pratique, ce problème passe largement au second plan par rapport à
celui de l’égalité d’accès aux traitements « démontrés ». Même si nous ne l’abordons pas ici,
il est clair que cet autre problème représente un enjeu beaucoup plus important sur le plan
politique.
I. L’accès aux traitements expérimentaux : ce qui est en jeu
L’épidémie de Sida a donné un tour dramatique au problème de l’accès aux
traitements expérimentaux, mais l’on trouve déjà des réflexions sur des thèmes similaires
dans des écrits antérieurs, parmi lesquels des classiques comme Le dilemme du docteur de
G.B. Shaw. Toutefois, le Sida a fait prendre conscience avec une acuité nouvelle du rôle
indispensable de l’innovation scientifique et médicale et de l’obligation de prendre des risques
pour la rendre possible. Le fait de se prêter à des recherches a peu à peu acquis une
signification culturelle nouvelle. Lorsque, dans les années 60 et 70, les principes régissant la
recherche ont donné naissance à des normes juridiques et éthiques internationales, le courant
de pensée dominant (indépendamment des attitudes des patients réels souffrant de maladies
réelles) mettait l’accent sur les risques inhérents à la recherche médicale et la nécessité d’en
protéger les personnes prises comme sujets d’étude, nécessité d’autant plus grande lorsque ces
personnes appartenaient à des groupes historiquement défavorisés. L’épidémie de Sida nous
a appris à voir les choses différemment : il arrive que des individus atteints d’une maladie
presque à coup sûr mortelle acceptent volontiers de prendre des risques dans l’espoir d’une
possible thérapie (Edgar et Rothman, 1990). Les garde-fous institutionnels peuvent apparaître
inacceptables quand ils ont pour effet de ralentir les avancées thérapeutiques et n’autorisent le
recours à de nouveaux traitements prometteurs qu’après des tests rigoureux, alors même qu’il
n’existe aucune autre cure possible. De même, s’opposer, pour le protéger, à ce qu’un détenu
atteint du Sida participe à un traitement expérimental, ce peut être condamner à une mort
certaine une personne déjà frappée d’incapacité par des sanctions pénales (IEG 7 et
commentaire).

2
Pourtant, le problème de l’accès aux traitements expérimentaux ne se limite pas, loin
s’en faut, au Sida. Tout d’abord, il existe un grand nombre de maladies face auxquelles,
comme c’était le cas face au Sida (du moins avant les nouvelles thérapies combinées), les
médecins sont peu ou prou désarmés. Ensuite, ce problème en dissimule en réalité plusieurs.
Que l’on considère les cinq revendications, ou arguments possibles, ci-après. Chacune
de ces revendications soulève un problème potentiel lié à l’accès aux traitements
expérimentaux. Toutes intéressent directement le débat du CIB. Ont-elles une quelconque
pertinence ? Dans l’affirmative, en reconnaître la légitimité oblige-t-il à repenser les règles
actuellement admises en matière de recherche ?
1. Tout adulte en pleine possession de ses facultés devrait être libre d’opter pour un
traitement expérimental qu’un médecin est prêt à lui administrer, sans que leur décision
conjointe soit soumise à l’approbation d’un comité d’éthique ou de l’organe chargé de la
réglementation. Les gouvernements et les comités d’éthique ne doivent pas faire obstacle au
choix éclairé du patient.
2. Il est contraire à l’éthique d’exiger des personnes souhaitant suivre un nouveau
traitement prometteur, encore au stade expérimental, qu’elles acceptent en contrepartie de se
soumettre à un tirage au sort, en fonction duquel elles risquent de ne recevoir qu’un placebo
ou le traitement classique. Les gouvernements ne doivent pas subordonner l’accès à un
traitement expérimental du consentement d’un individu - essentiellement contre son gré - à
servir de cobaye.
3. Les règles d’éthique tendant à offrir une protection spéciale à certains individus privés
juridiquement de la capacité de donner leur consentement ont pour effet pervers de frapper
ces personnes vulnérables d’une discrimination inadmissible. Les gouvernements doivent
s’abstenir de toute discrimination à l’égard des personnes vulnérables en matière d’accès à des
traitements expérimentaux.
4. Les gouvernements doivent s’assurer que les femmes et les membres des groupes
ethniques minoritaires participent fréquemment aux expériences médicales, faute de quoi ils
se rendent coupables d’une discrimination à l’encontre de certaines catégories de personnes.
Des produits et des services médicaux seront introduits sur le marché sans que personne n’ait
cherché à savoir si ces traitements sont efficaces sur les patients de sexe féminin ou
appartenant à une minorité. L’une des conséquences manifestes de la révolution du génome
humain est d’avoir mis en évidence les différences existant entre les individus et l’impact de
ces différences sur les maladies et leur traitement. Si la prédisposition à différentes maladies
se déduit en grande partie d’une analyse génétique multifactorielle, il est probable que
l’efficacité des traitements variera, elle aussi, selon les groupes de patients, pour des raisons
également génétiques. Un gouvernement qui ne s’inquiète pas de savoir si les effets de tel ou
tel produit sur des catégories particulières de la population ont été convenablement testés ne
garantit pas l’égalité d’accès aux traitements efficaces.
Cet argument diffère quelque peu de celui qui consiste à dire qu’en protégeant certains
individus, les règles de déontologie leur barrent l’accès à des traitements qui, le plus souvent,
ont des chances de se révéler bénéfiques. On invoque ici le fait que certaines catégories de
personnes définies par leur sexe, leur origine ethnique, etc. réagissent, ou pourraient réagir,
différemment à une thérapie pour des raisons biologiques. Même si aucune femme en
particulier n’a connaissance de tel traitement expérimental ou ne cherche à en bénéficier, dès
lors que les autorités n’auront pas veillé à ce que des femmes participent aux tests, des
produits auront été approuvés sans prendre en compte leur utilisation possible par plus de la
moitié de la population. D’après nos discussions avec les membres du CIB, il semble que,
dans la pratique, ce problème se pose davantage dans certains pays que dans d’autres.
5. Dans certains contextes, les règles exigeant le consentement éclairé du patient avant la
mise en route d’une thérapie expérimentale peuvent rendre toute recherche impossible, de
sorte que les malades se retrouvent, collectivement, encore plus menacés que si l’on avait
autorisé les recherches. Quand elle empêche d’améliorer les traitements de certains troubles,
l’application des principes de déontologie revient à refuser aux personnes souffrant de ces
troubles l’accès à une cure efficace.

3
Chacune de ces revendications se prête à diverses variantes et nuances selon qu’on
prend en compte les cas où le patient est condamné à très brève échéance, l’existence d’autres
traitements efficaces, etc.. Nous nous en tiendrons dans le cadre de ce court essai à la version
que nous venons de présenter, même si l’accès aux traitements expérimentaux soulève
assurément d’autres problèmes encore.
Certains des arguments avancés touchent au problème de la répartition équitable d’une
ressource et supposent une analyse envisageant le traitement expérimental comme un bien
parmi d’autres biens. La question de savoir si l’on peut refuser l’accès à un traitement,
lorsque rien ne permet de penser que celui-ci serait bénéfique, est de toute évidence capitale.
On invoque aussi le respect du droit de tout individu en pleine possession de ses facultés de
décider par lui-même. Au nom de quoi la société s’autoriserait-elle à contester sa décision de
se prêter à une expérimentation ? D’autres arguments font intervenir le principe de la
bienfaisance. Ne devrait-on pas récuser les règles qui font obstacle à l’amélioration du
traitement de certaines maladies ? On le sait, ces trois principes - respect, justice et
bienfaisance - peuvent entrer en conflit dans diverses circonstances. Aucune méthode ne
recueillant l’unanimité ne permet d’en déterminer le poids relatif.
A. Justice et participation aux protocoles expérimentaux : quelques repères
Nous prendrons comme point de départ la troisième revendication. Mais nous
voudrions tout d’abord réitérer les réserves émises au début de notre rapport. En matière
d’accès aux soins médicaux, le problème principal, à l’échelle du globe, est l’impossibilité
dans laquelle se trouvent quantité d’individus, dans les pays riches comme dans les pays
pauvres, de bénéficier de médicaments et de traitements dont l’efficacité est connue et que
d’autres, plus fortunés, peuvent obtenir sur-le-champ. Les nouveaux médicaments contre le
Sida fourniront un nouvel exemple de cette injustice familière.
L’incapacité d’offrir des soins de santé d’un niveau raisonnable à toutes les personnes
qui en ont besoin est expliquée principalement par le coût élevé de ces soins, mais on met
également en cause l’infrastructure médicale et l’absence de services dans de nombreuses
régions, à quoi s’ajoute parfois l’ignorance des malades. Il n’en est pas moins tragique que des
personnes meurent faute d’avoir reçu les soins médicaux qui auraient pu aisément les sauver.
La question de savoir si cette faillite constitue un manquement aux obligations
internationales en matière de droits de l’homme a fait elle-même l’objet d’une abondante
littérature. Un grand nombre d’instruments internationaux et régionaux établissent
solidement le droit aux soins de santé élémentaires et le principe de l’accès sans
discrimination à ces soins. Il ne nous est pas possible de présenter ces textes sans allonger
excessivement notre rapport. Que nous ne nous y attardions pas n’enlève rien à l’importance
fondamentale de ce droit.
Offrir à chacun des soins de santé adéquats est un problème d’une telle ampleur et
auquel la communauté internationale apporte une attention si manifestement insuffisante qu’il
peut sembler futile de se demander si les traitements expérimentaux sont équitablement
répartis. Nombre des arguments avancés en faveur du droit aux traitements expérimentaux ne
sont pourtant que le corollaire du principe du droit à l’accès aux soins médicaux en général :
si les traitements expérimentaux ont de fortes chances de représenter un progrès par rapport
aux soins administrés habituellement, la justice, semble-t-il, commande qu’aucun obstacle
artificiel n’en limite l’accès (IEG 10 et commentaire).
On justifie cependant la pratique actuelle en faisant valoir qu’il peut être nécessaire de
restreindre temporairement l’accès à tel ou tel type d’intervention afin de s’assurer de son
efficacité, et que le coût de certains actes diminue au fil du temps. Dans un premier temps, les
nouveaux traitements (la transplantation de tissus osseux en est un bon exemple) ont tendance à
coûter très cher et à n’être accessibles qu’à un nombre extrêmement limité d’individus. Lorsque
la transplantation de moelle osseuse est devenue une opération courante, pratiquée par un plus
grand nombre de centres de soins, son coût a baissé et de plus nombreux malades ont pu en
bénéficier. Il en est de même des thérapies actuellement au stade expérimental (thérapie
cellulaire, thérapie génique ou traitements faisant appel à des produits biopharmaceutiques
coûteux). Leur introduction à très petite échelle et à un prix très élevé se justifie dans la mesure
où l’on compte qu’une fois bien maîtrisées, elles se répandront et coûteront moins cher.

4
La revendication 3 met en avant la discrimination dont sont victimes les personnes
vulnérables du fait de la réticence à les prendre comme sujets de recherche. Son sens est
quelque peu différent. L’un des objectifs de la bioéthique a été de limiter le recours à des
personnes incapables de donner leur consentement. Ces restrictions ont été adoptées à la
lumière des leçons du passé : les pires abus dans l’histoire de la recherche médicale ont
toujours été commis à l’encontre des groupes vulnérables. N’avons-nous pas cependant poussé
trop loin l’interdiction de faire appel à eux pour des essais cliniques à visée thérapeutique ?
Si l’on peut considérer la possibilité de participer à des recherches médicales, avant
que les résultats en soient connus, comme un avantage - proposition qui ne fait pas l’unanimité
et que certains membres du CIB rejetteraient - il semble cruel de refuser catégoriquement cet
avantage à des personnes vulnérables telles que les enfants ou les malades mentaux. C’est ce
à quoi l’on aboutit en les jugeant inaptes à se prêter à quelque expérience que ce soit, même
quand les bénéfices semblent largement compenser les risques.
L’accès à un traitement expérimental d’une personne capable de consentir dépend
dans la plupart des cas d’un certain nombre de variables : les médecins qui la soignent, le lieu
où elle vit, son initiative et le simple hasard. Aux Etats-Unis d’Amérique, des efforts sont
faits pour divulguer les essais cliniques de traitements du Sida et d’un nombre croissant
d’autres maladies, de façon que les malades puissent se renseigner sur les études cliniques
existantes, par exemple en consultant Internet. Un projet de loi proposant la création d’un
registre a été présenté au Congrès. Si cette tendance se confirme, elle pourrait donner corps à
l’idée que chacun a le droit de bénéficier des traitements expérimentaux, ou du moins de se
faire inscrire sur une liste d’attente. A l’heure actuelle, les bénéficiaires de tels traitements
sont sélectionnés de manière plus ou moins aléatoire au sein des groupes que les chercheurs
considèrent comme représentants des sujets potentiels. Si les chercheurs décidaient
expressément d’exclure des groupes tels que les enfants ou les malades mentaux (ou encore
les femmes en âge de procréer), on pourrait véritablement parler de discrimination. Il n’y a pas
exclusion quand c’est le hasard qui décide.
Pour l’heure, les personnes incapables de consentir sont exclues des recherches
cliniques en vertu de règles qui interdisent à leurs tuteurs de les y faire participer lorsque ces
recherches peuvent être faites sur des personnes capables de donner leur consentement. De
plus, dès qu’il s’agit de personnes frappées d’incapacité de consentir, il faut prendre en
compte des notions complexes telles que celle de « risque minimal », etc.
Lorsque de telles personnes, ou leurs représentants, se plaignent d’une discrimination,
c’est par référence au double principe de la justice et de la bienfaisance. Pourquoi une personne
atteinte d’un trouble mental lié au Sida serait-elle empêchée d’essayer tel médicament qui
pourrait sauver sa vue ? Dès lors que d’autres volontaires « normaux » jugent que tel
traitement, tout bien pesé, mérite d’être tenté, pourquoi des parents ne pourraient-ils pas
postuler au nom de leur enfant ? L’importance que l’on accorde à ce problème varie nettement
selon que l’on estime réalistes les espoirs placés dans la recherche. Or les règles actuelles
partent semble-t-il du principe que les risques que fait courir un essai clinique sont dans la
plupart des cas plus grands que les possibles bénéfices thérapeutiques.
Les IEG prônent une position minimale, à savoir que si l’on permet un large recours à
des thérapies expérimentales mais prometteuses, dans le cadre de l’autorisation sous certaines
conditions de médicaments encore en cours d’expérimentation (programme « treatment IND »
de la Food and Drug Administration, FDA) ou de la distribution de tels médicaments en
« circuit parallèle », alors les malades mentaux doivent y avoir eux aussi accès. Mais le
commentaire est défavorable à la participation d’individus vulnérables à des « essais cliniques
formels ». Il ne défend ni cette participation ni la proposition voisine qui voudrait que les
individus vulnérables ne participent qu’à des recherches liées aux causes de leur incapacité.
On pourrait penser, toutefois, que la participation aux mêmes essais de personnes capables de
consentir offre quelque assurance que les personnes vulnérables ne sont pas exploitées.
Le débat sur la « bienfaisance » [beneficence] consiste à se demander si les mesures
visant à protéger les personnes incapables de donner leur consentement ne rendent pas
impossible toute recherche sur leurs troubles. A l’évidence, la réponse varie selon les
catégories de malades se trouvant dans cette incapacité. Du fait du vieillissement croissant de
la population, nous allons voir augmenter le nombre d’individus atteints de diverses formes de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%