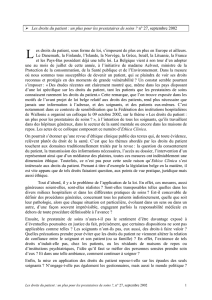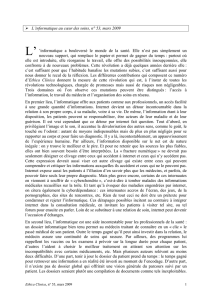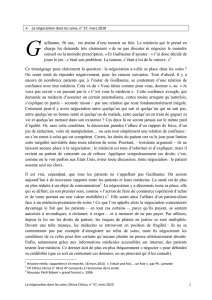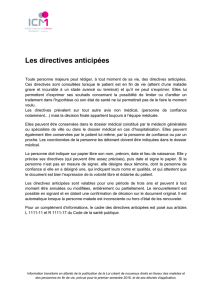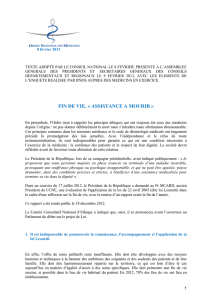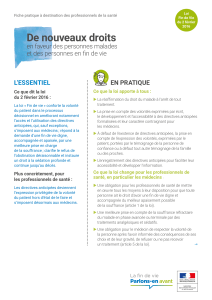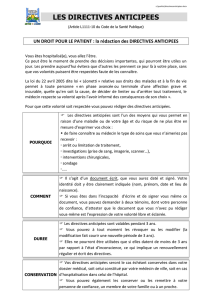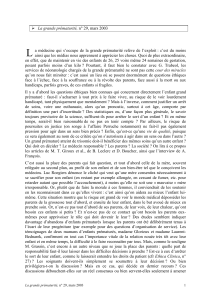Le juste temps des soins

EthicaClinica,n°84–Décembre2016 1
Lejustetempsdessoins
Peut‐onmesurerletempsqu’ilconvient,humainement,depasserauprèsd’unpatient?Qui
ditmesure,ditrègledemesure.Aujourd’hui,onadeplusenplusl’impressionqueletempoestdicté
soitparlatechnique,soitparl’économique.Larègletechniqueréduitlamaladieàunepathologie
objective,nécessitantuneinterventionstandardiséequel’onveutlaplusbrèvepossible.Si,
techniquement,ilestpossibled’opérerenhôpitaldejour,alorsc’estcettedurée‐làquiferaloi.La
règleéconomique,quiestsouventassociéeàlapremière,sebasesurleseuilderentabilité:étant
donnélesmoyensfinanciersdisponibles,onétablitlenombredeconsultationsparjour,ouletaux
d’occupationdessallesd’opération,ouencore,onfixelenombredetoilettesqu’uneinfirmièreou
qu’uneaide‐soignantedoiventaccomplirparheure.Onorganiseletravail(lesdéplacements,
l’ergonomie,etc.)afindegagneruneminuteici,uneautrelà‐bas…Ondéterminedesduréesde
séjourenfonctiondecellesquisontfinancées.Aprésenterleschosesainsi,oncomprendmieuxque
laquestiondel’organisationdutempsestunequestionéminemmentéthique.Car,considérées
seules,cesrèglesdemesurenetiennentaucunementcomptedelapersonne,qu’ils’agissedu
patientouduprestatairedesoins.
Sil’onréintroduitceparamètrehumaindanslamesuredutempsadéquat,sidonccesontles
personnesquideviennentlarègledemesure,toutsecomplique.Cariln’yaplusdestandardisation
possible.Ondevraserésoudreàconstatereneffetqueletempsjustedevientceluiqu’ilfaut,en
fonctiondelarelation,c’est‐à‐dire,enfonctiondespersonnesenprésence:tempscourtpourl’un,
tempslongpourl’autremalgréunepathologiesimilaire,nécessitantlamêmeopération,etles
mêmessoins.Larègle,ici,n’estpluscelled’unstandardfixéunefoispourtoute,etuniversaliséeà
l’ensembledesprestationsdesoinsdumêmegenre.Larègledevientcelle,beaucoupplus
inconfortable,dujustemilieuenfonctiondelasituation,cequimobilisenotrecapacitéàdélibérer
pourjugeraucasparcas.
Letempsadéquatseraitdoncunjustemilieuentredeuxextrêmes:l’unpardéfaut,àsavoir
troppeudetemps;l’autreparexcès,àsavoirtropdetemps.Passertroppeudetemps,c’estfaire
violenceaupatientennerencontrantpassesbesoins.Parexemple,onrestesidéréd’apprendre,de
labouchedecertainsmédecinshospitaliersmaisaussidemédecinsgénéralistes,quevuleur
planningsurchargédeconsultations,ilsn’ontplusmatériellementletempsd’informercorrectement
lespatientsetdes’assurerdeleurcompréhensionetdeleurconsentement.Certainshôpitaux
tententdecontournercettedifficultéenorganisantdesséancesd’informationscollectivesàheure
fixe.C’estmieuxquerien,maislepatientyperdendiscrétion,enconfidentialitéetenrelation
personnalisée.Ceuxquisontmalàl’aisedevantun«public»n’oserontpasposerleursquestions,
etc.Surtout,cettemesureempêchedeseposerlesbonnesquestions:est‐ilnormalqu’unmédecin
voitdesmaladesàlachainesansplusavoirletempsd’unéchangetoutsimplementhumaineten
redoutantlepatientquiluiposeraittropdequestions?Autredramedestempstropcourts:le
retouraudomicilequi,lorsqu’ilestcompliqué(familledéfaillante,logementinsalubre,solitude,
fragilitédelapersonne,servicesàdomicilesurchargés,listed’attenteenmaisonderepos,…)
malmènelepatientetlaisseungoûtameràl’assistantsocial.Etaussiauxsoignants:uneéquipede
soinspalliatifsrapportaitrécemmentsondésarroifaceàcespatientsaccueillisdansleurservicepour
uneduréelégaled’unmois,etqui,voyantl’échéanceapprocher,préféraientintroduireune
demanded’euthanasie(ilsremplissaientparailleurslesconditions)plutôtquederentrerchezeuxou
enmaisonderepos.

EthicaClinica,n°84–Décembre2016 2
Lestempstroplongsfontautrementviolence.Cesontd’abordlespatientssuivantsquien
fontlesfrais:passertropdetempsavecl’unsefaitpotentiellementaudétrimentdesautresquien
auraientpeut‐êtrebesoin.Ilyaiciunequestiondejusticedistributive:ilnesuffitpasdedonnertout
letempsdontondisposeaupatientactuel,maisdedonneràchaquepatientletempsqu’ilconvient.
Lapremièrecondition,onl’asuggérée,estdenepassurchargersonagenda.L’autrecondition–qui
devientenvisageablesilapremièreestremplie–estderesterjusteavectous.Maisc’estaussile
soignantoulemédecinquirisqued’êtrevictimedeseslargesses:carilpeuts’éterniserauprèsde
sespatientsaudétrimentdesavieprivée,oudesapropresanté.Iln’yapasdehonteàpenseraussi
àsoi,etàseprotéger…précisémentpourresterdisponiblepourchaquepatient.Enfin,s’ilfautsavoir
mettreuntermeàunerelation,c’estaussidanslebutdenepasinstaurerdedépendancemalsaine,
parcequ’injustifiée,entrelepatientetsonprestatairedesoins.
Donneràchacunletempsquiluiconvient,c’estdoncfairedusur‐mesure,etnonduprêt‐à‐
porter:c’ests’adapter,donnerplusàl’un,moinsàl’autre,maisdetellesortequechacunaitles
soinsdontilaréellementbesoin.C’estdoncsortirdesnormesstrictementobjectives,desstandards
imposés,pourretrouverl’exigence,certesinconfortable,del’ajustementetdelaréflexion.Ce
rapportsoupleautempsnes’opposenullementauxprogrèstechniquesquirendentlesinterventions
moinsinvasivesetmoinslongues:simplement,iln’enfaitpluslaseulemesuredutempsdusoin…
puisquesoignerdébordeletempsdelatechnique.Parcontre,lejustetempsinterrogelamesure
économique:lefinancementàl’acteencouragelamultiplicationdesinterventions–etparmielles,
lesplusrentables–delapartdessoignantsetdesinstitutionsdesoins.D’oùuntempsdeplusen
pluscompressé,quiépuise,tôtoutard,lesprofessionnelseux‐mêmes.Faut‐ilalorsencouragerun
financementauforfait,quial’avantagedecouvrirtouteslesdimensionsdusoins,etpasseulement
lesactesdits«techniques»?Onlevoit,aborderlaquestiondutemps,c’estapprocherdes
questionsquifâchent…
Onretrouvelemêmedébat,etlesmêmesenjeux,àuntoutautreniveau:lesdirectives
anticipéesdesoinsfigentletemps.Commeleditledicton,lesparoless’envolent,lesécritsrestent.
Maisleproblèmeestconnu:avecletemps,l’êtrehumainchange.Nuln’yéchappe.Dèslors,
comments’assurer,lorsquelepatientn’apluslacapacitédeparler,quecequ’ilarédigévoicideux
semainesoudixansrestevalablepourlui,etque,àprésentconfrontéàcequ’ilredoutait,illevittel
qu’ill’avaitimaginé?Denouveau,ilfautdéfendrel’attitudeéthiquedujustemilieu:nepastenir
comptedecesdirectivesestunexcès(pardéfaut)indéfendable,carellescontiennentdeprécieuses
informationssurcequefutàunmomentdonnélepatient.Maisconsidérercesdirectivescommedes
ordresàrespecteraveuglément,c’esttomberdansunautreexcès,quiconsisteànepastenir
comptedel’instantprésent.Nierlepassédupatientesttoutaussiinacceptablequedel’enfermer
définitivementdanssonpassé.Lejustemilieuconsisteàpréserverledevoirdessoignantsd’évaluer
lesdirectivesanticipéesdesoinsàlalumièredelasituationprésente,detellemanièrequ’ilnesoit
pasexcluqu’onn’exécuterapascequifutdemandé,sidumoinsl’intérêtactueldupatientyinvite.
Letemps,c’estlavie,c’estlechangement,c’estl’imprévisible.Ilfautselerappelerchaque
jourpourempêcherquelamédecinenesoitplusqu’unesciencedecadavres.
Jean‐MichelLongneaux
1
/
2
100%