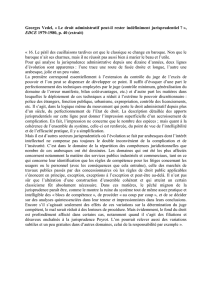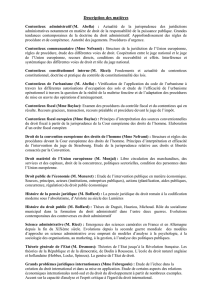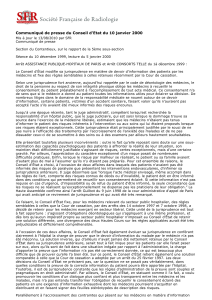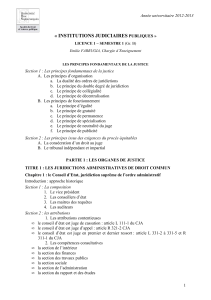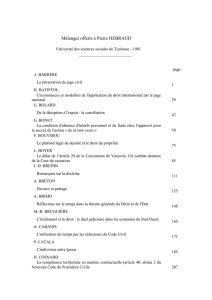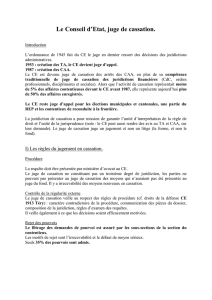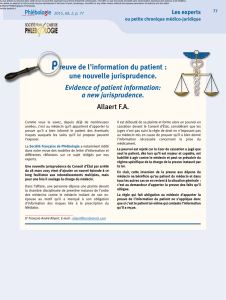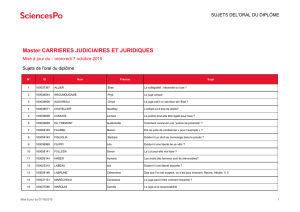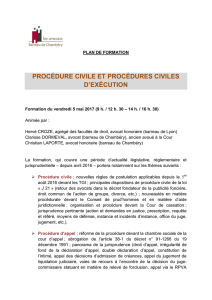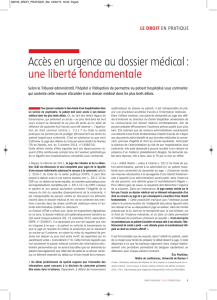Ce document est également disponible au

La politique de la Cour de cassation en matière internationale :
économie de la justice et droit international privé
***
Par Horatia Muir-Watt
Professeur à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
***
1. En elle-même, la notion d’économie de la justice n’appelle pas d’explications
approfondies, qui seraient redondantes en ces lieux et déplacées de ma part. Pour reprendre
les termes de Loïc Cadiet1, elle implique une analyse de la rentabilité interne de l'institution
judiciaire, qui inclut par exemple celle du rapport coût-avantages de la régulation judiciaire
par rapport aux modes alternatifs de règlement des litiges. Elle traduit très clairement un souci
d'intendance et emprunte un vocabulaire managérial. De façon souvent péjorative, on relève
que le justiciable devient "un client" et l'institution judiciaire "un fournisseur ». En France, on
n’aime pas parler de la justice en termes de rentabilité ou de coût. Et il est vrai que sous sa
forme actuelle, le débat trouve son origine aux Etats-Unis dans le sillage de l’analyse
économique du droit en général, qui tentait de répondre au problème de la surcharge des
juridictions fédérales, elle-même directement corrélée à l’accroissement de l’activité
législative - et donc du contentieux - dans les années 1970. Posner s’attaque au problème du
coût de la justice et lance un débat important sur le service judiciaire comme bien public ou
privé.
2. Cette dernière distinction va revêtir une importance considérable pour la suite, je vais donc
m’y arrêter quelques instants. Quand les économistes définissent ces deux catégories jumelles,
ils nous donnent en fait des éléments de régime. A l’inverse du bien privé, le bien public se
caractérise par un double principe de non-rivalité et de non-exclusion. Le phare en est
l’exemple…phare. Son éclairage profite à un nombre infini de bateaux, sans que la
consommation de lumière par l’un empêche les autres d’en profiter. De même, aucun ne peut
payer un prix pour en exclure les autres : il n’y pas de marché. Si on essaie de cerner la
substance des deux catégories, on retrouve plutôt l’idée, plus familière aux juristes, que le
bien public est celui qui représente un intérêt pour la communauté, tel qu’elle lui consacrera
des ressources publiques. La justice, éclairant tous les justiciables sans rivalité et sans
1 Editorial du numéro 2 de l'année 1999 de la Revue internationale de droit économique.
1

exclusion n’est-elle pas par excellence un bien public ? En insinuant le doute sur ce point, le
sens de la question de Posner est de savoir si on peut rechercher les solutions à la crise
d’encombrement des tribunaux en appliquant au service public judiciaire un modèle
économique de marché.
3. Pour Posner, l’équation de l’économie de la justice signifie que l’augmentation des flux
d’affaires oblige à réduire la qualité de la justice ou à allonger les délais, sachant qu’il y un
facteur plus ou moins invariable (le nombre de juges et la structure du système judiciaire).
Pour maintenir une qualité égale, il faut selon Posner endiguer radicalement le nombre de
dossiers à traiter. La méthode à utiliser est recherchée dans le mimétisme du marché privé,
dont le jeu aboutirait à une régulation spontanée du prix du service sur son coût réel. Or,
actuellement, le coût ou le prix de l’accès (access fees) est substantiellement en dessous de ce
que coûte chaque litige pour les finances fédérales. [Ce constat peut surprendre, au vu de
l’importante jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême posant les limites de la
compatibilité des access fees avec les exigences du due process, qui peut suggérer que les fees
sont souvent dissuasifs. Mais il ne faut pas oublier qu’une partie importante de ce coût est lié
à la présence d’un jury en matière civile, à l’oralité de la procédure, etc]. Il s’ensuit que les
contribuables pacifiques sont en train de subventionner les citoyens procéduriers. La solution
selon Posner consisterait à mettre à la charge de chaque usager (= chaque plaideur) une taxe
sensiblement augmentée.
4. Bien entendu, comme on l’imagine, cette proposition n’a pas été reçue sans polémique, qui
s’engage alors sur les implications de due process ou de justice substantielle de la limitation
d’accès aux tribunaux qui résulterait de l’augmentation du prix d’entrée. Surtout, objecte-t-on,
ce que paie le contribuable non-litigant est l’effet normatif de la jurisprudence, qui encadre sa
vie quotidienne, voire même, qui est garante de sa liberté individuelle. La justice judiciaire
est, à cet égard, incontestablement un bien public, qui sert l’intérêt général et doit être mis à la
disposition de tous, fût-elle consacrée le cas échéant au règlement des intérêts particuliers et
fût-elle déclenchée à l’initiative de tel plaideur mauvais coucheur2. Le débat révèle alors
clairement à quel point la façon dont on aborde les questions d’économie de la justice est
tributaire de la conception que l’on peut avoir de la fonction judiciaire elle-même. On ne peut
2 Cette affirmation n’est pas nécessairement évidente dans une culture transactionnelle, où le déploiement initial
des ressources judiciaires a essentiellement pour fonction de permettre aux parties de mesurer leurs forces
respectives en vue du settlement (« bargaining in the shadow of the law »).
2

pas instituer le prix d’entrée en régulateur exclusif d’accès à la justice si on veut encourager le
contentieux d’intérêt public (public interest litigation) et la protection judiciaire des droits
fondamentaux de la personne. L’adhésion de Posner au modèle privé ou semi-privé s’explique
par le fait qu’il est hostile, en pur libéral, à l’égard de l’activisme des juges sur le fondement
notamment d’une lecture sociale de la Constitution fédérale3.
5. De ce côté-ci de l’Atlantique, le débat ainsi lancé sur le coût de la justice et
l’encombrement des juridictions s’engage plutôt sur trois terrains un peu différents. D’abord
on étudie les possibilités (je cite le premier président Coulon) qu’offre la « régulation du
temps judiciaire »4, appelé à s’ajuster mutuellement aux exigences du « temps économique »
dans le déroulement de la procédure. La formule élégante rappelle les réformes pragmatiques
de management judiciaire de Lord Woolf en Angleterre, qui encouragent la voie d’une
maîtrise négociée de la procédure entre les parties et le juge, et le développement de la
médiation judiciaire. Ensuite, on se demande si et comment la considération du coût du
fonctionnement de la justice peut légitimement faire l’objet d’un motif du juge dans une
décision individuelle. La question est également au centre du débat en France sur la gestion
dans le temps des revirements de jurisprudence. La difficulté tient au fait qu’un tel
raisonnement est nécessairement d’ordre global, conséquentialiste et donc peu compatible
avec la méthodologie déductiviste de la décision individuelle. Enfin, et de façon très
importante, dans une culture où l’accès le plus large à la justice est un droit fondamental, on
souligne alors, avec Marie-Anne Frison-Roche, que la légitimité de l'analyse économique de
la justice dépend étroitement de la matière litigieuse5. Elle est plus indiscutable lorsque l'objet
de l'intervention judiciaire est un intérêt purement patrimonial ou participe d'une régulation
3 La discussion engendrée par les travaux de Posner a engendré un foisonnement de thématiques connexes. Dans
la fonction managériale de la justice, le juge se comporte-t-il comme homo economicus ? « Que maximisent les
juges » ? Comme toujours, il faut tenir compte du contexte particulier dans lequel prend place ce débat, où la
sélection des juges se fait selon des critères idéologiques, où le juge judiciaire exerce une fonction
constitutionnelle, et où le fédéralisme pèse lourdement dans le débat. Mon propose n’est pas du tout d’entrer
dans cette problématique, qui est d’ailleurs foncièrement un débat de juges. Il est notable d’ailleurs qu’aux USA,
les protagonistes essentiels ont été, au moins dans un premier temps, Posner et Weinstein, tous deux juges
fédéraux. Une étude tout récente et très polémique intitulée, selon un excellent jeu de mots « Courting
failure » (Lynn LoPucki), suggère que certaines juridictions spécialisées comme les juges de la faillite,
s’engagent dans une véritable course vers le bas dans une compétition destinée à s’attraire des dossiers sensibles
pour des raisons électorales. Le débat dans le contexte fédéral n’est pas sans rappeler la polémique suscitée par
l’affaire Eurofood dans l’espace judiciare européen...
4 J-M. Coulon, Revue internationale de droit économique 1999.
5 M-A. Frison-Roche, ibid.
3

d'ensemble de l'activité économique, comme en matière de concurrence, que lorsque le juge
est requis de trancher des questions relevant du contentieux civil des personnes.
6. Or, ce qui me paraît très intéressant, c’est que ce même clivage est devenu fondateur dans
le droit international privé contemporain, qui tend à devenir méthodologiquement
axiologiquement et procéduralement bipolaire. Ainsi, sur le fond, et souvent sous l’impulsion
du droit conventionnel et communautaire, il traduit désormais, tant en matière de conflit de
lois que de juridictions, une profonde différentiation de solutions et de méthodes, qui tendent
désormais à s’agencer autour de deux pôles dont l’un constitue la volonté individuelle, l’autre
diverses voies d’expression néo-statutaire de l’impérativité (lois de police, compétences
exclusives, théorie des droits acquis ou des droits fondamentaux). Or, la ligne de partage ne
sépare plus, comme dans le temps, la matière contractuelle et les autres, mais a un tracé
transversal en fonction de la nature des intérêts en cause : ceux qui engagent des valeurs
protégées et les autres. Enfin, sur le terrain de la procédure et plus particulièrement de l’office
du juge en matière de loi étrangère, le Rapport de la Cour de cassation de 1993, contenant une
étude très importante des présidents Lemontey et Rémery6, marque très clairement
l’apparition d’une politique fondée sur la distinction entre droits litigieux
disponibles/indisponibles, et signale on ne peut plus clairement l’entrée de considérations
d’économie de la justice dans la gestion du contentieux international d’intérêt privé.
7. Cette mise en relation de l’économie de la justice et du droit international privé ne doit pas
surprendre, dès lors du moins que celui-ci est perçu comme une forme de régulation d’accès
de l’extranéité devant les tribunaux, tant de normes étrangères que de litiges dont ils ne sont
pas nécessairement le for naturel ou exclusif. En droit interne, la clientèle des justiciables est
captive et les normes applicables connues d’avance. En matière internationale, la clientèle est
mobile en tant qu’elle dispose d’une importante marge de choix de son juge, et le droit
applicable est aléatoire tant en raison des complexités inhérentes au conflit de lois qu’en vertu
là encore du rôle concédée à la volonté des justiciables à l’occasion même du procès. Dans
une perspective d’économie de la justice, qui oblige à introduire la considération des
ressources publiques, se pose la double question de savoir comment le droit international
privé régule les flux des plaideurs venus d’ailleurs, et quelles ressources judiciaires doivent
être consacrées à la recherche et à la mise en oeuvre de normes étrangères, dont les retombées
6 J. Lemontey et J-P. Rémery, « La loi étrangère dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation »,
Rapport, 1993, p85).
4

bénéfiques pour la communauté locale, sous la forme de création normative, ne sont pas
immédiatement saisissables. Le débat oppose à nouveau ceux qui voient dans le contentieux
un bien public, légitimant la disponibilité inconditionnelle de ressources publiques dans
l’intérêt de la collectivité, à ceux qui voient « adjudication as a private good » (Posner),
justiciable dans une certaine mesure d’une logique marchande7. A la sacralisation du droit
d’accès au juge on oppose le risque d’instrumentalisation du service public de la justice par
les acteurs privés, s’en servant à des fins stratégiques sans utilité réelle pour la communauté.
La justice de droit international privé est-elle donc indiscutablement un bien public ? Notons
que les termes dans lesquels, outre-Atlantique, les juridictions fédérales américaines abordent
cette question sont très crûs : la doctrine du forum non conveniens part d’une présomption
contre l’exercice de compétence nationale au profit des demandeurs étrangers, pour des
raisons de finances publiques.
8. Il ne s’agit absolument pas d’approuver cette orientation - qui ne correspond d’ailleurs en
aucune façon à celle de la Cour de cassation - mais seulement d’attirer l’attention sur le
foisonnement de questions auquel conduit la prise de conscience tant du coût du contentieux
international pour le contribuable que de la capacité d’accueil limité des tribunaux face à
l’extranéité des litiges8. Au delà du problème, que je viens d’évoquer, de la mesure dans
7 Une étude doctorale récente (Ilona Nurmela, ph D Cambridge, 2006) consacrée aux exigences d’économie de
la justice dans le contentieux international recherche le moyen de désencombrer les tribunaux d’un certain
nombre de contentieux internationaux B2B, qui tendent à gaspiller les ressources publiques sur de purs litiges
d’ « ajustement », par opposition à ceux qui portent sur des points juridiques sérieux et contribuent ainsi
effectivement à l’évolution du droit. Les premiers, pense l’auteur, doivent être canalisés si possible vers des
mécanismes privés de règlement des litiges, améliorant ainsi l’efficience économique (le coût pour le budget
public et d’ailleurs pour les parties elles-mêmes) et processuelle (réduction de la charge des tribunaux). La
proposition, qui n’ignore pas la difficulté de dessiner la ligne de partage, consiste à introduire une norme de
gestion judiciaire, qui comporterait entre pour le juge le devoir d’inciter les parties en début de procédure à
procéder à une étude prospective et contradictoire des coûts du procès, et à les inviter le cas échéant à se tourner
vers d’autres modes de règlement dès lors qu’il lui paraît que le coût global en est disproportionné ou le litige de
pur ajustement. A défaut, il mettrait en œuvre une procédure allégée dite fast track.
8 Ces questions donnent une idée de l’angle sous lequel j’ai voulu aborder la question de la politique de la Cour
de cassation en matière de droit international privé. Le thème est un sous-ensemble d’un sujet plus vaste qui est
celui de l’analyse économique du droit international privé. En éliminant ce qui n’en relève pas spécifiquement,
on pourra cerner le sujet de plus près.
*Je vais m’intéresser au coût du contentieux international mais pas au coût du droit international en général, ou
plutôt, pas aux mauvaises règles de droit international privé comme facteur de coût. La jurisprudence récente en
fournit un exemple notoire qui est celui de la loi applicable aux sûretés réelles prise sur des meubles (et des
créances) situés à l’étranger. La solution du conflit de lois en cas de déplacement du bien vers la France revient à
neutraliser la sûreté et est clairement un facteur de coût dissuasif des investissements financiers etc. En
modifiant la solution actuellement pratiquée, notamment en appliquant la loi de la source (au lieu de la loi de
situation), on aboutirait à un allégement des coûts de transaction. La voie semble ouverte d’ailleurs indirectement
par l’ordonnance de 2006, dans la mesure où l’hostilité ancienne à l’égard des sûretés étrangères était liée à la
crainte qu’inspiraient les gages sans dépossession. La question est très intéressante, mais elle touche au coût des
transactions davantage qu’au coût de la justice.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%