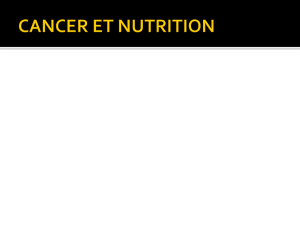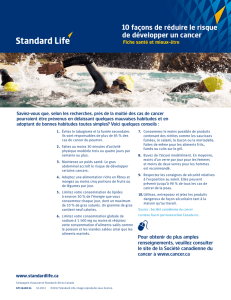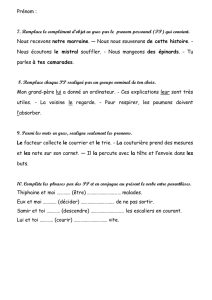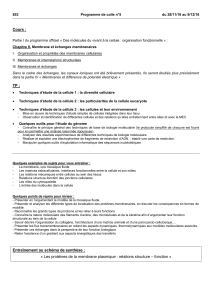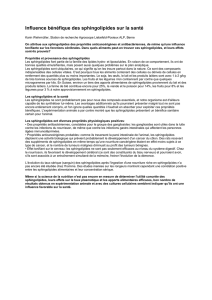Les hétérolipides ou lipides complexe

LES HETEROLIPIDES OU LIPIDES COMPLEXES
Ils renferment en plus des éléments C, H, O du phosphore (P), de l'azote (N) ou du soufre (S).
Ils sont formés d'un alcool qui fixe un acide gras et/ou d'autres composés. On peut les classer en
fonction de l'alcool utilisé :
- soit le glycérol: ce sont des glycérolipides complexes, qui regroupent:
- les glycérophospholipides (P)
- les glycéroglycolipides(sucres),
- soit une base sphingoïde = un alcool aminé à longue chaîne: ce sont les sphingolipides.
1. GLYCEROPHOSPHQLIPIDES (ou PHOSPHOGLYCÉRIDES)
On les appelle aussi les phosphatides, et ce sont les représentants les plus nombreux des lipides
complexes. On les trouve en forte concentration dans les membranes biologiques.
1.1. Acides phosphatidiques
Ce sont des esters phosphoriques de diglycérides.
Le glycérol est donc estérifîé par 2 AG et par l'acide phosphorique: 3 liaisons esters dont une
phophoester.
En général, les AG ont entre 16 et 18 atomes de C. Souvent l'un des AG est insaturé et il est en position
C2.
L'acide phosphorique n'a qu'une de ses acidités engagée, donc la molécule a un caractère acide.
Ils existent rarement à l'état libre, et jouent un rôle important dans la biosynthèse des
glycérophospholipides.
1.2. Glycérophospholipides dérivés des acides phosphatidiques
Le résidu phosphate a deux fonctions acides libres. Une des ces deux fonctions peut être estérifiée par
un nouvel alcool.
1.2.1. Glycérophosphoaminolipides (ou glycérophosphatides azotés ou phosphoglycérides
azotés).
X = serine --> Phosphatidyl-sérines.
X = éthanolamine --> Phosphatidyl-éthanolamines (autrefois faisant partie des céphalines).
X = choline --> Phosphatidyl-cholines (autrefois faisant partie des lécithines)
Sérine Ethanolamine Choline

- Les céphalines sont présentes dans tous les tissus animaux et beaucoup de végétaux. Elles sont
abondantes dans le cerveau (d'où leur nom).
- Les lécithines sont un des constituants du jaune d'œuf (acide oléique en 2, acide stéarique en 3), mais
aussi des cellules du foie, du rein, des muscles et du tissu nerveux.
Le groupement NH2 est plus basique que celui des céphalines.
1.2.2. Glycérophospholipides non azotés (ou glycérophosphatides non azotés ou
phosphoglycérides non azotés)
X = glycérol --> phosphatidyl-glycérols, abondants chez certains microorganismes et
les plantes
X = inositol --> phosphatidyl-inositols (inositides)
L'inositol est un polyalcool cyclique; le C1 est engagé dans la liaison phosphoester avec l'acide
phophatidique. Les phosphatidyl-insitols sont présents dans les membranes plasmiques et
mitochondriales, le plus souvent sous forme biphosphate: les C4 et C5 sont phosphatés pour donner le
phosphatidyl-inositol-4,5 diphosphate qui, suite à son hydrolyse enzymatique, libère du diacylglycérol
(DAG) et de l'inositol 1,4,5-triphosphate (IP3). Ces 2 molécules sont des seconds messagers = elles
interviennent dans la transduction des signaux d'activation intracellulaires suite à la stimulation d'une
cellule par une hormone par exemple.
1.3. Glycérophospholipides particuliers: les dérivés éther-oxydes
L'une des chaînes carbonées (de façon générale celle du C1) est liée au glycérol non pas par une
liaison ester mais par une liaison éther C-O-C. Ils sont des dérivés d'alcool gras. Les plus importants
sont:
- les plasmalogènes sont des dérivés alkényl-éthers, c'est-à-dire formés avec un alcool gras vynilique:
CH=CH-OH. Le 2ème alcool est en général l'éthanolamine. Ils sont présents dans le système nerveux et
le muscle cardiaque, ainsi que dans les macrophages et les cellules de la glande thyroïde.
Ils auraient pour rôle de stabiliser les membranes et de les protéger du stress oxydatif. Ces fixations sur
la double liaison conduisent à la rupture de la molécule avec production d'aldéhydes qui pourraient être
des régulateurs de l'activité cellulaire.
- le PAF ou PAF-acéther («platelet activating factor »):
Sa structure comprend:
- un alcool gras lié par une liaison éther en C1 ( donc dérivé alkyl-éther),
- un radical acétyl en C2. Ce groupe (10 fois + court que les chaînes d'acides gras) rend la molécule
beaucoup plus hydrosoluble que les autres glycérophospholipides et les plasmalogènes.
C'est un médiateur produit par les leucocytes pour activer les plaquettes sanguines et stimuler leur
agrégation il joue un rôle important dans le phénomène de coagulation sanguine. Sa diffusion dans le
plasma est liée à son caractère hydrophile.

1.4. Propriétés et rôles des glycérophospholipides
1.4.1. Molécules amohiphiles (structure bipolaire)
Les molécules de glycérophospholipides ont deux parties: l'une apolaire (correspondant aux acides
gras) = "queue" hydrophobe, l'autre polaire (groupement phosphorique, glycérol, alcool azoté ou non) =
"tête" hydrophile.
Par conséquent, en milieu aqueux, ces molécules ont tendance à associer leur zone hydrophobe entre
elles et à présenter au milieu aqueux leur zone polaire; elles forment des monocouches donnant des
micelles (vésicules formées par une monocouche délimitant un compartiment interne), ou des
bicouches,qui peuvent donner des liposomes (vésicules formées par une bicouche délimitant un
compartiment interne).
Les glycérophospholipides, en association avec d'autres molécules amphiphiles comme les glycolipides,
la sphingomyéline, le cholestérol... ont ainsi tendance à former la double couche très stable des
membranes biologiques (liaisons hydrophobes, liaisons électrostatiques). Ces bicouches lipidiques
présentent une certaine fluidité. Chaque couche se déplace par rapport à l'autre:
Différents mouvements possibles
pour les molécules de
glycérophospholipides
dans les membranes cellulaires
Cette structure amphiphile est celle des agents qui abaissent la tension de la surface de l'eau
(détergents, tensio-actifs).
Dans les poumons des vertébrés, les alvéoles sont tapissées d'un film lipoprotéique permettant d'éviter
leur collapsus: le surfactant. Il contient 10% de protéines et 90% de phospholipides, dont plus de la
moitié sont des glycérophospholipides (surtout le dipalmitoylphosphatidykcholine, qui, d'ailleurs est
saturé: il résiste bien aux conditions oxydantes de l'air alvéolaire riche en 02).
1.4.2. Hydrolyse des glycérophospholipides
L'hydrolyse de ces lipides est réalisée, in vivo, par des enzymes appelées des phospholipases. Elles
sont spécifiques du site de coupure:

Enzyme origine Site d'action libération
Phospholipase A1 Lysosome, membranes Liaison ester en C1 Acide gras en 1 +
lysophosphatide
Phospholipase A2 Venins de serpents,
abeilles, scorpions
Liaison ester en C2 Acide gras en 2 +
lysophosphatide
Phospholipase C membranes Liaison ester entre acide
phosphorique et glycérol
Alcool phosphorylé +
diglycéride
Phospholipase D végétale Liaison ester entre acide
phosphorique et alcool
azoté ou non
Alcool + acide
phosphatidique
Dans le cas des phospholipases A, on obtient un phospholipide n'ayant plus qu'un seul acide gras =
lysophosphatide (dans le cas d'une lécithine, on a une lysolécithine). Les lysophosphatides sont des
agents tensio-actifs très puissants, capables de provoquer une hémolyse. Ceci peut expliquer en partie
l'action de certains venins.
La phospholipase A2 est impliquée dans la biosynthèse des éicosanoïdes (prostaglandines et
leucotriènes): l'acide gras en position 2 est souvent l'acide arachidonique, qui est le précurseur des
éicosanoïdes (cf +loin).
La phospholipase C est l'enzyme qui génère les DAG et l'IP3 à partir du phosphatidyl-inositol
diphosphate.
2. GLYCEROGLYCOLIPIDES
Comme dans les glycérolipides précédents, les C1 et C2 du glycérol sont estérifiés par des acides gras,
mais sur le C3 un ose ou un oligoside est fixé par son carbone hémiacétalique par une liaison
glycosidique.
Ces glycéroglycolipides sont abondants dans les membranes des plantes (en particulier dans les
membranes des thylacoïdes des chloroplastes), et de certaines bactéries.
Ex: 1,2-diacyl-[β-D-galactosyl-1'-3]-glycérol

3. SPHINGOLIPIDES
3.1. Structure
L'alcool n'est plus du glycérol mais un aminoalcool à longue chaîne: la sphingosine
(18 atomes de C dont 1 C=C + 2 fonctions alcool + 1 fonction aminé)
La fixation sur le groupe aminé d'un acide gras donne une céramide, molécule précurseur de tous les
lipides du groupe: il s'agit d'une liaison amide entre le -COOH de l'acide gras et le -NH2 de la
sphingosine (ce n'est donc plus une liaison ester comme dans les autres lipides).
L'acide gras est principalement l'acide lignocérique (C24H48O2) ou stéarique (C18H36O2).
De plus, le OH terminal (sur le Carbone n°1) de la sphingosine peut être lié à un autre groupement X ,
qui est la phosphocholine ou un ose (ou dérivé d'osé):
- Si X = phosphocholine :
On obtient la sphingomyéline, constituant (avec les lécithines) de la gaine de myéline des fibres
nerveuses et du SNC. C'est un phospholipide représentant 15 à 20 % des phospholipides totaux.
- Si X = ose (hexose : glucose ou galactose) ou dérivé d'osé (hexosamine), on obtient les glycolipides
- un ose --> cérébrosides (cérébroglucosides ou cérébrogalactosides)
- un ose dont le OH en 3 est estérifié par l'acide sulfurique --> sulfatides
présents surtout dans le cerveau et le rein
- plusieurs oses ou hexosamines --> glycolipides neutres. Le 1er ose est le glucose (chez
les Vertébrés). On trouve ensuite fréquemment, le galactose, le mannose, le fucose, la glucosamine et
la galactosamine.
- plusieurs oses ou hexosamines dont l'acide neuraminique --> gangliosides présents
uniquement chez les vertébrés. Les principaux gangliosides des cellules humaines sont regroupés sous
le nom de GM1, GM2, GM3. Le GM1 est le récepteur à la toxine cholérique au niveau des cellules
épithéliales de l'intestin.
Remarque: il existe des glycosyldiglycérides: résultent de la fixation sur la fonction alcool libre d'un 1,2
diglycéride d'une ou plusieurs molécules d'oses (jusqu'à 10), en général le glucose et le galactose. Ils
sont des constituants des membranes plasmiques des bactéries. Ce sont des lipides complexes, mais
n'appartenant ni à la famille des glycérophospholipides (pas de phosphate), ni à celle des
sphingoglycolipides (alcool = glycérol).
 6
6
1
/
6
100%