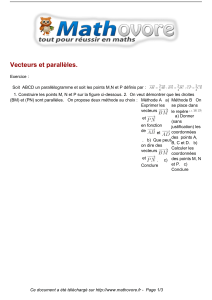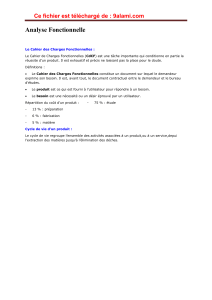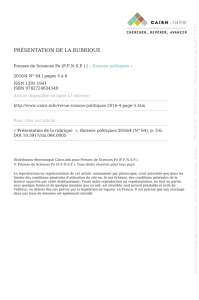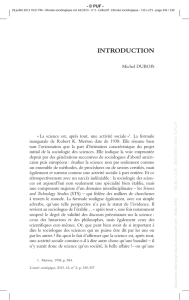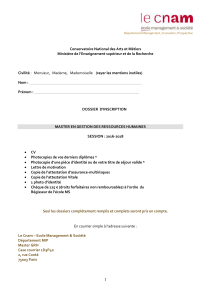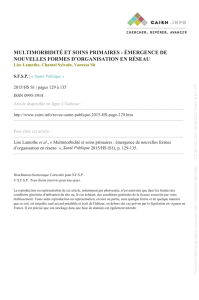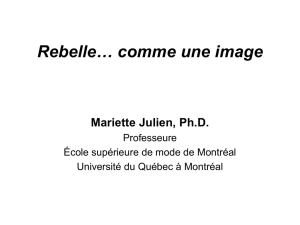vers une nouvelle économie des services publics durables

VERS UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DES SERVICES PUBLICS
DURABLES
Caroline Gauthier et Benoît Meyronin
Management Prospective Ed. | Management & Avenir
2013/1 - N° 59
pages 13 à 34
ISSN 1768-5958
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2013-1-page-13.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gauthier Caroline et Meyronin Benoît, « Vers une nouvelle économie des services publics durables »,
Management & Avenir, 2013/1 N° 59, p. 13-34.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Management Prospective Ed..
© Management Prospective Ed.. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.

13
Vers une nouvelle économie des services
publics durables1
par Caroline Gauthier2 et Benoît Meyronin3
Résumé
Cette contribution vise à analyser, à travers quatre études de cas, la
dimension « développement durable » d’innovations de service prenant
appui sur des formes originales de partenariat public-privé. Ces innovations
présentent la caractéristique de rechercher certaines formes d’équilibres
entre territoires, entre populations ou encore entre modes de déplacement. Il
sembledonclégitimedequestionnerleurcontenu«durable»pouravancer
quelques hypothèses concernant les rapports qu’entretiennent l’économie
des services et le développement durable. Nous avançons alors l’hypothèse
selon laquelle ce contexte partenarial serait particulièrement propice au
développement d’innovations tertiaires durables, que l’implication des
parties prenantes est un facteur clé de succès de l’innovation de service –
et invitons ainsi les décideurs à s’inscrire dans ce type de partenariats pour
développer ces nouveaux services durables.
Abstract
This contribution aims to analyze, through four case studies, the “sustainable
development” dimension of service innovations built on original forms of public-
private partnership. These innovations have the characteristic to seek some
form of balance between territories, between people and between modes of
travel. It therefore seems legitimate to question the content ‘sustainable” to
advance some assumptions about the relationship of the service economy
and sustainable development. We advance the assumption that while this
partnership context would be particularly conducive to the development of
sustainable tertiary innovations, the involvement of stakeholders is a key
success factor of innovation in service – and invite decision makers to
subscribe to such partnerships to develop these new sustainable services.
On peut observer que la coopération en matière d’innovation semble s’engager
vers des formes sans cesse plus «ouvertes» (Chesbrough, 2003) impliquant, de
manièrecroissante,acteurspublicsetprivés,rmesinnovanteset«destinataires-
coproducteurs», ou Lead User dans la terminologie de von Hippel (2005). Une
1.Desversionsantérieuresdecetarticleontfaitl’objetd’unecommunicationlorsduXIVèmecongrèsdel’AIMSsousletitre«Nouveaux
servicespublicsetdéveloppementdurable:Uneanalyseexploratoireàtraversquatreétudesdecas»etd’undépôtdanslescahiers
derecherchesduCERGAM–IAEAixenProvenceen2008sousletitre«Nouveauxservicespublicsetdéveloppementdurable:Une
analyseexploratoire».
3. Be n o î t Me y r o n i n , Grenoble Ecole de Management, Institut ServiCité, Académie du Service, [email protected]
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.

59
14
telle évolution implique, dans les activités de service, la mobilisation de modes
de coordination complexes (Genet et Meyronin, 2007). Dans la mesure où ces
modes de coordination semblent se manifester de manière croissante et sous des
formes souvent inédites, c’est plus particulièrement à des formes d’interactions
public-privé en matière d’innovation de service durable que nous allons nous
intéresser ici, dans une optique exploratoire. La question de recherche traitée ici
est : Quelles sont les dimensions favorisant l’émergence et la performance des
«nouveauxservicespublicsdurables»?
Acteurs publics et entreprises de services mettent en œuvre en effet, sous des
formes diverses, des modalités de coopération conduisant à des innovations
de«servicepublic»ayant,de facto (c’est la raison même de l’implication des
pouvoirs publics), un impact recherché sur les territoires. Cet impact peut être de
nature écologique, marketing (au sens du rayonnement du territoire) et/ou socio-
économique. En d’autres termes, innovations de service et innovations urbaines,
développement durable et marketing des territoires s’entrecroisent aujourd’hui
de façon croissante.
Or, ces innovations viennent bouleverser les pratiques au service d’un
renouvellement des questions de l’espace urbain, de la mobilité… et, pour
ce qui nous concernera ici, du développement durable. Car, parmi toutes les
dimensions qu’elles révèlent, la préoccupation en matière de développement
durable semble bien être présente. A ce niveau, il n’est pas anodin de remarquer
que l’économiste le plus emblématique de la tertiarisation des économies
développées, Jean Fourastié, a pu faire part des préoccupations qui furent les
siennes en matière environnementale à maintes reprises, et ce bien avant que le
terme de développement durable ne fasse son apparition (Chamoux, 2008).
Certes, notre questionnement n’est pas nouveau si l’on considère certains
domaines de l’action publique. L’organisation systémique de la collecte et du
retraitement des déchets ménagers (le dispositif Eco-emballage) témoigne
d’unecertaineavancedelaFrancedanscedomaine,commedel’efcacitédes
partenariats public-privé sous-jacents au service du développement durable
(dans sa composante environnementale). Mais force est de reconnaître que cette
dynamique a connu ces dernières années une accélération et qu’elle adresse
aujourd’hui de larges pans de l’action publique (dans nos cas : les transports,
la solidarité et la vie sociale des quartiers) et, de surcroît, qu’elle implique des
arrangements entre acteurs publics et privés qui empruntent des voies nouvelles,
notamment celles du développement durable.
Démarche
Nousavonsoptépouruneméthodequalitativeandepouvoirrécolterdesdonnées
riches et détaillées (Weinreich, 1996). Le champ du développement durable et de
la RSE demeurant encore exploratoire, nous nous inscrivons ainsi dans le sillage
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.

15
de travaux complémentaires ayant adopté le même parti pris méthodologique
(Asselineau et Cromarias, 2011). Quatre cas ont été sélectionnés, ce qui se
justielorsquel’onchercheàpréciserunenotionthéorique(Eisenhardt,1989):
le – Vélo’v, service de location de vélo en libre-service en zone urbaine, porté
initialement par la société JC Decaux et le Grand Lyon et déployé depuis au
niveau international ;
Autolib’, – service de location de véhicules en libre-service en zone urbaine,
développé dans l’agglomération lyonnaise (et déployé à Paris depuis décembre
2011) ;
les – PIMMS, ou Points information médiation multiservices, lieux de services
proposant une nouvelle forme de proximité et d’intermédiation entre des clients
ayant des difcultés et des entreprises assurant des missions de service
public ;
Le Petit Viscose,– concept d’espace multiservices de proximité pour le
grand public, développé dans la région grenobloise en interaction avec des
municipalités.
Ces cas sont complémentaires du fait de la variété des domaines et des
partenariatsqu’ilscouvrent.Nousavonsretenudescasrhônalpins,(pourdes
motifs de praticité) ayant toutefois un rayonnement national (dispositif reproduit
ou déployé au moins au niveau national). Ils concernent des services à vocation
publique, d’intérêt général, dans des domaines variés : mobilité, services de
proximité et services de médiation, ce qui permet de prendre en compte la
dimension sociale des services. Leur diversité, comme les acteurs qui y sont
engagés(desrmes multinationalestellesqueJ.-C.Decaux,LyonParcAuto-
LPA- et Accor, des dispositifs nationaux tels que les PIMMS, des collectivités
de tailles diverses [le département de l’Isère, les villes de Lyon ou d’Echirolles],
etc.), garantissent une certaine représentativité. De plus, soit les porteurs de
projet et/ou les observateurs du champ médiatique ont explicitement positionné
ces réalisations dans le champ du développement durable (Vélo’v, Autolib’ et
PIMMS), soit nous avons considéré qu’ils pouvaient relever d’une telle démarche
(Petit Viscose), du fait des acteurs engagés et des objectifs poursuivis par la
collectivité.
Nous nous fondons sur une observation directe (visites répétées des sites, recueil
d’informations, etc.), sur la réalisation de 15 entretiens semi-directifs avec les
porteurs (Tableau 1) de ces différents projets (pour chacun, l’entreprise versus la
collectivité), ainsi que sur une revue de la littérature et de la presse économique
et spécialisée (Libération, Les Echos, Grand Lyon magazine, Présences, Acteurs
de l’Economie). Chaque entretien a duré entre 40 minutes et deux heures. Deux
sessions d’entretiens ont été réalisées, l’une entre 2005 et 2008, l’autre en 2012,
ce qui a permis de suivre la dynamique des projets.
Vers une nouvelle économie des services
publics durables
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.

59
16
Personnes
interviewées Vélo’v Autolib’ PIMMS Le Petit Viscose
Partenaire
privé
- Dir. Régional de
J.-C. Decaux
- P. Le Goff,
président de
l’Association des
usagers d’Autolib’
- R. Pouyet, ex-chargé
de développement
(avant 2008)
- R. Bourgeat,
Responsable du
développement à
l’Union des PIMMS
(après 2008)
- Gérante du site
- V. Girod-Roux,
Dir. marketing et
commercial Korus ;
- C. Marcolin,
Fondateur et PDG,
Korus
Partenaire
public
- J. Dumont,
Directeur de la
communication du
Grand Lyon
- E. Arlot, Cabinet
du Président du
Grand Lyon
- C. Richemont,
responsable du
PôleMarketing
Public, Grand Lyon
- F. Gindre, D.G.
Lyon Parc Auto
- C. Giraudon,
Directrice
marketing
- TER Bourgogne
(SNCF)
- J.-P. Farandou,
Président de l’union
nationale des PIMMS
- Renzo Sulli,
Maire d’Echirolles ;
- A. Perfetti,
ex-Président de
l’Association des
habitants de La
Viscose
Tableau 1 : liste des personnes interviewées
Les questions du guide d’entretien portent sur la description du service, sa
performance durable, ses conditions d’émergence, en particulier les motivations
et modalités du partenariat public-privé à l’origine de l’innovation de service,
et son fonctionnement, ainsi que les évolutions sur la période 2008-2012 (voir
Tableau 2).
Description du service ?
Histoire de la création du service ?
Objectifs lors de la création du service ?
Différentes parties prenantes impliquées dans la création du service ?
Différentes parties prenantes impliquées dans la servuction (système de production du service) ?
Performance économique ?
Performance environnementale ?
Performancesociale?Créationde«sens»?
Evolution depuis 2008 ? (pour les entretiens réalisés en 2012)
Evolution prévue ?
Facteurs clés de succès du partenariat public-privé ?
Limites rencontrées ?
Tableau 2 : Guide d’entretien (extraits)
Les entretiens ont été intégralement retranscrits et les analyses de contenu (Yin,
1994) ont été réalisées à partir de ces documents et des extraits de presse.
Nous avons recueilli ainsi environ 320 verbatim (sélection de verbatim ci-après).
Une première analyse textuelle a permis de faire émerger le cadre général de
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université du Québec à Montréal - - 132.208.29.200 - 16/04/2013 12h46. © Management Prospective Ed.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%