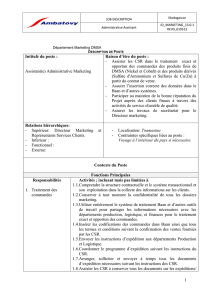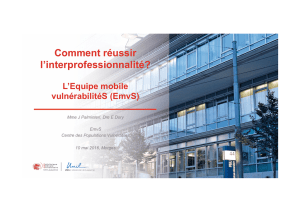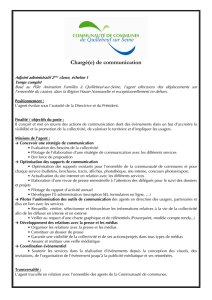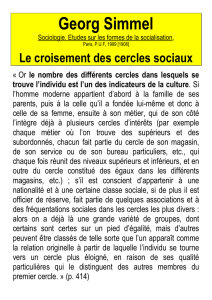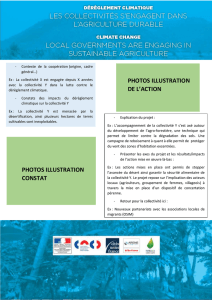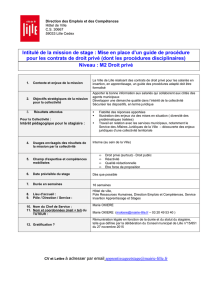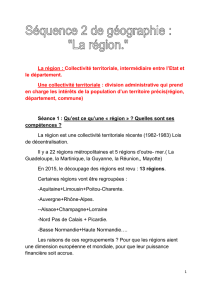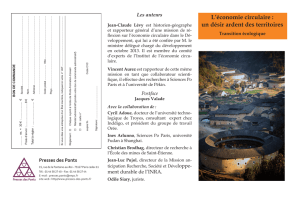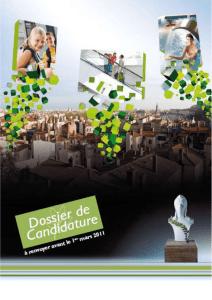cercles de soutien et de responsabilité - CSC-SCC

1
Correctional Service
Canada
Service correctionnel
Canada
CERCLES DE SOUTIEN ET DE
RESPONSABILITÉ :
GUIDE À L’INTENTION DES
CANDIDATS BÉNÉVOLES
MANUEL DE FORMATION
2002
Note : This document is also available in English
Canada

2
Remerciements
Nous aimerions remercier plusieurs personnes pour le temps et le travail qu’elles ont
consacrés à la préparation de ce guide.
L’un des premiers à reconnaître la nécessité d’uniformiser la formation de bénévoles
d’une région à l’autre fut M. Hugh Kirkegaard, pasteur. C’est également lui qui, jusqu’à
récemment, a dirigé le projet Cercles de soutien et de responsabilité, devenu par la
suite un programme national canadien. Son expérience transparaît tout au long du
présent document.
Evan Heise, David Dyck et Andrew McWhinnie ont également apporté leur pierre à
l’édifice : en qualité de consultants régionaux, ils ont rédigé chacun de larges portions
de ce manuel, qui a pris forme grâce à leurs conseils. Enfin, nous tenons à remercier
M. David Molzahn, pasteur, qui a pris la direction nationale de l’initiative des Cercles
de soutien et de responsabilité à l’automne de 2000 et auquel on doit l’achèvement du
projet dans sa forme actuelle.
Nous remercions du fond du cœur chacune de ces personnes et tous ceux et celles
qui, d’un bout à l’autre du pays, ont contribué de bien d’autres manières à la
multiplication des Cercles de soutien et de responsabilité.
Droits d'auteur - Service correctionnel du Canada
No. de cat. JS82-102/2002F
ISBN 0-662-87503-6
Internet www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/chap/documents_f.shtml

3
Table des matières
REMERCIEMENTS .................................................................................................... 2
TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................ 3
INTRODUCTION ........................................................................................................ 5
- OBJET ET HISTORIQUE DE CE MANUEL .......................................................... 5
- LES ORIGINES DES CERCLES DE SOUTIEN ET DE RESPONSABILITÉ ......... 6
- DÉFINITION DU CERCLE DE SOUTIEN ET DE RESPONSABILITÉ ................... 7
- ÉNONCÉ DE MISSION ET VALEURS FONDAMENTALES ................................. 7
- LA JUSTICE RÉPARATRICE ET LES CERCLES DE SOUTIEN ET DE
RESPONSABILITÉ ............................................................................................... 8
- ORDINOGRAMME DE FORMATION ET DE CRÉATION D’UN CSR ................... 9
- PARTICIPATION AUX SÉANCES DE FORMATION .......................................... 10
INITIATION AUX CERCLES DE SOUTIEN ET DE RESPONSABILITÉ ................ 13
A) CONDITIONS PRÉALABLES RECOMMANDÉES POUR L'INITIATION AUX
CSR .................................................................................................................. 13
B) LEADERSHIP ................................................................................................... 13
C) DURÉE DE LA SÉANCE D'ORIENTATION ...................................................... 13
D) RESSOURCES POSSIBLES ........................................................................... 13
E) OBJECT DE LA SÉANCE D'ORIENTATION ..................................................... 13
F) DÉMARCHES DE FORMATION POUR LA SÉANCE D'INITIATION................. 15
G) STRATÉGIE DE RECRUTEMENT ................................................................... 16
H) VIDÉO - PERSONNE N'EST JETABLE ..................................................................... 17
PHASE I : L'ATELIER DE BASE POUR LES CANDIDATS BÉNÉVOLES............. 20
A) CONDITIONS PRÉALABLES RECOMMANDÉES POUR L'ATELIER
DE BASE ........................................................................................................... 20
B) LEADERSHIP ................................................................................................... 20
C) DURÉE DE L'ATELIER DE BASE ..................................................................... 20
D) RESSOURCES POSSIBLES ........................................................................... 20
E) OBJET DE L'ATELIER DE BASE ...................................................................... 21
F) DÉMARCHE DE FORMATION POUR L'ATELIER DE FORMATION
DE BASE ........................................................................................................... 22
G) AUTRES SUGGESTIONS PROPOSÉES PAR MATIÈRE ................................ 23
H) PRÉPARER LES PARTICIPANTS À SUIVRE LA PHASE II ............................. 28

4
PHASE II : FORMATION AVANCÉE DES CANDIDATS BÉNÉVOLES .................. 30
A) CONDITIONS PRÉALABLES RECOMMANDÉES POUR LA PHASE II ........... 30
B) LEADERSHIP ................................................................................................... 30
C) DURÉE DE L'ATELIER DE FORMATION AVANCÉE ....................................... 30
D) RESSOURCES POSSIBLES ........................................................................... 30
E) OBJET DE L'ATELIER DE FORMATION AVANCÉE ........................................ 32
F) DÉMARCHE DE FORMATION POUR L'ATELIER DE FORMATION
AVANCÉE .......................................................................................................... 33
G) AUTRES SUGGESTIONS PROPOSÉES PAR MATIÈRE ................................ 34
H) DERNIÈRE ENTREVUE DE PRÉSÉLECTION AVANT D'ÊTRE AFFECTÉ À
UN CERCLE...................................................................................................... 42
ANNEXES ................................................................................................................ 43
ANNEXE A - L'APPRENTISSAGE CHEZ LES ADULTES ................................... 44
ANNEXE B - LE CYCLE DE L'APPRENTISSAGE PAR L'EXPÉRIENCE…...……46
ANNEXE C - SIMULATION EN GROUPE : LE DILEMME ......................................... 49
ANNEXE D : L'EXERCICE SUR LE QUATRE COMPOSANTES DE LA JUSTICE
RÉPARATRICE .................................................................................... 61
ANNEXE E : L'EXERCICE DES DRAPS ............................................................... 65
ANNEXE F : SIMULATION D'UNE RÉUNIONDE CSR .......................................... 68
GLOSSAIRE ......................................................................................................... 70

Manuel de formation du SCC 2002 - Introduction
5
INTRODUCTION
OBJET ET HISTORIQUE DE CE MANUEL
Ce manuel intitulé Cercles de soutien et de responsabilité : Guide de formation des
candidats bénévoles, est le premier du genre. Il s’appuie sur le guide des opérations
produit par le Comité central mennonite de l’Ontario et le Service correctionnel du
Canada (1996, révisé en 2000) et sur le travail de l'Équipe consultative pour victimes
et survivants reliée à l'initiative de Winnipeg.
Les cercles de soutien et de responsabilité (CSR)
1
constituent une solution
novatrice à un problème social complexe. Le présent guide vise à faciliter la formation
de bénévoles désireux de faire partie d’un "cercle" de soutien et de responsabilité à
l’appui d’un délinquant sexuel dont le mandat est arrivé à expiration. Il s’agit en outre
d’une première ébauche de rapport sur les travaux et les réflexions des nombreuses
personnes qui ont contribué, d’un bout à l’autre du Canada, à cette initiative
relativement nouvelle. L’idée de ce guide est née lorsqu’on a reconnu la nécessité de
rendre la démarche et les normes d’initiation et de formation des candidats bénévoles
et des professionnels plus cohérentes.
Ce Guide témoigne également de la réussite des cercles de soutien et de
responsabilité (CSR). En fait, l’expansion rapide des CSR démontre clairement que ce
programme est devenu un mouvement populaire étroitement lié à des organismes
communautaires d’un bout à l’autre du pays.
Il est également important de reconnaître qu’aucun guide n’est en mesure de rendre
justice au caractère essentiel d’un tel mouvement ni aux connaissances que les gens
acquièrent lorsqu’ils se réunissent en communauté de la sorte. Ainsi, le présent guide
vise à donner des renseignements sur la mise sur pied d’un cercle de soutien et de
responsabilité. Il ressort clairement de son contenu que l’apprentissage est un
processus continu.
Depuis trois ans, l’Aumônerie du Service correctionnel du Canada (SCC) joue un rôle
de premier plan dans ce mouvement en pleine éclosion en misant sur les CSR pour
aider les collectivités à répondre aux besoins des délinquants sexuels à risque élevé.
Au départ, on a créé un poste contractuel pour la promotion et l’expansion des CSR
par le canal d’un réseau national d’aumôneries communautaires.
À l’automne de 1998, les personnes s’intéressant aux CSR sont venues de tous les
coins du pays à Crieff Hills (Ontario) pour une série de réunions. Le financement de
démarrage des projets CSR, ainsi que les besoins en formation et en ressources de
soutien, ont été au centre des discussions. Le présent guide, avec ses modules de
formation et ses suggestions de démarches de formation, a été élaboré pour donner
1
Pour faciliter la lecture du présent document, l’appellation « cercles de soutien et de responsabilité » et
l’acronyme correspondant « CSR » sont interchangeables.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
1
/
73
100%