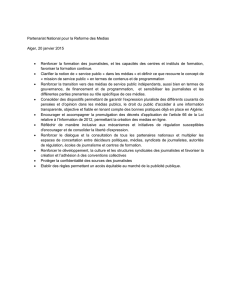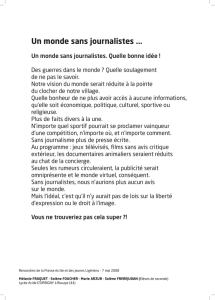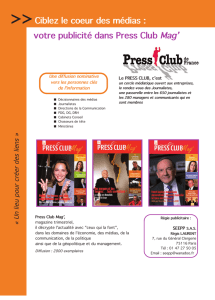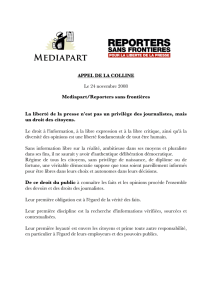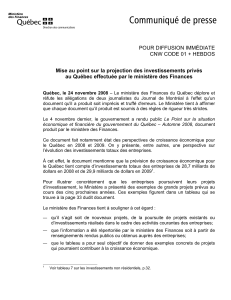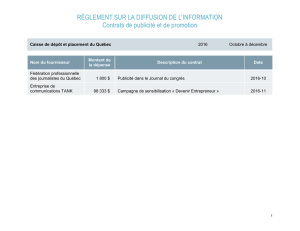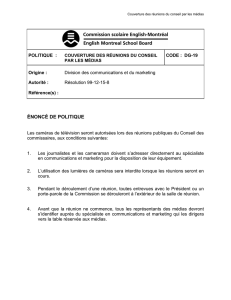"le pouvoir des medias" : vieux terrain, nouveaux objets

1
Le journal télévisé et l'information politique
Arnaud MERCIER
Docteur d'Université en Science Politique
Université de Nice.
Répondre à quelles questions ?
Voilà longtemps que je pense que la télévision a pris trop d'importance
dans la société et que les accusations contre "les médias" sont devenues trop
courantes, pour accepter l'attitude de nombre de chercheurs et
d'universitaires qui méprisent cet outil, tant comme objet de consommation
que comme objet d'étude, et qui le jugent à l'emporte-pièce.
J'ai donc choisi de comprendre les processus de fabrication télévisuelle
plutôt que de tomber dans l'anathème ou au contraire dans le culte de la
communication, en consacrant ma thèse à l'étude du journal télévisé (thèse
soutenue en novembre 1994 à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris). Mon
tout premier but était de démontrer l'inopérance de la "théorie du complot"
pour expliquer l'information télévisée, en soulignant la multiplicité des
facteurs explicatifs. Les journalistes ne sont pas, contrairement à ce que
pensent les chercheurs du Glasgow Media Group notamment, d'abord
guidés par des considérations idéologiques et partisanes, qu'ils tentent de
faire passer insidieusement. Il faut plutôt, à mon sens, mettre en évidence
les facteurs structurels et interactionnels qui déterminent l'activité
journalistique télévisuelle. Ceci m'a conduit à m'interroger plus largement
sur la place qu'occupe le journal télévisé dans la vie démocratique. La
télévision est-elle la forme renouvelée du forum démocratique ? Quelle place
le journalisme de télévision finit-il par avoir dans le fonctionnement du jeu
politique ?
Orientations théoriques
Il est impossible de répondre à ces questions sans étudier de près le
contenu des informations et sans dégager les structures interprétatives qui
guident les journalistes dans leur présentation quotidienne de la politique à
la télévision. Cela m'a conduit à étendre largement les champs
d'investigation, de façon à avoir une vision globale des principales logiques à
l'oeuvre dans, pour et autour du journal télévisé. Je suis donc allé vers des
disciplines extérieures à la science politique, comme la narratologie ou la
sémiologie, outils utiles pour décrypter les processus généraux de
communication politique.
Ma recherche emprunte donc les voies ouvertes par plusieurs
chercheurs ou groupes de recherche. La volonté de resituer le journal
télévisé dans ses logiques internes et non politisées de fonctionnement
s'inscrit dans le prolongement des travaux menés en sciences de
l'information et de la communication. Le souci d'expliquer le contenu de

2
l'information par une sociologie du journalisme trouve ses racines dans les
travaux de Rémy Rieffel, de Roland Cayrol et de Jean-Gustave Padioleau
pour la France, et de Philip Schlessinger, Michael Schudson ou encore Gaye
Tuchman pour les travaux anglophones. L'intérêt pour la question de la
place prise par les journalistes dans l'espace public provient de la familiarité
acquise avec les travaux effectués au laboratoire Communication et politique
du CNRS et publiés dans la revue Hermès. Mais cette approche, qui place les
journalistes au coeur même du processus démocratique, mérite d'être
complétée par les nombreuses réflexions de Jay Blumler et Michael
Gurevitch sur la communication politique, ainsi que par des points de vue
plus critiques comme ceux de Peter Dalhgren. Mes travaux sur l'analyse de
contenu doivent quant à eux beaucoup aux lectures de la revue canadienne
Communication - Information, ainsi qu'aux études d'Eliseo Véron, de Stuart
Hall ou Paolo Mancini. Ces études, sans partir du même postulat,
permettent chacune de dégager un ou plusieurs traits dominants du
traitement télévisuel des faits, qu'il convient de mettre en cohérence. C'est ce
travail de rassemblement de perspectives séparées que j'ai mené, en
apportant pour ciment quatre éléments qui sont : l'histoire récente de la
profession, sa trajectoire identitaire singulière, ses rapports ambivalents
avec le pouvoir politique et enfin, la mise en évidence du rattachement des
journalistes aux catégories d'entendement du sens commun, au sens où
l'entend Clifford Geertz.
Problèmes méthodologiques
Pour mener à bien cette démonstration, j'ai mobilisé de multiples outils
méthodologiques. J'ai mené une enquête dans la rédaction d'Antenne 2 grâce
à une présence régulière dans les locaux pendant un mois et demi. Il
s'agissait, en s'inspirant des méthodes ethnographiques, de suivre
l'élaboration d'un journal télévisé du début jusqu'à la fin, en observant puis
en interrogeant l'ensemble des personnes liées à l'élaboration d'un journal et
au bon fonctionnement d'une rédaction. La plupart du temps, ces
observations étaient ponctuées par un entretien selon un questionnaire
modulable. J'ai également pu suivre des équipes du service politique en
reportage, à l'Assemblée nationale. Cette méthode a permis à la fois
d'observer les interactions concrètes entre hommes politiques et journalistes
et de remarquer l'importance des discussions - et parfois des échanges
d'informations - entre confrères dans les phases d'attente. Le cadre, moins
contraignant que celui de l'interview dans un bureau, permettait également
d'avoir des discussions plus informelles avec les journalistes et les
techniciens présents, qui se livraient alors plus volontiers, car il est un fait
que les journalistes ne sont pas une population facile à étudier. Soit ils sont
sur la défensive et acceptent mal l'enquête, soit ils répondent facilement,
mais connaissent trop bien les ficelles de la situation d'entretien pour ne pas
savoir manier à leur tour une certaine langue de bois.
Il convient par conséquent, de mettre ces discours en perspective avec
différents propos publics tenus par les principaux journalistes de télévision :
entretiens publiés dans la presse ou autoprésentation du métier dans des

3
livres grand public. Autant de lieux où un journaliste cherche à valoriser la
profession dans son ensemble. Furent utilisées, aussi, les présentations du
métier faites dans les manuels de téléjournalisme, dans les ouvrages ou les
revues à visée pédagogique. Cette étude tend donc à mettre en évidence la
nature des discours justificatifs tenus sur la pratique et sur la profession,
dans un but de valorisation et d'identification collectives.
J'ai également cherché à déterminer les influences du passé sur les
situations présentes. J'ai donc étudié certaines archives du Syndicat
national des journalistes, pour étudier le moment d'institutionnalisation de
la profession de journalistes dans les années 20 et 30, en approfondissant
cette réflexion dans un article paru dans la revue Hermès. J'ai également
obtenu auprès des Archives nationales l'autorisation de consulter, par
anticipation, certains fonds déposés par Jacqueline Baudrier et concernant
les services de direction de l'ORTF entre 1968 et 1975.
En ce qui concerne la constitution du corpus, une troisième méthode
de recherche fut sollicitée. Il s'agissait d'enregistrer les journaux télévisés de
20h., pendant tout le mois de janvier 1991, sur les trois chaînes en même
temps, à l'aide de trois magnétoscopes. J'ai ainsi constitué un corpus de
documents audiovisuels représentant des dizaines d'heures d'information
télévisées sur lesquels travailler. Afin de rendre ce corpus plus stable et
accessible à tous, j'ai choisi de restituer une sélection de ces reportages
télévisés en photos, à la fin de mon livre. Le mode d'élaboration et de
traitement de ces données iconographiques n'est pas sans poser d'épineux
problèmes méthodologiques.
Pour prendre du recul face à l'image télévisuelle, il faut d'abord la
resituer dans un contexte global, sans se contenter d'une analyse de
contenu linéaire, d'où la nécessité, de faire une sociologie des producteurs,
mettant en avant leur identité social et politique, leurs rapports conflictuels
avec le pouvoir politique, la volonté de se revaloriser, de plaire au public, etc.
Ensuite, il faut pouvoir "décortiquer" l'image, étudier ses rapports avec le
commentaire, s'abstraire de la mise en scène qui nous est donnée. Cela
impose d'utiliser des principes méthodologiques rigoureux, car plusieurs
questions délicates s'offrent alors à nous. La première est celle du sens de
l'image.
En effet, il n'existe pas de sens intrinsèque à l'image. L'image n'est pas
porteuse d'un sens univoque, que la "bonne lecture" pourrait élucider, et qui
ferait du sémiologue le seul détenteur de l'interprétation légitime. C'est dans
le regard de chacun, dans la confrontation avec autrui, que l'image prend
sens. Si elle fournit bien une amorce de sens, elle ne peut être considérée
comme un univers clos, exempt de toute interprétation. Ceci se vérifie
chaque jour dans les multiples débats sur les interprétations
iconographiques, opposant des individus pourtant confrontés à la même
image. Cette irréductibilité des points de vue tient au fait que l'image est par
essence polysémique, et qu'elle n'acquiert son sens que dans l'interprétation,
chacun important sa personne, son histoire, ses affects dans la lecture qu'il

4
propose. A ce titre, l'analyse de l'image télévisuelle nécessite une grande
vigilance et un travail laborieux, car, en sus des difficultés inhérentes à
toute analyse iconographique, l'image télévisuelle ajoute ses obstacles
propres :
- Il n'y a pas une image, mais un flot d'images en mouvement.
- Le journal télévisé est une succession de séquences dont la seule
unité réelle est de "faire l'actualité", c'est-à-dire, selon la justification
tautologique des journalistes, de mériter d'être au journal télévisé.
- En plus de l'image, la télévision ajoute le son, c'est-à-dire le
générique, les musiques, les bruits et les discours.
- Enfin, il y a de plus en plus d'images dans l'image au sein du journal
télévisé. Les incrustations, logos et autres images électroniques surchargent
l'écran.
Tous ces éléments sont porteurs d'une plus ou moins forte
signification, et font de l'image télévisuelle un support saturé de "sens". Il
peut submerger le chercheur si l'on n'instaure pas une certaine distance
vis-à-vis de ces différents supports signifiants.
L'autre difficulté majeure tient à ce que toute image est polysémique
parce qu'elle contient la plupart du temps plusieurs sèmes que l'on ne
retient pas tous avec la même saillance. La charge affective que comporte,
pour chacun, telle ou telle image en rend une plus visible que l'autre, par
exemple. Le détail que l'on ne perçoit pas, devient significatif pour autrui. Le
spectre de l'image est large, puisqu'il s'étend des sensations visuelles
immédiates aux réflexions intellectuelles en passant par les registres de
l'inconscient et du fantasmatique. De plus, l'image n'obéit pas aux mêmes
exigences logiques que la pensée verbalisée. Les relations entre les éléments
qu'organise l'image sont faites de continuités et de simultanéités, sans
hiérarchie logique, alors que l'exposé discursif implique nécessairement une
successivité orientée. Heureusement, le journal télévisé offre, moins de prise
à une pluralité d'interprétations possibles, puisqu'il se veut un acte
communicationnel à portée d'abord descriptive et cognitive. L'image n'est
toujours pas porteuse d'un sens autonome et intrinsèque, mais elle est le
véhicule d'une intention communicative clairement affichée, tendant à
présenter le locuteur comme un simple intermédiaire et retranscripteur
d'une réalité qui le dépasse. Pareil postulat guide l'interprétation de chacun,
et limite le champ des possibles. C'est à partir de ce que j'analyse comme un
pacte de communication spécifique, conclu implicitement entre
téléspectateurs et journalistes, qu'il devient possible de présenter une
sociologie de l'image, où le sens affleure essentiellement de la connaissance
des intentions qui font agir les producteurs de l'image.
Principales conclusions
A partir de ces préceptes méthodologiques, je me suis donc appliqué à
décrire les différents facteurs explicatifs de la production journalistique, en
prenant en compte d'abord les contraintes de l'outil télévisuel (financières,
techniques, concurrentielles), puis le poids de l'histoire dans la définition

5
d'un modèle professionnel spécifique et l'attitude des journalistes face à la
perte de crédibilité et d'identité qui les frappe et qui remet en cause ce
modèle. Enfin, j'analyse les rapports problématiques que les journalistes de
télévision entretiennent avec le pouvoir politique. Ces différents facteurs
entrent en interaction et délimitent le mode de traitement de la politique au
journal télévisé. Les contraintes de temps conduisent ainsi à ne s'intéresser
qu'aux déclarations et autres actes officiels, sans se soucier de mettre en
avant des processus souterrains de décision, par exemple. La contrainte de
l'utilisation des images appauvrit considérablement cette entreprise
journalistique et conduit à écarter de multiples sujets pourtant d'actualité,
mais peu ou pas du tout redevables d'une mise en récit filmique. Par
ailleurs, la réponse identitaire produite par l'élite des journalistes télévisés
face à la remise en cause qui les assaille met en avant une mission de
service du public et du bien public, qui ferait des journalistes de télévision
des gestionnaires de l'accès à l'espace public. Pareil postulat conduit les
rédactions à s'intéresser, essentiellement, aux agissements politiques qui se
déroulent sous l'oeil d'une caméra et qui correspondent aux canons du
genre télévisuel. L'espace public est alors confondu avec l'une de ses
facettes, à savoir l'espace communicationnel. Ce phénomène est d'autant
plus net que les journalistes et les principaux acteurs de l'actualité,
singulièrement politiques, sont liés, après un long passé conflictuel dont je
restitue les étapes, par des sentiments de méfiance et de peur réciproques
mais aussi par des pratiques de promotion croisée, autour d'intérêts
communs à jouer le jeu de la médiatisation de l'activité sociale et politique.
Mais dans cet échange avec les élites, les journalistes ne peuvent se couper
de leurs publics. Ils cherchent donc à fédérer les publics les plus divers.
Pour ce faire, ils axent leur présentation autour de certains dénominateurs
communs minimaux, en empruntant les catégories de jugement du sens
commun et les ressorts du genre narratif. Ces présentations sont en partie
en contradiction avec leur objectif de valorisation de la chose publique et
avec l'identité collective socialement et déontologiquement responsable qu'ils
mettent en avant.
J'ai donc voulu montrer comment les journalistes de télévision
arrivaient peu ou prou à surmonter ces diverses contradictions, en
présentant une image de la politique faite de neutralité apparente et de
jugements de valeurs implicites ; de relative agressivité face aux hommes
politiques sur la forme et de déférence institutionnelle sur le fond ; de mise
en scène appuyée de leur fonction de gestionnaire de l'accès à l'espace
public avec pourtant une réelle pauvreté informative sur les débats qui
animent la société.
Pistes à poursuivre
Les prolongements de ce travail peuvent se faire dans deux directions.
D'abord dans un sens horizontal, en comparant le travail des journalistes de
télévision français avec ce qui se passe dans d'autres pays. Didier Oti devrait
d'ailleurs publier un ouvrage chez l'Harmattan, en 1998, où il compare les
rédactions de télévision d'une chaîne française, québécoise et camerounaise
 6
6
1
/
6
100%