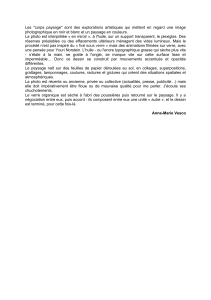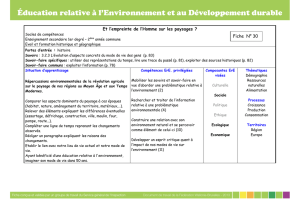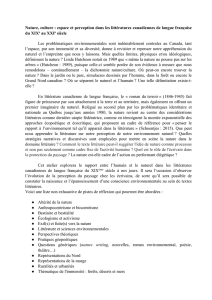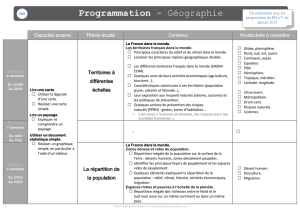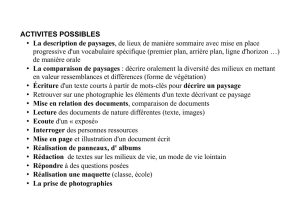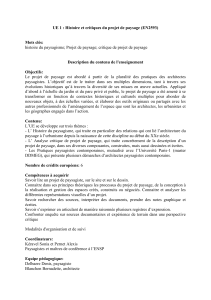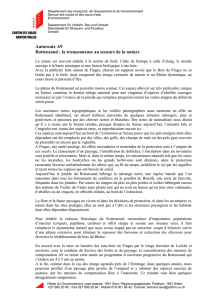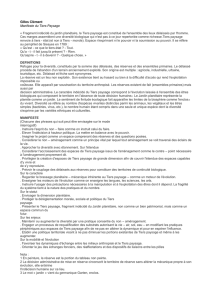1 Journées d`étude Évolution du paysage parisien au prisme du

Journées d’étude Évolution du paysage parisien au prisme du risque climatique
École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, 4-5 février 2016
Comment habiter la Terre à l’anthropocène ?
Augustin Berque
1. Des tours contre le dérèglement climatique ?
Si j’ai bien compris le titre de ces journées d’étude, il s’agit de paysage urbain ; et si j’ai bien
les yeux en face des trous, l’image qui introduit au programme de ces journées d’étude nous
montre un Paris parsemé de tours géantes. Cela m’a immédiatement ramené un demi-siècle en
arrière, en cette année 1967 où je commençais à enseigner à l’École des Beaux-Arts, quai
Malaquais, côté architecture ; et plus particulièrement à un numéro spécial de la revue Paris
Match (n° 951-952, juillet 1967), consacré au thème « Paris dans vingt ans ». Ce qui était
concocté dans ces années-là pour Paris « à l’horizon 80 », c’étaient effectivement des tours. Et
apparemment, ce qui est imaginé aujourd’hui pour « Paris smart city 2050 », ce sont
également des tours. En 1967, le numéro de Paris Match en question annonçait fièrement :
« Le général De Gaulle a étudié douze projets confidentiels. Les voici ». Et elles étaient là en
effet, les maquettes des projets Arretche, Marot, Faugeron etc., légendées par la revue : « La
Seine : de Grenelle à Bercy, elle coulera entre tours et jardins » (je n’avais pas remarqué à
l’époque, mais je remarque aujourd’hui, qu’on allait donc faire couler la Seine d’aval en
amont) ; « Ministères et sièges de sociétés, ces géants seront les monuments de la ville
nouvelle » ; etc. Près d’un demi-siècle après le « plan Voisin » de Le Corbusier, l’idéal de ces
architectes n’avait pas changé : moderniser Paris, ce serait y faire des tours. Et un demi-siècle
plus tard encore, il est toujours le même : adapter Paris à l’anthropocène, ce sera y faire des
tours. La seule évolution, c’est – comme sur la belle image de notre programme – que ces
mêmes tours seront teintes en vert.
Tout en m’inclinant devant l’imagination créatrice de ces architectes, je voudrais
considérer la question du paysage urbain sous un autre angle. Sous cet angle-là, il s’agirait,
comme l’indique le titre de mon exposé, de cadrer cette question dans le contexte de
l’Anthropocène. Ce mot d’« anthropocène », comme vous le savez, a été proposé il y a seize
ans, en février 2000, par un météorologue néerlandais, Paul Crutzen, titulaire du Nobel de
chimie 1995 pour ses travaux sur la couche d’ozone. Il s’agissait par là de qualifier un
ensemble de phénomènes, en particulier le dérèglement de l’homéostasie climatique de notre
planète, sous l’effet de l’action humaine. Cela se passait à Cuernavaca, au Mexique, dans un
colloque du Programme international Géosphère-Biosphère (l’IGPB d’après ses initiales
anglaises), qui a été lancé en 1987 pour coordonner les recherches menées dans différents
pays et à différentes échelles, du régional au planétaire, sur les interactions entre l’action
humaine et les changements biologiques, chimiques et physiques du « système Terre ».
Crutzen voulait dire que les effets de l’action humaine sont devenus tels que nous ne sommes
plus dans la période de l’holocène – la plus récente de l’ère quaternaire –, mais entrés dans
une période nouvelle, l’anthropocène. Le mot vient du grec anthropos, l’humain, et kainos,
nouveau. L’idée, c’est que l’action humaine a désormais des effets d’une ampleur tellurique,
géologiquement significative.
Parmi ces effets, les deux plus graves sont la destruction de la biodiversité, qui fait
aujourd’hui parler d’une « sixième grande extinction » de la vie sur Terre, et le dérèglement
du climat terrestre, thème sous-jacent à celui du présent colloque. Il s’agit pour nous du
« paysage parisien au prisme du risque climatique », mais bien entendu, cette question ne doit
pas être abstraite du système Terre, car en matière de climat, la circulation de l’atmosphère à
l’échelle planétaire est nécessairement en jeu. Elle ne doit pas non plus être abstraite des
causes générales qui ont provoqué l’anthropocène, causes qui sont humaines, comme ce nom

2
même l’indique. Mais comme je ne dispose que de vingt minutes et qu’il existe d’excellents
ouvrages sur ces questions – je vous conseille en particulier la lecture de L’Événement
anthropocène, de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz
1
–, je bornerai mon examen à
celui des causes qui touchent le plus directement au paysage urbain.
2. Règne automobile et empreinte écologique
Le paysage est une chose relative, sur laquelle les avis peuvent varier. Pour mémoire, je
citerai ci-dessous un passage du discours que le président Georges Pompidou prononça le 18
novembre 1971 au District de la Région Parisienne. Ce passage (où j’ai souligné ce qui
concerne le paysage) parlait de
« […] la voie express Rive Droite, que quelques uns critiquent quelquefois, mais qu'en tout cas
23 millions d'automobilistes ont empruntée l'an dernier, ce qui prouve qu'elle sert à quelque
chose, et cela sans abîmer le paysage et même en donnant à ces 23 millions de gens qui l'ont
empruntée quelques-unes des plus belles satisfactions qu'un homme puisse avoir au point de vue
esthétique, comme par exemple quand il sort du tunnel devant le Louvre et qu'il débouche sur le
Pont Neuf et l'Île de la Cité. Ceci pour expliquer qu'il y a un certain esthétisme auquel il faut
renoncer et que ce n'est pas parce que on empêcherait les voitures de circuler qu'on rendrait
Paris plus beau. La voiture existe, il faut s'en accommoder et il s'agit d'adapter Paris à la fois à
la vie des Parisiens et aux nécessités de l'automobile à condition que les automobiliste veuillent
bien se discipliner ».
En quoi cette assez longue citation concerne-t-elle le risque climatique ? En ce que le
secteur des transports est, en France, le premier émetteur de gaz à effet de serre. Je glane sur
internet les chiffres suivants : 26% pour ce secteur en 2004, en hausse de 23% par rapport à
1990. L’industrie, qui arrivait en second, comptait pour 20%, en baisse de 22%. Certes, 2004,
c’est un peu ancien comme statistique, mais la tendance ne faiblit pas. Le parc automobile
français était de 36 millions en 2005, et de 38 millions en 2015, soit +5,5%. Il compte sans
doute aujourd’hui pour le tiers des émissions de gaz à effet de serre. Quant au parc automobile
mondial, il a dépassé le milliard en 2007, et s’il est proche de la stagnation dans les pays
riches, il bondit dans les autres. L’intéressant, c’est que la courbe de la production
d’automobiles et celle de la teneur en CO2 dans l’atmosphère, de 1900 à 2015, ont suivi des
pentes ascendantes remarquablement voisines. Une voiture émettant en moyenne 1,8 tonne de
CO2 par an, le parc automobile mondial émet annuellement plus de deux milliards de tonnes ;
et si la moyenne mondiale du nombre d’automobiles par habitant rejoint celle des pays riches,
soit de 500 à 800 voitures pour mille habitants, on en sera entre 5 et 7 milliards de tonnes
annuelles. Hardi le réchauffement !
Si les gens roulent toujours plus – dans la région parisienne, la voiture a dépassé la
marche en 1983 comme premier mode de déplacement –, c’est qu’ils n’habitent plus comme
autrefois. Nous ne sommes plus à l’ère de la ville compacte, mais à celle de l’urbain diffus. Or
dans l’urbain diffus, il faut au moins deux voitures par ménage. On objectera que l’urbain
diffus ne concerne pas le paysage parisien. Paris intrapériphérique est une ville compacte. Oui,
mais s’agissant de climat, Paris subira les effets du réchauffement comme le reste de la
planète. Du reste, les Parisiens sont les champions de la résidence secondaire, dont le nombre
atteignait en France 3,3 millions en 2015 (+10% en dix ans) ; et posséder une résidence
secondaire, c’est rouler.
Un tel mode de vie est insoutenable : son empreinte écologique dépasse largement les
capacités de régénération de la biosphère. Et comme il n’y a pas de mode de vie sans habitat,
ni d’habitat sans paysage, on peut dire, à très gros traits, que ce paysage-là est insoutenable.
1
Paris, Seuil, 2013.

3
Le programme de recherche « L’habitat insoutenable » (2001-2010) a justement montré que
les motivations qui ont historiquement conduit à l’urbain diffus tiennent à l’idéalisation d’un
certain paysage : la maison individuelle au plus près de la nature
2
. Mais voyons les choses
d’un peu plus près.
3. Espace foutoir et principe du mont Horeb
Lorsqu’il proposa en 1961, pour remplacer la gare d’Orsay désaffectée, un « Hôtel et palais
des congrès » sous la forme d’une barre de grande hauteur, Le Corbusier accompagna sa
maquette de l’argument suivant (je souligne ce qui a explicitement trait au paysage) :
« Ce lieu géographique, cet élément extraordinaire du paysage parisien: la Seine, les Tuileries,
[…] c'est un régal de l'esprit et des yeux. L'histoire (Lutèce-Paris : Notre Dame, le Pont-Neuf
[…] (…) - tout ceci peut devenir un immense spectacle offert aux Parisiens et aux visiteurs. Il
s'agit, en effet, d'un Centre de Culture […] raccordé impeccablement à la totalité de Paris par
l'eau, par les métros, par les rues et relié (peut être) totalement par le chemin de fer (en direct) à
l'Aérogare d'Orly, devenu débarcadère de Paris, port non de mer, mais port de l'air.
Et ceci sans une bavure, sans un hiatus ; ceci apporté par le temps, par l'esprit à travers les
siècles. La bâtisse des temps modernes permet de créer un instrument prodigieux d'émotion.
Telle est la chance donnée à Paris si Paris se sent le goût de "continuer" et de ne pas sacrifier à
la sottise l'immense paysage historique existant en ce lieu ».
Quant au paysage, nous avons là le même principe que celui qui apparaît dans le propos
de Pompidou cité plus haut : l’abstraction du regard moderne de ce dans quoi il se situe
concrètement lui-même – un certain milieu. C’est Moi, le sujet moderne, qui toise l’étendue
alentour, à partir de ma voiture (Pompidou), ou du haut de ma barre (Le Corbusier). Et
l’étendue, ce n’est pas un milieu ; ce n’est qu’une somme d’objets offerts à mon propre regard,
à ma propre consommation – un paysage objet. Que la voie rapide faite pour ma voiture ait
supprimé l’agrément commun des quais de Paris, que ma barre mutile le paysage où elle
s’insère concrètement, cela n’entre pas en ligne de compte : le sujet moderne s’est abstrait de
son milieu. Il n’est plus dans le paysage. Le paysage, ce n’est plus qu’un objet extérieur,
étendu sous ses yeux, et qu’il consomme de son regard de nulle part.
Le résultat de cette abstraction, c’est cela que Rem Koolhaas a baptisé junkspace :
l’espace foutoir. L’espace foutoir, ce n’est pas seulement la fin de toute composition urbaine,
un capharnaüm où n’importe quoi se juxtapose à n’importe quoi. Ce n’est pas seulement une
question d’architecture. Déconnectant l’être du sujet individuel du milieu où il s’insère, c’est
une décosmisation d’ordre ontologique – une acosmie.
Cette acosmie – cette abstraction hors de l’ordre (kosmos) commun qui liait les êtres et
les choses en un certain milieu –, elle est proprement moderne. Descartes fut le premier à
l’exprimer quand il écrivit ce qui suit dans le Discours de la méthode : « je connus de là que
j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser, et qui, pour être,
n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune chose matérielle ». Cette abstraction du sujet
moderne hors de tout milieu, qui du même coup a converti celui-ci en une étendue objectale –
une somme d’objets déconnectés de l’être du sujet – , c’est ce qui en fin de compte a produit
l’espace foutoir, en coupant le lien ontologique – la médiance – des êtres et des choses, qui
seul rendait possibles les compositions urbaines.
En se coupant de son milieu, le sujet moderne s’est absolutisé. Voilà ce que proclame
le cogito cartésien, qui ne s’origine plus qu’en lui-même : je pense, donc je suis.
L’absolutisation de soi-même que cette formule exprime est homologue à celle que la Bible
attribue à Yahveh lorsque celui-ci dit à Moïse, au sommet du mont Horeb : « Je suis celui qui
2
V. mon Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient vers l’Occident, Paris, Le Félin, 2010.

4
suis (sum qui sum, היהא רשא היהא) ». C’est pourquoi je l’appelle le principe du mont Horeb.
C’est ce principe qui gouverne le regard de Le Corbusier lorsque, du haut de sa barre, il toise
le paysage de Paris tout en s’abstrayant lui-même de ce paysage ; et c’est ce principe qui a
produit l’espace foutoir.
4. Anthropocène et paysage
L’espace foutoir ne pose pas seulement un problème d’esthétique. Il manifeste une acosmie
plus générale et plus profonde, celle qui, en faisant de l’écoumène une simple étendue
extérieure, exploitable à merci, a déréglé l’homéostasie climatique de la Terre et déclenché la
Sixième Extinction. L’écoumène – l’ensemble des milieux humains –, c’est la relation de
l’humanité avec la Terre
3
. C’est ce qui, dans le « système Terre », introduit notre existence.
Le mot venant d’oikein, habiter, c’est littéralement l’habitation humaine de la Terre. Et être
habitants de la Terre, c’est la condition fondatrice de notre existence.
Or en s’abstrayant de tout milieu, c’est cette condition fondatrice que le sujet moderne
a forclose (locked out). Il l’a expulsée de sa conscience et ne veut plus la voir – tout comme le
principe du mont Horeb, en l’abstrayant du paysage, a forclos toute composition urbaine.
C’est de cette forclusion que témoigne le regard de Le Corbusier du haut de sa barre d’Orsay,
comme celui de Saubot, Beaudoin, Cassan et de Marien du haut de leur tour Montparnasse, ou
encore celui des auteurs de ce projet « Paris smart city 2050 », que le présent colloque a pris
pour emblème.
Or si, en lui-même, l’espace foutoir qui résulte de cette forclusion ne tue personne, et
s’il permet même de faire couler la Seine d’aval en amont en prétendant qu’on a là « un
instrument prodigieux d'émotion » et « quelques-unes des plus belles satisfactions qu'un
homme puisse avoir au point de vue esthétique », il n’en va pas de même quand on
reconcrétise la chose, c’est-à-dire quand on la replace dans le cadre de l’anthropocène, que
cette même forclusion a provoqué de manière générale.
Forclore notre condition écouménale, en effet, ce ne fut pas qu’une simple opération
de l’esprit ; ce fut, concrètement, orienter le cours de l’histoire humaine vers une abstraction
progressive hors de cela même qui permet que nous existions physiquement et
biologiquement : le système Terre. Or, concrètement, nous n’avons pas la transcendance de
Yahveh sur le mont Horeb ; car en réalité, nous sommes terrestres, inclus dans l’écoumène.
En déréglant le système Terre, nous avons mis en danger notre propre existence, plus encore
celle de nos enfants, et a fortiori celle de nos petits-enfants. L’espace foutoir n’est pas
seulement « tueur de paysage » -- shafengjing 殺風景, comme disait Li Shangyin (813-859) –
; il témoigne aussi d’une démission éthique : la forclusion de notre lien avec les autres, de nos
devoirs envers les autres, ce qui va de pair avec la forclusion de notre condition écouménale ;
car ce lien avec autrui et avec les choses, c’est ce qui fonde et structure l’existence humaine ;
tandis que l’espace foutoir, c’est un espace immoral, où l’on ignore le regard d’autrui, et où
les choses ne sont plus que des objets au lieu d’être le milieu qui participe de notre existence
même, mais que nous avons forclos.
On peut certes, avec le cynisme d’un Koolhaas, en rajouter encore et encore, y aller
toujours plus fort ; mais le résultat, c’est que ce faisant, nous nous enlisons toujours plus dans
l’espace insoutenable de l’anthropocène, en déréglant le système Terre toujours davantage.
Or à force de nous abstraire de tout milieu, à force de forclore la condition écouménale qui
fonde notre propre existence, nous finirons par nous supprimer de la surface de la Terre. Est-il
encore temps que l’architecture se reconcrétise, et que l’on cesse de faire couler la Seine à
l’envers ? Palaiseau, 15 janvier 2016.
3
V. mon Écoumène, introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000.
1
/
4
100%