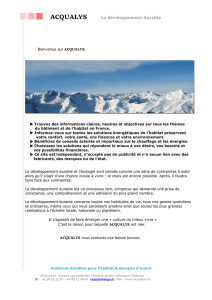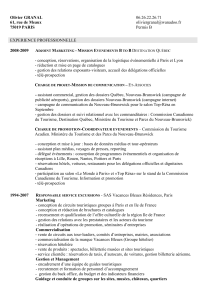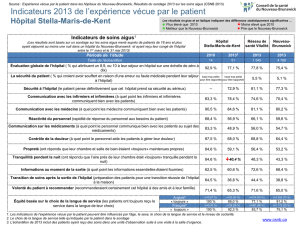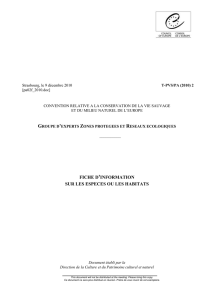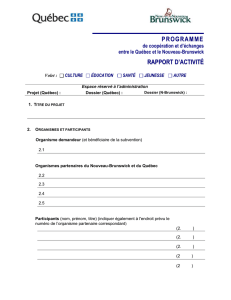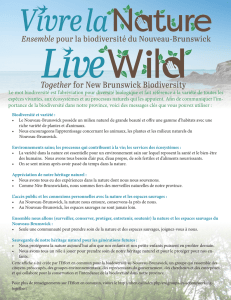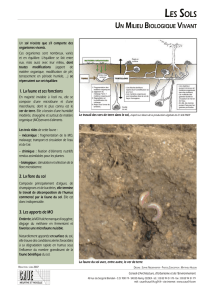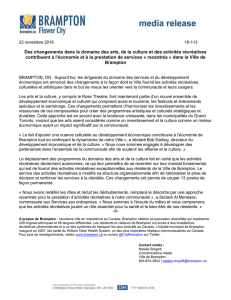Faune Objectifs d`apprentissage 2008 Identification et classification

Faune
Objectifs d’apprentissage 2008
Identification et classification de la faune
1.Identifier les espèces animales (vertébrés terrestres et aquatiques) communément
retrouvées au Nouveau-Brunswick.
2. Identifier les signes laissés par les animaux (fèces, pistes, sons, signes sur les arbres,
nids, plumes/poils).
3. Définir les termes suivants relatifs à la faune : rare, menacée, en voie de disparition.
4. Identifier certaines espèces animales (terrestres et aquatiques) rares, menacées, ou en
voie de disparition au Nouveau-Brunswick, apparaissant dans la liste du Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC, un organisme fédéral) et dans celle
des espèces à risque du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Habitat
1. Identifier les besoins vitaux (composantes biotiques et abiotiques) nécessaires à la
survie des espèces communes au Nouveau-Brunswick.
2. Décrire de quelles manières l’habitat d’une espèce donnée peut être amélioré si on
connaît les besoins vitaux de cette dernière.
3. Déterminer les raisons pourquoi une espèce peut changer ses besoins d’habitat et
décrire ces changements.
4. Détailler les raisons de la perte d’habitat au Nouveau-Brunswick.
5. Décrire les moyens utilisés par le gouvernement, l’industrie des ressources naturelles
et les autres pour contrer les problèmes liés à la perte d’habitat.
6. Dresser une liste de plusieurs espèces animales et végétales qui se retrouvent dans les
milieux humides et décrire leurs adaptations à vivre dans des conditions humides.
Écologie animale : concepts et terminologie
1. Décrire les adaptations animales reflétant notamment des mécanismes de défenses, des
habitudes alimentaires spécialisées, des mécanismes d’évitement de même que des
adaptations au climat froid (ex. hibernation, migration, accumulation de graisses,
formation de graisses brunes), ainsi que leur signification générale pour l’espèce et son
écosystème.

2. Définir «capacité du milieu» et décrire les raisons pour lesquelles c’est le facteur
principal affectant la taille d’une population.
3. Décrire le concept de capacité du milieu en référence avec au moins deux espèces
animales du Nouveau-Brunswick.
4. Définir «succession végétale».
5. Définir pour un écosystème donné les termes suivants : prédateur, proie, herbivore,
carnivore, omnivore, et décomposeur.
6. Décrire comment les changements dans une seule population peuvent affecter tout un
réseau alimentaire en utilisant des exemples spécifiques au Nouveau-Brunswick
(systèmes terrestre et aquatique).
7. Définir la zone riparienne et décrire son importance pour la faune.
8. Définir l’écotone et décrire son importance pour la faune.
Thème 2008 : L’impact des activités récréatives sur les ressources naturelles
Les activités récréatives sont sans contredit cruciales au bien-être mental et physique des
gens. En outre, les activités de loisir tendent à réduire l’impact du stress au travail. Elles
aident également à maintenir et développer les aptitudes sociales par l’interaction des
personnes dans une équipe sportive ou lors de la pratique d’une même activité comme
une randonnée pédestre dans un parc.
Alors que plusieurs écrits existent pour décrire les bénéfices des diverses activités
récréatives sur la santé des gens, il est important de se rappeler des conséquences de notre
interaction avec le monde naturel. Certaines activités ne laissent qu’une empreinte
mineure dans l’environnement alors que d’autres en laissent des plus profondes.
Comme membres d’Envirothon, et comme citoyens conscientisés de Gaïa, votre équipe
doit être en mesure de débattre les pours et les contres d’une variété d’activités
récréatives dépendant de leur impact potentiel sur les ressources naturelles, en particulier
sur la faune.
Exemple de question :
Le parc national Acadia (Mt. Desert Island, Maine) attire annuellement plus de deux
millions de visiteurs. La grande popularité associée à ce petit territoire entraîne une
congestion le long de plusieurs petites routes étroites. Le style décontracté et sans tracas
de même que les infrastructures disponibles attirent les touristes venant de régions
populeuses comme la ville de Boston. Avec l’appui de L.L. Bean, un système d’autobus
propulsé au propane, le Island Explorer, a été mis de l’avant afin de limiter
l’engorgement des routes. Est-ce que L.L. Bean et le Service du parc national ont fait le

bon choix ? Quelles autres mesures auraient pu être prises pour s’assurer que la faune du
parc ne soit pas « aimée à mort » ?
Application/Analyse
1. À partir d’un guide d’identification et de cartes de distribution géographique, identifier
des espèces indigènes et leur habitat dans les groupes suivants :
* insectes (aquatiques et terrestres) * reptiles
* mammifères (petite et grande taille) * oiseaux
* amphibiens * poissons (eau douce et salée)
Évaluation/Synthèse
1. Évaluer le potentiel de qualité d’un habitat pour une espèce donnée, en décrivant les
besoins d’habitat de cette dernière.
2. Décrire en quoi un changement dans le climat, la topographie ou l’utilisation du
territoire peut modifier le processus de succession végétale.
3. Expliquer de quelle manière les relations prédateur-proie et la capacité du milieu sont
intereliés.
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES À IMPACT MINIMAL
Parc nationalPukaskwa (Ont) :
http://www2.parkscanada.gc.ca/pn-np/on/pukaskwa/visit/visit7_e.asp
Mesure de l’impact des activités récréatives sur les falaises au Parc Shenandoah :
http://www.pwrc.usgs.gov/prodabs/ab10060307/6680_Wood.pdf
Objectifs et actions de réduction de l’impact des activités récréatives au Parc du Lac Rockies-Elk :
http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/planning/mgmtplns/elklakes/outdoor.pdf
La menace des activités récréatives sur les environnements sensibles :
http://www.cnr.vt.edu/forestry/cpsu/rececol.html
1
/
3
100%