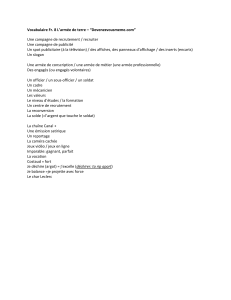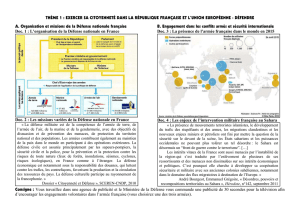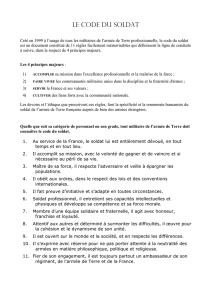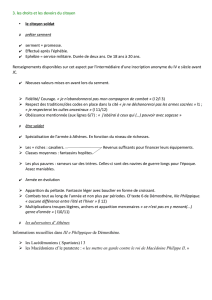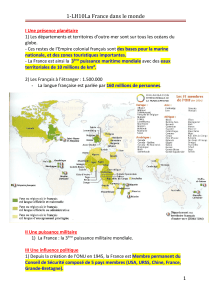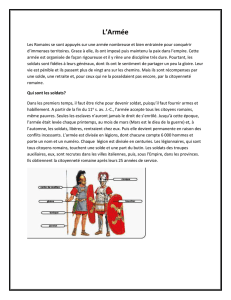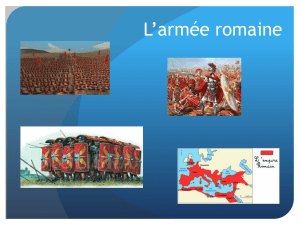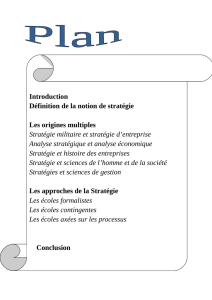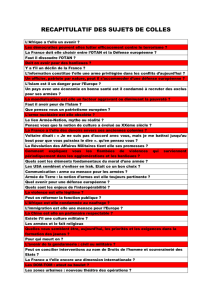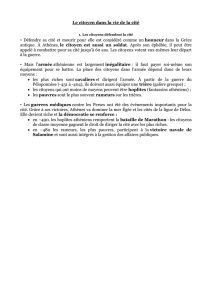Être parlementaire de la Révolution à nos jours



VIES D’AUTREFOIS
Collection dirigée par Philippe Martin
Dans la même collection :
Jean El Gammal, Être parlementaire de la Révolution à nos jours, 2013
Benoît Garnot, Être brigand du Moyen Âge à nos jours, 2013

Du même auteur
Armes en guerres. XIX -XXI siècles. Mythes, symboles, réalités, Paris,
CNRS Éditions, décembre 2011, 317 p.
Survivre au front (1914-1918). Les poilus entre contrainte et
consentement, Saint-Cloud, Soteca/14-18 Éditions (diffusion Belin),
février 2005, 265 p.
Les Soldats de la Drôle de guerre (septembre 1939-mai 1940), Paris,
Hachette, septembre 2004, 271 p.
Soldats sans armes. La captivité de guerre. Une approche culturelle,
Bruxelles, Bruylant, 1998, 429 p.
Rémois en guerre (1914-1918). L’héroïsation au quotidien, Nancy, PUN,
1993, 168 p.
Les exclus de la victoire. Histoire des prisonniers de guerre, déportés et
STO (1945-1985), Paris, Éditions SPM/Kronos, 1992, 272 p.
Direction d’ouvrages
Obéir et commander au feu (coll. « Expérience combattante », II volume),
Paris, Riveneuve Éditions, 2012, 413 p.
Les soldats inconnus de la Grande Guerre (avec Jean-Noël Grandhomme),
Actes du colloque de Verdun et Paris des 9 et 10 novembre 2010, Saint-
Cloud, Soteca/14-18 Éditions, 2012, 521 p.
Pierre Messmer. Au croisement du militaire, du colonial et du politique
(dir. avec François Audigier, Bernard Lachaise et Maurice Vaïsse), Paris,
Riveneuve Éditions, 2012, 509 p.
Former les soldats au feu, premier volume de la collection l’Expérience
combattante, XIX -XXI siècles, Paris, Riveneuve Éditions, 2011, 395 p.
Les tranchées de Verdun, journées d’études (18 et 19 juin 2009) dans
Verdun, histoire et mémoires. Les cahiers de la Grande Guerre, numéro 2,
CRULH, 14-18 Meuse, Mémorial de Verdun, p. 9-89.
Postures américaines, réactions françaises, Actes du colloque de février
2008, Metz, CRULH, 2010, 272 p.
Ferdinand Foch (1851-1929), « Apprenez à penser » (avec Remy Porte),
Saint-Cloud, Soteca/14-18 Éditions, 2010, 483 p.
e e
e
e e

Subversion, auto-subversion, contre-subversion (avec Olivier Dard), Paris,
Riveneuve éditions, coll. « Actes académiques », Paris, 2009, 373 p.
De Gaulle et les « Jeunes Turcs » des armées occidentales (1930-1945) :
une génération de la réflexion à l’épreuve de faits, Paris, Riveneuve
Éditions, 2008, 290 p.
Dictionnaire de la Grande Guerre (avec Remy Porte), Paris, Robert
Laffont, coll. « Bouquins », 2008, 1 120 p.
1917, Des monts de Champagne à Verdun, Actes du colloque des 24-25
mai 2007 (Mourmelon et Verdun), Saint-Cloud, Soteca/14-18 Éditions,
2008, 207 p.
1916-2006 : Verdun sous le regard du monde, juin 2006, Actes du
colloque tenu à Verdun les 23 et 24 février 2006, Saint-Cloud, Soteca/14-
18 Éditions (diffusion Belin), 2006, 389 p.
Les violences de guerre à l’égard des civils au xxe siècle : axiomatique,
pratiques et mémoires, Cahiers du CRHCEO, Université de Metz, 2005,
183 p.
Les batailles de la Marne. De l’Ourcq à Verdun (1914 et 1918), Saint-
Cloud, Soteca/14-18 Éditions, 2004, 327 p.
Les Américains et la France : Engagements et représentations (co-
direction Marie-Claude Genet-Delacroix et Hélène Trocmé), Paris,
Maisonneuve et Larose, 1999, 262 p.
Les occupations en Champagne-Ardenne, 1814-1944, Reims, Presses
Universitaires de Reims, 1996, 244 p.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%