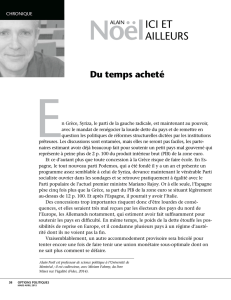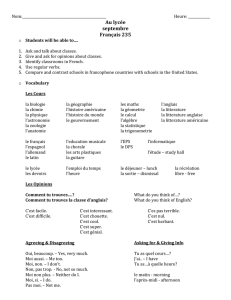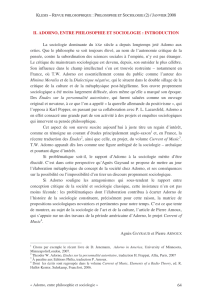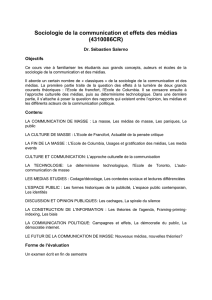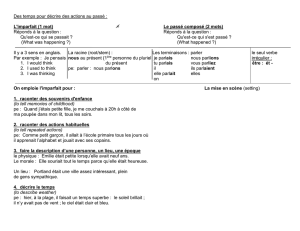Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme

84
Comptes
rendus
/
Sociologie
du
travail
58
(2016)
80–114
telles
les
oppositions
entre
«
matérialisme
»
et
«
spiritualisme
»,
«
mécanisme
»
et
«
dialectique
»,
ou
«
théorie
»
et
«
pratique
».
Nées
de
l’opposition
à
l’anti-positivisme
de
la
droite
littéraire
des
années
1930,
leur
fortune
s’est
révélée
beaucoup
plus
durable.
Références
Matonti,
F.,
2005.
Intellectuels
communistes.
Essai
sur
l’obéissance
politique.
La
Découverte,
Paris.
Mazuy,
R.,
2004.
Des
voyages
aux
doutes
:
Georges
Friedmann
en
URSS.
In:
Grémion,
P.,
Piotet,
F.
(Eds),
Georges
Friedmann
:
un
sociologue
dans
le
siècle,
1902-1977.
CNRS
Éditions,
Paris,
pp.
21-28.
Mathieu
Hauchecorne
Centre
de
recherches
sociologiques
et
politiques
de
Paris
(CRESPPA-LabTop),
UMR
7217
CNRS,
Université
Paris
8
Vincennes
Saint-Denis,
Université
Paris
Ouest-Nanterre,
59-61,
rue
Pouchet,
75849
Paris
Cedex
17,
France
Adresse
e-mail
:
Disponible
sur
Internet
le
16
janvier
2016
http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2015.12.003
Du
temps
acheté.
La
crise
sans
cesse
ajournée
du
capitalisme
démocratique,
W.
Streeck.
Gallimard,
Paris
(2014).
400
pp.
Spécialiste
allemand
reconnu
des
relations
professionnelles
et
de
l’analyse
des
institutions
du
capitalisme,
Wolfgang
Streeck
présente
dans
cet
ouvrage
un
diagnostic
fouillé
et
pessimiste
de
la
crise
actuelle
de
l’Union
européenne,
vue
comme
exemplaire
de
la
rupture
des
liens
entre
capita-
lisme
et
démocratie.
Tiré
des
conférences
Adorno
prononcées
en
20121,
le
livre
met
en
exergue
dès
son
titre
l’influence
délétère
et
la
résilience
de
la
financiarisation
du
monde
:
«
Du
temps
acheté
»,
c’est-à-dire,
au-delà
de
la
dynamique
du
crédit,
la
fuite
en
avant
d’échec
en
rebond.
Sous
l’égide
d’institutions
non
démocratiques,
au
premier
rang
desquelles
figure
la
Banque
centrale
euro-
péenne,
l’Union
monétaire
est
en
train
de
détruire
la
dimension
sociale
de
l’Europe
et
d’entériner
la
dictature
des
marchés
financiers
tout
comme
la
domination
de
l’Allemagne
néo-libérale.
La
voie
de
sortie
selon
W.
Streeck,
en
l’absence
d’une
perspective
crédible
d’approfondissement
démo-
cratique
de
la
construction
européenne,
serait
une
réforme
de
l’Euro
autorisant
les
dévaluations
et
redonnant
par
là
même
des
marges
de
manœuvre
aux
États-nations.
Le
livre
comprend
en
fait
trois
documents
:
le
texte
principal,
chronique
raisonnée
des
avatars
de
l’État
national
et
supranational
en
Europe
des
années
1960
à
nos
jours
;
la
postface,
réponse
aux
critiques
formulées
par
Jürgen
Habermas
à
l’édition
allemande
originale
de
2013
;
et
les
notes
de
bas
de
page,
copieuses
et
souvent
polémiques,
qui
apportent
des
compléments
substantiels
à
l’argumentation.
Les
apports
de
l’ouvrage
tiennent
à
sa
puissance
synthétique
et
à
sa
hauteur
de
vue.
Rassemblant
en
trois
chapitres
trois
versions
successives
de
l’État
—
l’État
fiscal,
l’État
débiteur
apparu
à
l’occasion
de
la
crise
commencée
en
2007,
et
l’État
de
consolidation
cherchant
à
rembourser
ses
dettes
—,
la
narration
montre
le
jeu
des
enchaînements
qui
ont
conduit
en
Europe
d’une
situation
«
fordienne
»
et
«
keynésienne
»
à
une
situation
«
hayékienne
»
où
domine
la
loi
des
«
gens
du
1Les
«
Frankfurter
Adorno
Vorlesungen
»
ou
«
Conférences
Adorno
»
sont
organisées
annuellement
depuis
2002
par
l’Institut
Für
Sozialforschung
(IFS)
de
Francfort
en
collaboration
avec
les
éditions
Suhrkamp
:
http://www.ifs.uni-frankfurt.de/veroeffentlichungen/adorno-vorlesungen.

Comptes
rendus
/
Sociologie
du
travail
58
(2016)
80–114
85
marché
»
face
à
celle
du
«
peuple
national
».
Il
en
résulte
un
double
regard
critique,
sur
les
analyses
qui
ont
pu
laisser
penser
que
les
compromis
de
l’époque
antérieure
allaient
durer
indéfiniment,
et
sur
les
analyses
actuelles
qui
sous-estiment
l’impasse
dans
laquelle
l’Europe
est
enfermée.
Friedrich
Von
Hayek
apparaît
alors
comme
le
grand
vainqueur,
ayant
tracé
dès
1939
un
programme
d’intégration
fédérale
et
libérale
qui
apparaît
aujourd’hui
comme
prémonitoire.
Mais
cette
victoire
est
la
résultante
d’une
série
d’aveuglements,
d’erreurs
et
d’abandons,
qui
appellent
aujourd’hui
prises
de
conscience
et
résistances,
principalement
sur
une
base
nationale.
L’analyse
rejoint
les
protestations
des
«
Indignés
»
et
du
mouvement
«
Occupy
Wall
Street
»
tout
en
s’inquiétant
de
leur
faible
audience.
Le
texte
passe
ainsi
de
l’étonnement
à
la
révolte.
Les
ressorts
de
l’argumentation
combinent,
dans
une
démarche
revendiquée
de
socio-
économie,
des
éléments
relevant
de
diverses
disciplines
:
économie
politique
(plus
que
science
économique),
sciences
politiques,
sociologie,
analyse
des
institutions.
Les
auteurs
utilisés
sont
d’abord
ceux
de
l’École
de
Francfort
dont
W.
Streeck
est
partiellement
l’héritier,
et
de
grands
poli-
tologues
allemands
tels
que
Fritz
Scharpf
et
Ralf
Dahrendorf.
Le
texte
est
aussi
très
inspiré
par
Karl
Polanyi,
dont
la
vision
d’ensemble
est
ici
prégnante
et
dont
certaines
analyses
sont
reprises
et
appliquées
à
l’actualité
de
l’Europe,
l’impossibilité
de
dévaluer
dans
le
cadre
de
l’Euro
étant
rapprochée
des
contraintes
qui
résultaient
de
l’étalon-or.
On
débouche
ainsi
sur
une
torsion
majeure
:
le
programme
néolibéral
qui
s’impose
actuellement
à
l’Europe
consiste
«
à
utiliser
la
puissance
des
États
forts
afin
qu’ils
cessent
d’être
des
États
interventionnistes
»
(p.
214).
W.
Streeck
reste
cependant
muet
sur
les
ressorts
et
les
limites
de
cette
force
des
États
qu’il
s’agirait
de
réactiver
et
de
réorienter
en
faveur
des
victimes
de
la
crise
et
de
l’austérité.
Pour
identifier
les
angles
morts
de
ce
point
de
vue,
on
peut
sans
doute
revenir
sur
la
position
de
l’auteur
à
l’égard
de
l’École
de
Francfort,
qui
combine
une
utilisation
et
une
prise
de
distance,
l’une
et
l’autre
partielles.
L’utilisation
est
celle,
classique,
des
analyses
de
Theodor
Adorno
sur
l’aliénation
culturelle
et
le
développement
des
industries
culturelles
qui
en
sont
le
vecteur.
La
prise
de
distance,
bienvenue,
porte
sur
la
faiblesse
des
contributions
de
cette
école
de
pensée
à
l’économie.
W.
Streeck
l’explique
par
le
positionnement
des
auteurs
dans
cette
ligne
de
pensée
post-marxiste,
qui
souhaitaient
se
dégager
de
l’économicisme
souvent
reproché
aux
premiers
marxistes.
Mais
cette
explication,
certes
pertinente,
est-elle
suffisante
face
à
l’étonnement,
qui
demeure
pour
le
lecteur,
de
voir
une
école
de
pensée
post-marxiste
majeure
et
des
auteurs
de
première
grandeur,
tels
qu’Adorno
et
Max
Horkheimer,
se
détourner
de
l’économie
au
moment
même
où
s’invente
la
macroéconomie
?
Il
en
résulte
un
malaise
quant
au
rapport
que
le
texte
de
W.
Streeck
entretient
avec
l’économie.
L’auteur
présente
de
nombreux
graphiques
et
de
nombreux
arguments
économiques
sans
se
situer
dans
la
gamme
des
analyses
macroéconomiques
actuelles,
sans
discuter
les
théories
des
zones
monétaires
et
sans
revenir
sur
l’éventail
et
les
incertitudes
des
analyses
actuelles
des
crises.
L’interrogation
rebondit
alors
sur
une
seconde
mise
à
l’écart,
qui
interpelle
elle
aussi.
W.
Streeck
montre
éloquemment
la
non-convergence
actuelle
des
économies
et
des
sociétés
au
sein
de
l’Europe.
Ses
préconisations
se
centrent
sur
l’expression
et
le
respect
des
différences
institu-
tionnelles,
nationales
voire
étatiques.
Mais,
au
motif
qu’il
privilégie
l’étude
de
la
crise
actuelle
et
la
périodisation
qui
en
découle,
il
a
disqualifié
d’entrée
un
autre
courant
de
pensée
socio-
économique
majeur
pourtant
a
priori
pertinent
ici,
celui
de
la
«
variété
du
capitalisme
»
(p.
13).
Ce
qui
frappe
pourtant
dans
la
crise
est,
au-delà
de
la
synchronisation
de
son
départ,
la
variété
des
réponses
nationales,
comme
en
témoignent
la
trajectoire
des
États-Unis
et
celles
de
petits
pays
européens,
pas
tous
dans
l’orbite
allemande.
W.
Streeck
témoigne
en
définitive
d’un
pessimisme

86
Comptes
rendus
/
Sociologie
du
travail
58
(2016)
80–114
globalisant,
qui
le
conduit
par
exemple
à
mentionner,
comme
en
passant,
la
quasi-disparition
et
l’impuissance
des
syndicats
(p.
236).
Le
paradoxe
du
livre
apparaît
ici
dans
cette
posture
de
visionnaire
anti-visionnaire,
cette
pos-
ture
désenchantée
d’un
grand
intellectuel
allemand
et
d’un
social-démocrate
européen
déc¸u,
qui
constate
et
déplore
l’envahissement
de
l’économie
des
marchés
financiers
et
la
«
camisole
de
force
»
de
l’intégration
européenne,
mais
se
détourne
de
la
diversité
actuelle
des
disciplines
et
des
analyses
qui
complexifient
les
acteurs
et
démultiplient
les
déterminants
de
la
crise
actuelle.
Bernard
Gazier
Centre
d’économie
de
la
Sorbonne
(CES),
UMR
8174
CNRS
et
Université
Paris
1
Panthéon-Sorbonne,
Maison
des
sciences
économiques,
106-112,
Boulevard
de
l’Hôpital,
75647
Paris
cedex
13,
France
Adresse
e-mail
:
Disponible
sur
Internet
le
19
janvier
2016
http://dx.doi.org/10.1016/j.soctra.2015.12.004
Think
tanks
in
America,
T.
Medvetz.
University
of
Chicago
Press,
Chicago
(2012).
344
pp.
Au
mois
de
septembre
2014,
le
New
York
Times
révélait,
sur
le
mode
du
scandale,
que
de
nombreux
think
tanks
situés
à
Washington
recevaient
des
sommes
importantes
des
gouvernements
étrangers
pour
produire
des
études
conformes
à
leurs
intérêts.
Ce
constat,
qui
provoqua
de
vives
réactions,
invite
à
découvrir
la
brillante
analyse
de
Thomas
Medvetz
consacrée
au
phénomène
des
think
tanks
aux
États-Unis,
basée
sur
de
nombreuses
sources
archivistiques
ainsi
que
sur
quarante-quatre
entretiens.
L’ouvrage,
bienvenu
dans
un
contexte
où
les
organismes
qualifiés
de
think
tanks
se
multiplient
en
Europe,
tout
comme
les
études
qui
leur
sont
consacrées,
offre
un
regard
renouvelé
sur
ce
phénomène.
Le
postulat
—
autoproclamé
—
de
l’indépendance
des
think
tanks
(à
l’égard
du
champ
politique,
économique,
académique,
médiatique)
est
d’emblée
écarté.
Le
lecteur
échappe
ainsi
à
l’énumération,
récurrente
dans
les
travaux
existants,
visant
à
délimiter
les
«
vrais
»
think
tanks
de
ceux
qui
ne
le
seraient
pas.
L’auteur
invite,
au
contraire,
à
renverser
la
perspective
pour
saisir
les
think
tanks
à
travers
leur
dépendance.
Cette
dépendance
politique,
économique,
médiatique,
mais
aussi
académique
inscrit
les
think
tanks
dans
un
champ
interstitiel,
à
la
croisée
de
ces
différents
secteurs
professionnels.
Préférant
la
topologie
sociale
aux
typologies
habituelles,
l’auteur
montre
ce
que
les
organisa-
tions
étudiées
doivent
à
chacun
des
secteurs,
en
termes
de
ressources
matérielles
et
symboliques,
et
comment
elles
cherchent,
en
même
temps,
à
s’en
distinguer
en
permanence.
Si
des
constats
similaires
ont
pu
être
faits
à
l’égard
des
professionnels
de
la
démocratisation
(Guilhot,
2005),
le
cas
des
think
tanks
attendait
une
démonstration
aussi
aboutie.
Bien
qu’une
place
particulière
soit
réservée
aux
organismes
spécialisés
dans
les
questions
sociales
(notamment
la
gestion
de
la
pauvreté),
l’analyse
s’appuie
sur
les
données
prosopographiques
relatives
aux
employés
de
vingt-
deux
principaux
think
tanks
américains
(Hoover,
Rand,
Carnegie,
Council
on
Foreign
Relations,
etc.),
ce
qui
permet
de
l’illustrer
par
des
graphiques
lisibles.
La
démarche
de
T.
Medvetz,
inductive,
part
d’une
question
en
apparence
simple
:
«
que
sont
les
think
tanks
»
?
La
démonstration
est
complexe
puisque
l’auteur
analyse
la
genèse
des
think
tanks
mais
s’intéresse
aussi
à
leur
action,
qui
consiste
à
réguler
la
circulation
du
savoir
et
du
personnel
entre
les
différentes
sphères
étudiées.
Cette
approche,
socio-historique
et
empirique,
1
/
3
100%