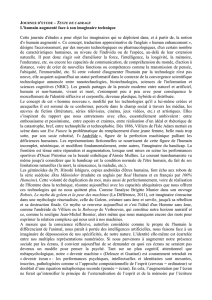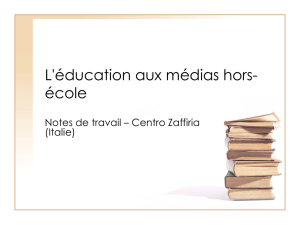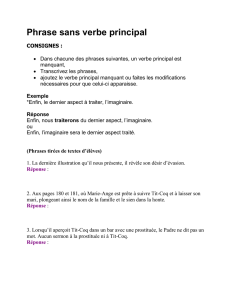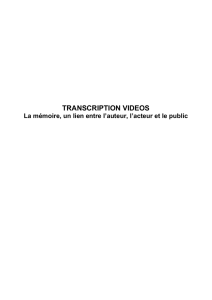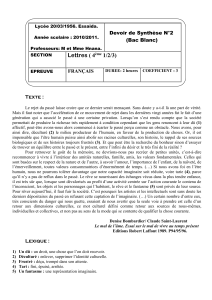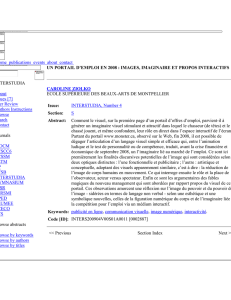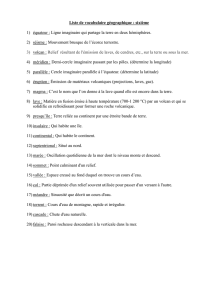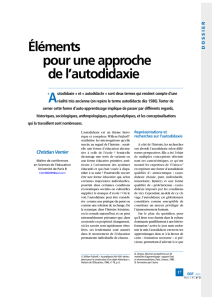1 Séquence 6 LE MASQUE IMAGINAIRE DE L

1
Séquence 6
LE MASQUE IMAGINAIRE DE L’AUTODIDACTE
Autodidaxie et autodidactes stimulent l’imaginaire individuel et social, alimentent des
représentations sociales. Les autodidactes, tout autant ceux qui ont réussi que ceux qui
auraient échoué, sont source d’images souvent très évocatrices de lutte, d’isolement, de
quête. Par cette accumulation d’images, l’autodidaxie est un fantastique réservoir
d’imaginaire.
1. Les images
Ce sont principalement l’atypicité, l’étrangeté, la différence, l’hétérodoxie, qui en univers
où l’hétéroformatif est en position de force, semblent nourrir la production d’images
mentales la concernant. Ces représentations imaginaires contribuent à parer
l’autodidaxie d’une idéalité déviante et marginale, mais elles lui donnent aussi un sens
qu’un regard scientifico-positiviste se voit dans l’impossibilité de lui conférer, étant
donné la rationalité dont il est le dépositaire.
Le rassemblement de quelques-unes de ces images, en une sorte de « musée
imaginaire » - cet imaginaire
(http://www.barbier-rd.nom.fr/Histoiredimaginaire.htm)
aussi ancien
que l’humanité -, s’il peut contribuer à troubler une juste perception de ce que sont
véritablement autodidaxie et autodidactes, peut également en permettre une plus juste
compréhension, par une stylisation finalement heuristique de leur réalité.
Quelques exemples de cet imaginaire sur l’autodidaxie :

2
Parmi les images les plus fréquentes concernant autodidactes et autodidaxie, on trouve
« Le livre », le « Combat »,le « Guerrier », « L’Appétit » et le « Temps », le «
Naufragé », « l’Ile au trésor », « l’Autre rivage », le « Phénix », « Prométhée », le «
Héros », etc. De ces images, qui sont amplement détaillées ailleurs (Verrier, 1999, pp.
179-201), nous n’en présenterons que quatre dans cette séquence (le Phénix, le
Naufragé, l’Ile au trésor, Prométhée), à titre d’exemple de la puissance évocatrice de
l’imaginaire concernant l’autodidaxie. Nous essayerons ensuite de comprendre la
signification de cette production d’images en termes éducatifs et sociaux.
2. Le Phénix
L’autodidacte peut-être vu comme celui qui a trahi. En transitant culturellement et parfois
socialement vers un « autre rivage » que celui qui était initialement le sien, la ymbolique
de l’eau traversée est aussi connotée comme puissance purificatrice : « les objets jetés
sont jugés, mais l’eau ne juge pas » (Chevalier, Gheerbrant, 1962, p.378).
Et l’autodestruction, suivie de purification, ne serait qu’un point d’un cycle fantasmatique
de successions d’autocréations-autodestructions, fantasme que repère René Kaes chez
l’autodidacte qu’il nomme Félix, qu’il représente par l’image forte du Phénix
(
http://www.archangelcastle.com/mythologie/creatures/phoenixindex.php)
cet oiseau « rare et
somptueux » qui ne naît pas d’une copulation et est symbole de résurrection.
Le Phénix manifeste « une conduite suicidaire qui provoque sa mort d’où il renaît des
cendres de sa consummation », et dans cette perspective l’auto-apprentissage de
l’autodidacte « n’est pas un engendrement (au sens de la rencontre d’un père et d’une
mère), mais une création perpétuelle, sans origine ni fin, sans rupture ni commencement
» (Kaes, Anzieu, 1973, p. 15), radicalement coupée d‘altérité.
Ce mythe du Phénix, aussi ancien que l’humanité, auquel fait allusion René Kaes en le
ramenant à l’autodidacte connut un grand succès, il fut maintes fois repris dans les
recherches sur l’autoformation, et a certainement contribué à propager une vision «
enfermée », refusant l’altération, occultant l’autre, de l’autodidacte : « Le fantasme
d’autoformation satisfait le besoin d’incorporation orale du bon savoir que Félix tire de
lui-même. Au plus fort de sa lutte contre les tendances autodestructrices c’est lui-même
qu’il incorpore, sans parvenir à s’assimiler (…) Ainsi se boucle le cercle infernal et
fascinant, celui du serpent qui, tel Ourobouros, se mord la queue, celui de l’alternance
perpétuelle de la naissance et de la mort : et le cercle ne peut s’ouvrir que sur la mort
inattendue comme révélation ultime de soi » (Kaes, Anzieu, 1973, p. 16).
3. Le naufragé et l’Ile au trésor
L’autodidacte est un abandonné de ses tuteurs savants, dont il n’a pas reçu la parole.
«Orphelin de la culture », de cette culture qu’il convoite mais qui « l’écrase », envers
laquelle il demeurera toujours marqué d’une sorte « d’infantilisme ». L’autodidacte
inéduqué et devenu inéducable évoque le « garçon sauvage de l’Aveyron, les enfants
loups de l’Inde ». Les bonnes fées de la pédagogie ne se sont pas penchées sur son
berceau, et comme pour les enfants-loups « qui ne peuvent réaliser l’apprentissage du

3
langage et de l’intelligence passé un certain stade de croissance, il ne rattrapera jamais
son retard » (Gusdorf, 1964, p. 154).
Il est trop tard, le thème du temps, par ailleurs si souvent remarqué relativement à
l’autodidaxie, revient une nouvelle fois. Perdu au milieu de la forêt du savoir dont
chaque arbre lui cache la connaissance, orphelin de la culture et donc de la société, il
en est réduit à vivre de lui-même sur son environnement immédiat et limité, semblable à
Robinson Crusoé
(http://www.ent-ter.fr/galerie.htm?6gale02.htm&1)
isolé sur son île déserte. «
Robinson de la Connaissance », ses apprentissages sont autant de robinsonnades
insulaires. Son Ile déserte, qu’il n’a pas choisie, symbolise bien sûr le refuge, mais aussi
« un monde en réduction, une image du cosmos, complète et parfaite », pouvant
devenir un « lieu de science au milieu de l’ignorance et de l’agitation du monde profane
», accédant ensuite au statut de « centre primordial » (Chevalier, Gheerbrant, 1962, p.
519).
L’image de l’isolement de Robinson sur son île renvoie à une nostalgie d’un savoir brut,
non morcelé, imprégnant tous les stades de l’existence. Robinson Crusoé « récapitule à
lui seul l’ensemble des savoirs et savoir-faire humains », il ne peut survivre, à l’instar
des personnages de L’île mystérieuse de Jules Verne, « qu’en exploitant l’ensemble de
ses potentialités » (Authier, Levy, 1993, pp. 165-166). Issu d’une époque
d’industrialisation et de découpages scolaires du savoir, l’image de l’apprenant
expérientiel de Daniel Defoe assimilée à l’autodidacte traduit peut-être la nostalgie d’un
monde de liberté, d’un apprentissage livré aux contingences du milieu, mais dégagé de
la décision politique, de l’emprise de la Cité éducative, de la cité tout court.
Se profile une figure de l’autodidacte capable de résister, par sa capacité présumée
l’embrasser l’ensemble des savoirs et savoir-faire, à la parcellisation des savoirs,
comme la manifestation d’un regret d’un homme mythiquement réinventeur d’un monde
et d’une connaissance qui ne seraient plus « en miettes », regret d’une époque
idéalisée où le savoir et son acquisition auraient jailli de l’autos comme l’expression des
vertus de la personne.
Mais si l’île peut encore contenir dans ses replis de secrets imaginaires attractifs pour
les autodidactes contemporains, la quête en est-elle toujours possible ? Un autodidacte
d‘aujourd’hui déclare : « Nous allons naviguer dans le Pacifique avec des plans, des
cartes (…). Cela mijote dans ma tête depuis toujours. Le plus difficile c’est de me
débrouiller pour trouver un trésor à aller chercher » (Marion, 1993, p. 69).
4. Prométhée
Depuis que René Kaes à popularisé l’image du Phénix pour caractériser l’autodidacte
Felix, l’auto-apprentissage est devenu à tort synonyme d’enfermement, de boucle
autarcique irrémédiablement refermée sur elle-même et privée d’altérité. Mais le Phénix
dévoré par le feu peut renvoyer au mythe de Prométhée
(http://grenier2clio.free.fr/grec/promethee.htm)
, qui vient rappeler les interdits culturels et les
risques encourus par celui qui ose dépasser les conventions sociales de la culture et de

4
la science, tout en incitant à ce dépassement dans une perspective héroïque (Frijhoff,
1996, p. 11).
L’autodidacte sera vu alors comme transgressif, déviant, voire rebelle. Prométhée porte
en lui « une tendance à la révolte. Mais ce n’est pas la révolte des sens qu’il symbolise,
c’est celle de l’esprit, de l’esprit qui veut égaler à l’intelligence divine, ou au moins lui
ravir quelques étincelles de lumière » (Chevalier, Gheerbrant, 1962, p. 787), de cette
lumière qui est « le génie du phénomène igné. Le feu n’est-il pas d’ailleurs, dans le
mythe de Prométhée, qu’un simple succédané symbolique de la lumière esprit ? Un
mythologue peut écrire que le feu est très apte à représenter l’intellect, parce qu’il
permet à la symbolisation de figurer d’une part la spiritualisation (par la lumière), d’autre
part la sublimation (par la chaleur) » (Durand, 1969, p. 197).
L’autodidacte apparaît alors comme défiant le savoir et ceux qui le possèdent
légitimement et le transmettent, conquérant solitaire et profane de cette parole
professorale qui ne l’a pas touché dans sa jeunesse. Le défi est lancé aux maîtres qu’il
n’a pas eus ou qui n’ont pas voulu de lui , et Bachelard propose « de ranger sous le
nom de complexe de Prométhée toutes les tendances qui nous poussent à savoir autant
que nos maîtres, plus que nos maîtres (…). Le complexe de Prométhée est le complexe
d’oedipe de la vie intellectuelle » (Bachelard, 1949, pp. 26-27). Et si, ayant été absent,
le père-maître n’est qu’imaginé, son image et sa force n’en sont que plus prégnantes.
5. Une surface de projection idéale
A la vue de ce court échantillon d’images la concernant, on constate que l’autodidaxie
provoque en chacun de nous, chez tous ceux qui ont effectué des parcours éducatifs
classiques ou moins classiques, des interrogations diverses, des retentissements variés,
qui sont souvent livrés sous une forme métaphorique, et qui parviennent parfois,
semble-t-il, à altérer, par une vision profondément subjective, la perception du réel auto-
éducatif. L’autodidaxie suscite des résonances sociales à partir d‘associations d’images
qui fréquemment ne doivent que peu de choses à une rationalité scientifique
traditionnelle qui cantonne habituellement l’imagination à une manifestation parasite de
la pensée.
Comme tout imaginaire, celui tissé autour de l’autodidaxie emprunte aux mythes, aux
symboles, à la métaphore, aux figures poétiques, et par le développement de ces
images, l’autodidacte participe à sa façon de cette mise en scène du drame continu de
l’être humain, c’est-à-dire de sa condition d’homme se débattant aux prises avec ce qui
le harcèle, avec ses pulsions que la psychanalyse met à jour, avec ses angoisses, ses
croyances, ses ambitions.
A l’intérieur de ce tissage d’images, dont certaines fonctionnent comme des
imagesguides par leur récurrence et viennent constituer une perception particulière de
l’autodidaxie, il est finalement possible d’assez bien retrouver une part de cette
expression symbolique commune à toute l’humanité, que Gilbert Durand
(http://nicol.club.fr/ciret/bulletin/b13/b13c10.htm)
a analysée en en recherchant les grandes
structures (Durand, 1969).

5
Ainsi, à l’intérieur d’oeuvres littéraires, mais également dans le discours des
autodidactes eux-mêmes, apparaissent quelques configurations dominantes de cet
imaginaire qui se construit sur l’autodidaxie, et sous la variété apparente de ces
représentations, il est possible de repérer certaines structures répétitives qui la signent
et l’éclairent d’un jour quelque peu différent de la sociologie ou de la psychanalyse, mais
qui complètent ces approches.
6. Comprendre par l’image
Il se peut que cet imaginaire recèle un type particulier de compréhension de
l’autodidaxie, dans la mesure où l’imagination, à travers les images symboliques qu’elle
produit, dit et montre des réalités ou une idée se dissimulant derrière l’image, ce qui
relève d’une réelle complexité anthropologique.
Par exemple, l’image de l’orphelin de la culture accolée à l’autodidacte peut sembler
signifier qu’il n’est point de salut culturel hors de l’éducation institutionnalisée de type
hétéroformatif. L’imagination, dans son intuition, peut être susceptible d’exprimer une
intelligibilité de l’objet autodidaxie qui demeure cachée, rebelle, inaccessible à la
perception scientifique ordinaire. En ce sens elle est profondément heuristique.
L’utilisation du symbole peut être une voie de compréhension, et sa répétition le signe
qu’un imaginaire à l’origine individuel trouve une résonance dans un imaginaire plus
collectif, ceci venant naturellement influer sur la perception générale de l’autodidaxie. Il
devient possible de dire que s’il existe des imaginaires individuels sur l’autodidaxie,
celle-ci peut également être perçue suivant des archétypes trouvant un écho dans le
social.
Par la référence à la mythologie ou au symbole, l’imaginaire
(http://66.102.9.104/search?q=cache:7O_USYMqebcJ:www.unites.uqam.ca/religiologiques/no1/neces
site.pdf+imaginaire+durand&hl=fr&lr=lang_fr&ie=UTF-8)
liant l’autodidaxie aux grands mythes
fondateurs, à l’histoire de l’humanité, permet de la situer dans un corpus prenant une
épaisseur singulière, de nature véritablement anthropologique.
En ce sens la construction d’un idéal-type de l’autodidaxie qui emprunterait
principalement à l’imaginaire permettrait de mieux cerner sa réalité qui se refuse à
l’investigation ordinaire : « L’imaginaire commence là où la réalité oppose, sinon un
refus, au moins une résistance : quelque chose n’est pas directement accessible, se
dérobe, mais se laisse deviner, permet un espoir, mais se voile » (Postic, 1989, p. 14).
L’imaginaire contribue à éclairer l’objet, il devient moyen de compréhension et non plus
ce qui vient troubler la raison, il est nécessaire de le prendre en compte. Sous certaines
conditions de rigueur, l’imagination et le résultat de sa production, l’imaginaire, peuvent
aider à la constitution et à l’extension du savoir sur l’autodidaxie, et ainsi « L
‘imagination peut contribuer à l’intelligibilité du réel, au moins autant que le
raisonnement abstrait peut, de son côté, produire des fictions ».(Wunenberger, 1991, p.
97).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%