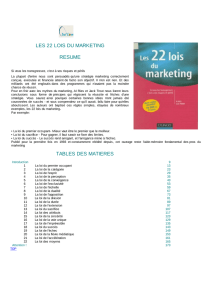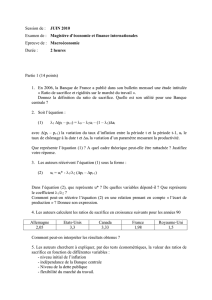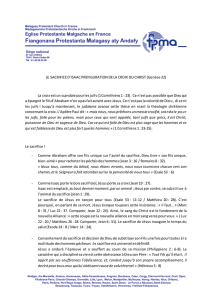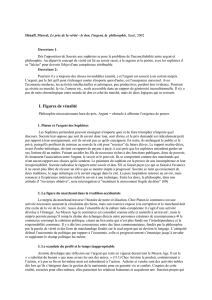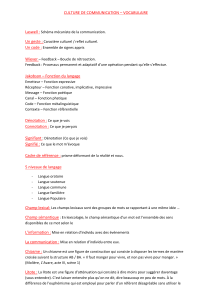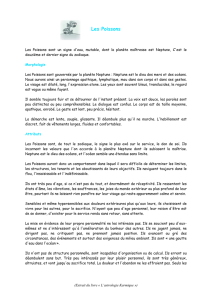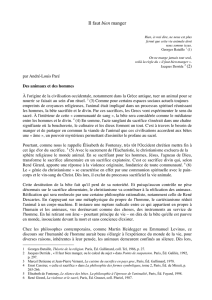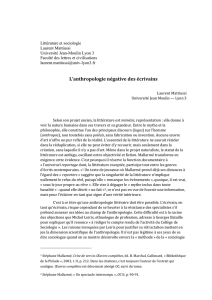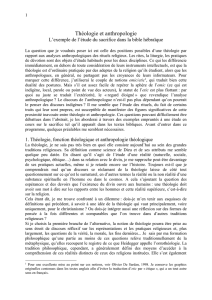La femme et le sacrifice



La
Femme
et
le
Sacrifice

DU
MÊME
AUTEUR
La
Vocation
prophétique
de
la
philosophie,
Éditions
du
Cerf,
1998.
La
Sauvagerie
maternelle,
Calmann-Lévy,
2001.
Une
question
d'enfant,
Bayard,
2002.
Blind
date,
sexe
et
philosophie,
Calmann-Lévy,
2003.

Anne
Dufourmantelle
La
Femme
et
le
Sacrifice
D'Antigone
à
la
femme
d'à
côté
DENOËL
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%