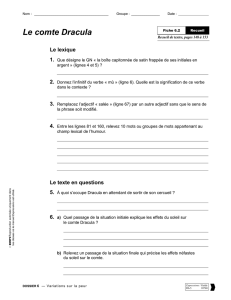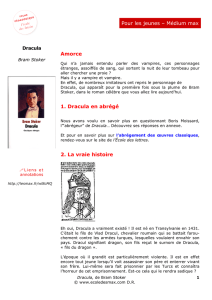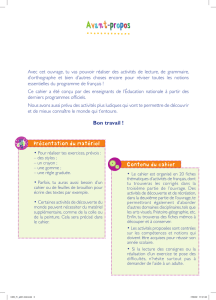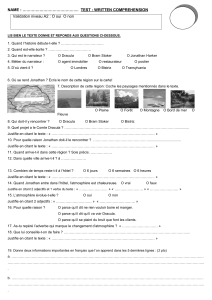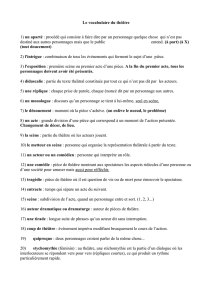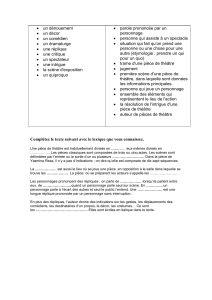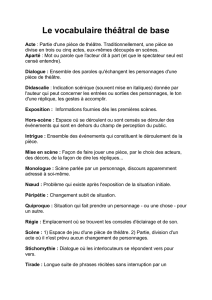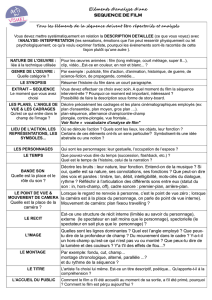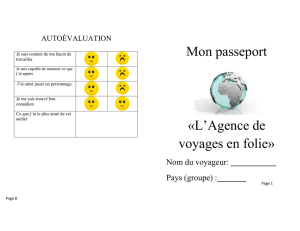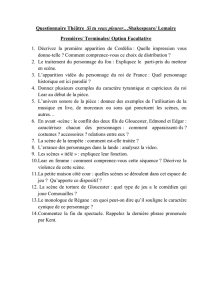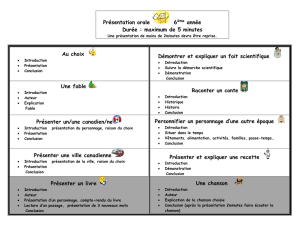LA PROPRIÉTÉ DES IMAGES : L`EXEMPLE AMÉRICAIN
publicité

John David Viera California State University LA PROPRIÉTÉ DES IMAGES : L'EXEMPLE AMÉRICAIN Traduit de l'anglais par Eric Maigret L'invention de l'appareil photographique, et celles du film ou de la télévision, ont entraîné une séparation de l'image visuelle de son sujet réel et ont rendu possible la production et la consommation de masse d'images à une échelle bien supérieure à celle connue pour la peinture et la lithographie. La reproduction mécanique de notre monde visuel a largement favorisé la commercialisation de l'image. Les représentations des acteurs, les visages des individus, les danses, les rituels, la nature, les voyages de vacances, la famille, bref, tout notre monde phénoménologique visuel, ont ainsi pu être fixés dans des formes matérielles et exploités sans limite de temps. Tous ces changements ont eu un effet saisissant sur les individus. Le citoyen moyen, dont l'apparence visuelle avait toujours appartenu essentiellement au domaine public — puisque cette apparence était exposée au regard d'autrui — ne fut pas seulement « kodakisé », il se heurta aussi à toute une série de problèmes dans ses rapports avec la société, et dut s'interroger sur la manière de protéger son intimité contre les médias omniprésents, empêcher l'exploitation à des fins commerciales de son image par d'autres, dans le cas par exemple de photographies publicitaires. Les gens célèbres virent également se transformer leurs relations avec leurs admirateurs et la société. Les nouvelles formes de médias et d'art ont fait émerger de nouvelles formes de célébrités : c'est le cas par exemple des stars du cinéma dans les années dix et les années vingt, ou, aujourd'hui, l'élévation au rang de star de journalistes de radio ou de télévision. Les figures HERMÈS 13-14, 1994 81 John David Viera du personnage historique marquant, de l'individu renommé, du héros et de la célébrité sont devenues les références centrales de la nouvelle société d'images —le statut de star étant au prix d'une perte presque totale de la vie privée. La fixation des images augmente les possibilités d'exploitation commerciale de toutes les « personnalités » pour lesquelles le public, durant un laps de temps certes très court, manifestait son intérêt. Cette extension du domaine de l'image engendre un certain nombre de problèmes juridiques et éthiques. Dans la sphère juridique, deux doctrines de défense des droits de la personne apparaissent au XXe siècle : celle du « droit à h vie privée » et celle, plus récente, du « droit de propriété» de la personne sur son image, droit dit de « publicité ». Ces deux approches se sont centrées sur le concept d'« individu », sur ce qu'un « individu » peut revendiquer comme appartenant à sa personne, et sur ce qu'il doit concéder à la société ou à l'intérêt supérieur du groupe. Toute une série de préoccupations éthiques se manifeste alors, souvent en conflit avec les normes juridiques réglementant Γ« individu ». Problème éthique majeur que celui de la propriété de l'image : qui possède véritablement l'image d'un individu et qui devrait, en droit, la posséder ? Autre domaine de préoccupation, celui de l'éthique de Vutilisation de l'image et de la relation entre le sujet dépeint et l'utilisateur de son image. Lié à ces problèmes, celui des limites de l'autorisation donnée par le sujet et celui de la révocabilité ou non d'un consentement déjà accordé. De plus, se pose la question de savoir comment les images sont collectées, de nombreuses techniques photographiques et filmographiques malmenant l'idée que nous nous faisons de la vie privée — caméras et microphones cachés ou espionnage par télé-objectif, par exemple. A travers cet essai* qui aborde la question de la propriété de fait et de droit de l'image d'une personne, j'indiquerai les points précis de divergence entre la loi (qui garantit des protections minimales aux individus dans ce domaine) et l'éthique, dans une société qui tente de résoudre les problèmes liés à l'apparition de nouveaux médias. Fidèle au découpage juridique traditionnel, je parlerai d'abord du problème de la vie privée et de l'individu, ensuite, de celui de la vie publique et de la célébrité. Individu et vie privée Intimité et vie publique représentent des relations complémentaires entre les individus et la société. Le droit à l'intimité est en quelque sorte « passif ». Il est garanti aux individus par des doctrines juridiques et politiques propres à l'organisation de notre société. Chacun peut dire : « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dispose d'un certain espace de vie privée que vous ne pouvez pas rendre public ». Aucun titre de propriété n'est nécessaire pour cela. Le droit de se défendre est socialement et légalement garanti. 82 La propriété des images : l'exemple américain La vie publique, par contre, suscite une revendication de la part des individus. Contrairement à l'intimité, qui est passive, la publicité est affirmative. L'individu déclare par exemple : « Ceci m'appartient. C'est ma propriété et la société a pour devoir de la protéger ». Cette attitude, qui évidemment est bien plus active, sous-entend également que l'image protégée possède une valeur économique ; ce qui n'est le cas habituellement que pour des célébrités. Avant le droit à la vie privée, qui ne fut explicitement formulé qu'en 1890, les lois sur la protection de l'individu ont vu leur champ d'application limité au bien-être physique (coups et blessures) et à la réputation (diffamation et calomnie). Des droits individuels de propriété avaient aussi été reconnus dans certains domaines, par exemple ceux de la création artistique, du portrait photographique, du récit de vie. Avec le concept d'« intimité » s'impose conjointement l'idée d'une « inviolabilité de la personne », signifiant que l'individu a le droit d'être un individu, et en tant que tel, est le propriétaire d'un domaine privé, propre à chacun, unique et secret. Il est intéressant de noter que ce « besoin » d'élargir le domaine individuel a constitué une réaction à la vie dans la société médiatique naissante, de la fin du XIXe siècle1. Le droit à la vie privée est essentiellement un droit à être « laissé en paix », à l'abri de toute publicité intempestive. Les privilèges de la presse sont autant de limites à la vie privée des individus. En général, les journalistes ont le droit de photographier et d'aborder tout sujet reconnu d'intérêt public ou général, en particulier lorsqu'une personne publique est impliquée. Il apparaît clairement que la possibilité de publier des photographies dans des journaux à sensation est une des prérogatives de la presse. D'autres usages des images d'individus, à titre éducatif ou informatif, comme dans les documentaires et les informations courantes, sont également autorisés sans restriction. Dans le domaine de la fiction, tel que celui du film, l'utilisation d'images d'individus est moins évidente puisque le producteur risque de perdre ses privilèges s'il est prouvé qu'il exploite illégalement l'image d'un individu pour son propre intérêt commercial. Les personnes privées présentes sur des lieux privés sont relativement bien protégées. Mais dès qu'elles s'aventurent dans un lieu public (une rue, un magasin par exemple) on considère qu'elles perdent leur droit à la vie privée. Le privilège dont disposent les mass-médias (ainsi que les individus) de pouvoir photographier des personnes privées sur des lieux publics et d'utiliser ces photographies pour des reportages d'information est protégé, même si la personne n'est pas consciente d'être photographiée. Ce qui va jusqu'à rendre licite l'utilisation non consentie de photographies de « l'homme de la rue » dans des articles à sensation, mettant ainsi l'intéressé dans une situation incompatible avec ses propres valeurs et opinions. En revanche, le droit de couvrir des « personnalités publiques », des responsables politiques, des célébrités, des notables placés sous les feux des projecteurs, demeure presque illimité. Une personnalité publique ne dispose que de peu de droits à la vie privée2. Cela semble juste, pour les figures historiques, les politiciens, les stars, les athlètes ; mais en est-il de même avec toutes ces personnes qui se trouvent involontairement placées sous les projecteurs, par exemple les victimes d'actions criminelles ? C'est dans ce domaine que les soucis d'éthique prennent le 83 John David Viera pas sur le débat juridique. Le média a généralement toute liberté de rapporter de tels événements, et même d'y revenir des années après. En plus de la presse, des artistes, des auteurs de documentaires, de longs métrages ou de vidéos, revendiquent des droits à l'image d'individus. Des médias tout puissants, omniscients, contrôlés par une minorité, représentent toujours une menace pour l'individu comme pour la société ; par conséquent, on a fixé des limites au privilège de la presse. Elles se révèlent particulièrement importantes au vu des récents progrès réalisés dans le domaine des médias électroniques : techniques d'édition vocale ou systèmes de traitement et de manipulation de l'image photographique assistés par ordinateur. Prenons par exemple le film Zelig, mélange habile du présent et du passé, où ne se trahit jamais la manipulation. Le conflit entre droit d'un individu à une vie privée et utilisation par d'autres d'une continuité d'images le représentant au sein de documentaires, de journaux ou de films, n'existe que parce que notre vie contient à la fois des aspects privés et publics. Les tribunaux ont été forcés de tracer la frontière entre ce qui relève du privé (qui est protégé) et ce qui est public. Ils ont dû équilibrer les intrusions dans la vie privée des individus, les droits des producteurs de médias à une création reposant sur des faits réels, et le besoin d'information exprimé par un public de masse. Les juges ne peuvent d'ailleurs définir ces limites qu'en se référant à des modèles moraux internes et à des préceptes éthiques externes, souvent ensevelis sous le poids des traditions juridiques historiques. En essayant de proclamer l'existence de droits dans ce domaine, la justice s'est essentiellement contentée d'adopter une position éthique, interdisant certes l'exploitation commerciale, mais autorisant par ailleurs l'utilisation à grande échelle d'images dans les informations, les documentaires et les journaux. La propriété de l'image La relation contractuelle en usage entre le sujet et le photographe ou le réalisateur de film tourne souvent au désavantage du sujet dans un certain nombre de cas. Habituellement, une personne qui consent à être photographiée ou filmée cède au preneur d'image un droit perpétuel à toute utilisation de son image dans n'importe quel média existant ou pouvant exister. En règle générale, la personne signe une renonciation à tout droit en échange d'une somme symbolique, un dollar par exemple. L'autorisation sert de renonciation à tout droit de vie privée ; le photographe est le propriétaire du négatif et, donc, de l'image concrète. Les pratiques actuelles sont souvent injustes. Généralement, une personne ordinaire ne profitera pas ultérieurement des hausses de la valeur économique accordée à son image, à la différence des mannequins professionnels par exemple. Supposons qu'une personne accepte d'être photographiée ou filmée pour un documentaire sur les mineurs. Le photographe va pouvoir librement insérer la photographie dans un article de magazine, la vendre à une agence 84 La propriété des images : l'exemple américain d'images ou à un autre producteur qui pourra aussi l'utiliser pour un autre documentaire sur les mineurs, ou encore, vendre le tirage à un collectionneur. Il est possible que, avec le temps, la photographie génère plusieurs milliers de dollars de revenus, dont pas un seul n'ira au sujet représenté, à moins que celui-ci n'ait imposé des conditions spécifiques dans son contrat de renonciation. Plus vraisemblablement, il n'a signé que le contrat standard et vendu son image pour un prix dérisoire. Non seulement le sujet ne partage pas les bénéfices tirés de la photographie mais, en plus, il perd tout contrôle sur les milieux socio-politiques dans lesquels elle peut être placée. Certaines des plus célèbres photographies du siècle relèvent de ce type. Ce sont des portraits de « l'homme de la rue » qui figurent dans des documentaires. Citons, par exemple, la Farm Security Administration et son fonds documentaire sur la Grande dépression. Plusieurs de ces images ont largement été répandues dans notre société et servent toujours de symboles de la Dépression. Quelques photographes ont d'ailleurs fait carrière grâce à celles-ci : Dorothea Lange par exemple. Mais aucun des sujets représentés n'a été rétribué en contrepartie de la perte de sa vie privée voire de sa « condamnation » à une existence d'icône éternelle et symbolique. La célèbre photographie de D. Lange, « Migrant Mother », en est un bon exemple. On pourrait néanmoins soutenir que de telles utilisations de l'image —qui enrichissent notre patrimoine national— possèdent une valeur à ce point élevée qu'être photographié devient un devoir civique... D'autre part, la société désire probablement encourager l'art de la photographie et ses usages : les expositions photographiques ou la documentation concernant des événements historiques. Le système quasi automatique de renonciation sert à atteindre cet objectif. Notre monde serait en effet plus pauvre sans le travail de Henri Cartier-Bresson, dont l'œuvre est en partie constituée de photographies documentaires le plus souvent non-autorisées, prises à la dérobée. Sur ce point, on peut trouver de bons arguments tant pour défendre le sujet que le producteur. La seule solution, peut-être, dans une société qui se « médiatise » de plus en plus, serait l'institution d'une licence de concession obligatoire relative à l'image, qui garantirait tant aux sujets ayant donné leur accord qu'à ceux ne l'ayant pas fait, la participation aux bénéfices qui en résultent. Cependant, un photographe pourrait parfaitement soutenir que la valeur d'une photographie n'émane pas du sujet mais de l'artiste. A ce propos, rappelons que les photographes eux-mêmes (et plus souvent encore les peintres) ne participent pas non plus au partage des bénéfices générés par une hausse ultérieure de la valeur de leur travail. La plus grande part des bénéfices liés à la revente de peintures ou de photos revient aux investisseurs/propriétaires et aux galeries. Bien sûr, cette situation n'est pas sans présenter de sérieuses difficultés du point de vue de l'éthique. Les pratiques commerciales courantes sont tout à fait légales, mais profondément injustes. Les tentatives de redressement de cette situation, qui s'appuient sur la législation des Fine Art Residuals (droits de suite3), ne commencent qu'à peine à aligner les Etats-Unis sur les pays européens (...). 85 John David Viera Les limites actuelles du domaine privé Aux Etats-Unis, le droit à une sphère privée est un droit garanti par chaque Etat, son étendue varie donc d'un Etat à l'autre. Cependant, la plupart d'entre-eux sont proches du critère du Restatement of Law (Sec. 652 d), qui affirme qu' « une personne est coupable de la violation de la vie privée si le contenu rendu public est : 1) Particulièrement offensant à l'égard d'une personne raisonnable ; 2) Ne présente aucun intérêt légitime pour le public ». Lorsqu'il est question de falsification et que la personne responsable de la publication est une entreprise médiatique, comme dans la grande majorité des cas, le plaignant doit également établir que l'entreprise a bien effectué la publication de manière délibérée ou a pris la plus grande liberté avec la vérité. Il s'agit là du même critère que celui appliqué aux plaintes en diffamation contre un média. Tout ceci rend très difficile d'obtenir gain de cause sur un média accusé de violation de vie privée, d'où le problème des stars continuellement jetées en pâture au public des magazines du type National Enquirer4. Le juriste Prosser a identifié quatre catégories de violation de la vie privée : 1) Les intrusions, telles que « mises sur écoute » ou « entrées sans autorisation » ; 2) La divulgation publique de faits privés, où il s'agit à chaque fois de savoir si les faits étaient effectivement «privés » ou si le plaignant avait perdu le droit de parler d'un domaine privé ; 3) La présentation erronée concernant les cas où la publication tend à mettre le plaignant dans une situation qui le fait apparaître comme soutenant une opinion qui n'est en fait pas la sienne (...) ; 4) l'appropriation de nom ou d'image. Ces divers critères légaux tiennent fort peu compte des droits à une vie privée, hors les cas d'appropriations de nom ou d'image. Tout au long du siècle, la protection de l'intimité n'a été octroyée qu'à contrecœur par les juges, et seulement dans des situations flagrantes ou scandaleuses. L'affaire des Farmer's Market Lovers (Les amants du marché) illustre bien l'attitude de la justice en la matière. Ce procès, plaidé en 1953 à la Cour suprême de Californie, avait pour plaignants un homme et son épouse dont une photo avait été prise à leur insu, alors qu'ils interrompaient leur travail au Farmers' Market de Los Angeles, pour un moment de détente. La photo de H. CartierBresson montrait le couple assis dans une pose affectueuse sur leur lieu de travail, un kiosque de vente de glaces. La photographie fut reproduite pour la première fois sur une pleine page du magazine Harper's Bazaar, en 1947, dans un article intitulé «And So The World Goes "Round" ». Les plaignants étaient présentés comme la quintessence du « couple amoureux ». Les éditeurs de Harper's bazaar revendirent ensuite la photo au Ladies' Home Journal qui, en 1949, s'en servit pour illustrer un article sur Γ«Amour» qui prétendait que, parmi les innombrables sortes d'amour, l'amour « coup de foudre », pure attirance sexuelle, était voué au divorce. La même photo servit alors à symboliser le syndrome de l'amour coup de foudre. Elle était accompagnée de la légende : « Vanté comme enchanteur et désirable, l'« amour coup de foudre » est une aventure à risques ». 86 La propriété des images : l'exemple américain Les plaignants firent objection à cette utilisation par le Ladies' Home journal et prétendirent qu'ils étaient représentés dans une attitude défavorable, que leur droit à la vie privée avait été violé, et qu'ils avaient subi une humiliation et un désagrément qui justifiaient un dédommagement de 25.000 dollars. Le procès se joua sur le terrain juridique, et la Cour suprême de Californie profita de la situation pour exposer son point de vue sur le problème du droit à la vie privée : « La reconnaissance du droit de poursuite des plaignants implique l'observation subséquente qu'une simple publication de la photographie non accompagnée de commentaires ne constitue pas une violation, justiciable de poursuite, du droit des plaignants à une vie privée... Le droit à une vie privée ne peut être étendu à la prohibition de toute publication dont le sujet peut être d'intérêt public ou général. » La Cour suprême fit remarquer que la photo n'avait pas été prise subrepticement sur une propriété privée, mais que le photographe avait saisi une pose volontairement assumée sur une place publique (un marché) : « Par leur propre action volontaire les parties civiles ont renoncé à leur droit à l'intimité dans la mesure où leur pose publique était assumée car "il ne peut y avoir de privé dans ce qui est déjà public" ». La Cour déclara que la photographie avait pour simple effet d'étendre et d'accroître le nombre des membres du public susceptibles d'observer les plaignants dans leur attitude amoureuse. Leur tendresse était entrée dans le domaine public. Ceci constaté, ils ne pouvaient plus ultérieurement « revenir sur leur renoncement et tenter de revendiquer un quelconque droit à la vie privée ». De même, la Cour indiqua qu'il n'y avait rien de particulièrement offensant dans la photographie. Les plaignants étaient présentés sous un jour plutôt favorable : un couple d'amoureux. En fait, une situation trop banale pour nécessiter une protection. La Cour ne fit pas mention du fait que les plaignants pouvaient « posséder » leur image. Soutenir, affirma-t-eÜe, que les plaignants disposent du droit d'empêcher la publication d'une pose volontaire prise sur un lieu public, sans aucune volonté de scandale, signifierait qu'ils aient le droit juridique absolu d'empêcher la publication de leur photographie. Du point de vue de l'éthique, ce ne serait pas une si mauvaise idée puisque l'éditeur aurait aussi bien pu utiliser des acteurs et les faire poser pour l'image, notamment dans le cas où, comme ici, l'image serait exploitée pour son contenu distractif et non pour son contenu informatif. Un magistrat s'opposa aux autres membres de la Cour en soulignant que le fait qu'ils aient révélé leur intimité à un petit groupe de personnes sur le marché, à des gens qui peut-être les connaissaient ou travaillaient avec eux, ne signifiait pas qu'ils s'attendaient à ce que leur photo soit transmise à des millions de lecteurs dans les magazines : « En effet, l'opinion de la majorité de la Cour signifie que tout ce que chaque individu fait en dehors de chez lui est automatiquement publiable avec son assentiment, car, dans ces circonstances, cet individu abandonne son droit à la vie privée même si l'événement ne contient aucune valeur informative ». A quelques rares exceptions près, ce principe fait toujours office de loi aujourd'hui. Cette doctrine de la «place publique» jumelée avec le privilège de la presse a de fait éliminé toute possibilité de réponse effective aux intrusions des médias dans la vie privée des individus. 87 John David Viera La personnalité comme propriété L'essor des mass-médias et l'efficacité de la publicité ont rendu possible l'exploitation de personnalités publiques, moyennant le paiement de droits. Des individus, en particulier les stars du spectacle et du sport, ont commercialisé leurs images, détaché leur personnalité (protégée par l'intimité) de leur personne publique pour exploiter délibérément cette dernière sous les formes les plus diverses (de la vente d'objets et d'autographes, aux posters et fan-clubs). Ces images véhiculées par les médias représentent une nouvelle forme intangible de propriété intellectuelle. Elles existent dans l'esprit d'autres personnes et leur valeur ne tient qu'au désir du public d'en acheter des copies (posters, magazines, vidéos musicales) ou de payer pour voir des images de célébrités dans des films ou à la télévision. Les images des médias constituent un fonds culturel commun à l'ensemble d'une société. Nous avons tous, par exemple, une représentation mentale de certaines célébrités ou stars telles que Elvis Presley. Les revendications de propriété sur des aspects non concrets de la personnalité (l'image d'une star, d'un personnage unique), sont la source d'une grande confusion juridique. La protection d'objets intangibles est en contradiction avec le penchant de notre société pour l'empirique, le concret. D'un autre côté, nous sentons bien qu'il serait juste que chacun soit propriétaire de son image, au moins dans un contexte commercial. A présent, les tribunaux, en se conformant à des principes moraux, se sont efforcés de défendre ces images au moyen de concepts juridiques voisins (intimité, copyright, concurrence déloyale), tout en développant, avec lenteur, une nouvelle doctrine spécialement adaptée à la protection d'une valeur intangible liée à l'individu : son « droit de publicité ». Mais, certains tribunaux ont résisté à cette nouvelle extension et se sont opposés à la reconnaissance des droits de l'individu à la propriété de son image personnelle. Etant donné que la valeur de l'image d'un individu est liée au degré de célébrité de cet individu, seules les célébrités possèdent des images auxquelles les médias reconnaissent de la valeur. Certaines célébrités ont tenté d'accroître leur contrôle sur leurs images dans tout une série de contextes : revendications portant sur la spécificité de la personnalité, sur le nom ou la représentation de personnages (Dracula) ; tentatives de contrôler l'exploitation commerciale de l'image d'une star existante (Elvis). Les stars revendiquent même la propriété de leur histoire personnelle, telle qu'elle peut être divulguée dans des émissions-documentaires, en menaçant d'intenter des procès aux médias. ν A qui appartient « Dracula » ? Depuis l'époque des feuilletons à la radio et au cinéma jusqu'à celle, actuelle, des séries de télévision et des films, l'industrie a reconnu l'enjeu que constituent les droits d'utilisation d'un « personnage » particulier dans une production. Les personnages représentent une forme mon88 La propriété des images : l'exemple américain nayable d'images médiatiques. La loi s'appliquant aux « personnages » est souvent la même que celle qui régit les images médiatiques, susceptible d'être appliquée aux « images de médias ». Il est indéniable que les personnages ont une valeur. La loi, cependant, ne fournit que peu de protection en ce qui les concerne. Le copyright ne couvre pas les personnages indépendamment de l'œuvre dans laquelle ils se trouvent, sauf s'ils font l'objet de représentations concrètes tels les personnages de dessins animés comme, par exemple, Mickey Mouse. Que se passe t-il si un individu prête à un personnage-type ses propres traits, dans ce qu'ils ont d'unique, de spécifique et de concret, et que cette représentation du personnage finit par se confondre avec le personnage-type ? Et qu'advient-il si cette représentation spécifique du personnage, qui fait partie intégrante d'un film mais qui possède une forte valeur en dehors même de ce film, devient commercialisable en-soi ? L'acteur peut-il faire valoir des droits sur sa représentation du personnage face à ceux dont bénéficie le propriétaire du copyright sur le film ? C'est à ces questions complexes que furent confrontés les tribunaux lors des différentes séries de procès Bela Lugosi/« Comte Dracula ». Un examen de la saga de « Dracula » permet de mettre à jour certaines des prémisses tacites de la loi. Un « Comte Dracula » historique aurait existé vers le XVIe siècle. On connaît aussi, bien sûr, l'archétype du « vampire » présent depuis le début de l'ère chrétienne au moins. A qui appartient ce personnage ? Notre loi prétend qu'il n'appartient à personne. Bram Stoker écrivit en 1897 le roman Dracula. La propriété littéraire sur le roman lui est reconnue et, à l'abri de cette protection juridique, celle sur les représentations des personnages du livre. Stoker possède non pas le personnage-archétype de Dracula mais cette représentation particulière de « Dracula » qu'il a donnée. Puisqu'il s'agit d'un roman, Stoker n'est le propriétaire que de ses descriptions écrites de « Dracula », et rien de plus — et ce, pour une durée limitée seulement. Chacun est libre d'écrire son « Dracula », de parler de comtes qui seraient des vampires et porteraient des capes, puisque l'essence ou l'idée de vampire appartient à tout le monde. Le roman de Stoker est une expression concrète, un « écrit » protégé par les lois sur la propriété littéraire, qui contient une intrigue, une logique, et tout une foule d'autres éléments ajoutés à « Dracula ». On lui garantit donc le droit le plus général de s'opposer à ce que d'autres copient son roman, c'est-à-dire, à ce que d'autres œuvres soient dérivées de son intrigue, de ses personnages et de sa structure. A moins qu'une œuvre n'appartienne au domaine public, les producteurs et les distributeurs doivent acheter le droit de fabriquer et de projeter un film (ce sont les droits sur le film) ainsi que les éventuelles productions ultérieures (les suites). Le film est un produit reproductible, il est lui-même susceptible d'être protégé par un copyright, même si ce celui-ci ne porte que sur les parties nouvelles, uniques, originales et différentes de celles du roman inspirateur. La Compagnie Universal réalisa son film en 1931, et le protégea. Elle possédait ainsi toutes les nouvelles «représentations» qu'elle avait ajoutées à celles figurant dans le roman. Le personnage de « Dracula » appartenait toujours au domaine public, mais il devenait impossible 89 John David Viera de reproduire les représentations développées dans le roman ou dans le film. Chacun était autorisé à réaliser un nouveau film sur « Dracula », le vampire, à le pourvoir de dents étranges, d'une cape noire et d'un accent de l'Europe de l'Est (toutes choses caractérisant le vampire), mais à condition de ne pas le faire exactement ressembler à Bela Lugosi et de ne pas le faire parler comme le fait Lugosi dans le film de Universal. Pour ce film, Universal dut passer un contrat avec Lugosi portant sur certains de ses droits et certaines de ses revendications concernant son image (les actes, les poses, le jeu et les traits). En retour, Universal rétribua Lugosi pour son travail d'acteur. Le contrat était ainsi rédigé : « Le producteur disposera du droit de photographier et/ou de produire, reproduire, transmettre, exposer, distribuer et exploiter de quelque manière que ce soit en relation avec le dit film, chacune des actions, des attitudes, des représentations et des apparences de toutes sortes de l'acteur définies ci-après... Le producteur aura de même le droit d'utiliser et de donner publicité au nom et à l'apparence, photographique ou autre de l'acteur... en relation avec l'exploitation et la publicité du dit film ». Ce qui se produisit en réalité appartient à l'histoire. L'acteur Lugosi fut si remarquable que son interprétation du « Comte Dracula » (sa représentation du personnage) devint synonyme du personnage-archétype de «Dracula». La représentation que Lugosi donna du personnage devint une image médiatique qui déborda complètement le film protégé par un copyright. Une fois que l'image et la façon de parler de Lugosi eurent atteint ce statut culturel, Universal essaya d'en exploiter la valeur. En 1960, Universal commença à commercialiser sous forme de licences sa galerie de personnages des films d'horreur qui étaient sous son contrôle : « Le Loup-garou », « La Momie », « Le Bossu », en plus du « Comte Dracula ». Les fabricants autorisés accolèrent les images de ces personnages à toute une variété de produits : chemises, jeux, panoplies, costumes et masques pour Halloween. Dans le cas de « Dracula », Universal autorisa l'utilisation de l'image de Lugosi tel qu'il apparaissait dans le film. Ceci semblait tout à fait naturel. Universal possédait le copyright sur les films et donc, a priori, le droit d'exploiter les personnages de ces films. Aucun acteur ne se plaignit d'être exploité, pas même Lugosi, probablement parce qu'il en avait toujours été ainsi. Par tradition, un acteur perd tout droit sur sa représentation et sur l'image du personnage qu'il a campé dans un film. Ceci pourrait être justifié pour certains types de représentations de personnages. Commercialiser sous forme de produits le « Loup-Garou », consiste par exemple à commercialiser le costume et le masque de la créature tels qu'ils ont pu être mis au point par le personnel du studio, et non l'apparence ou le jeu de l'acteur. Mais le « Comte Dracula » posait un problème différent. Avec ce personnage, on commercialisait l'image et le portrait de Lugosi tout autant que la cape et le costume. Ceci constituait, selon la veuve de Lugosi et son fils (les plaignants dans cette affaire), à la fois une violation du contrat original et un empiétement sur leurs droits (en qualité d'héritiers) à la « propriété » de Lugosi. La veuve et son fils intentèrent un procès, en 1972, dans le but de récupérer les profits réalisés par Universal grâce à la commercialisation de son « Dracula » et de prescrire toute utilisation future non autorisée de l'image de Lugosi. 90 La propriété des images : l'exemple américain Mais qu'avait précisément concédé Lugosi à Universal dans le contrat original ? Les contrats de 1930 et 1936 sont muets au sujet des droits sur le nom et l'apparence de Lugosi en tant que « Comte Dracula ». Faut-il en conclure que Lugosi n'avait pas concédé ces droits à Universal, ou qu'il n'avait pas réussi à se les réserver et donc qu'ils appartenaient à Universal ? Le tribunal trancha ainsi : « (...) Universal Pictures a reçu le droit de reproduire et d'exploiter en relation avec le film « Oracula » chacune des « actions, des poses, des représentations et des apparences de toutes sortes » de l'acteur, et d'utiliser le « nom et l'apparence, photographique ou autre de l'acteur» en relation avec l'exploitation et la publicité du dit film... (Le) contrat de Bela Lugosi, par formule expresse, limite le droit du producteur à l'utilisation des actions, des poses, des représentations et des apparences de toutes sortes de l'acteur en region avec le film « Dracula » ou en retoion avec l'exploitation et la publicité de ce film. » Ainsi, le tribunal jugea que Lugosi avait gardé tous les droits de commercialisation des « actions, des poses, des représentations et des apparences » qui étaient siennes en tant que « Comte Dracula ». Universal ne possédait que ce qu'elle avait acheté : les droits sur l'image de Lugosi dans le film et dans les publicités. Par conséquent, Lugosi pour sa part détenait les droits sur les autres usages de sa représentation particulière du personnage. Mais de tels droits pouvaient-ils survivre à sa mort ? Selon notre conception de la vie privée, les sentiments et la paix d'esprit d'un individu, Γ« inviolabilité de la personne », nécessitent d'être défendus. Ce droit à la vie privée est indépendant de la propriété, des affaires, ou des intérêts économiques. Ce droit à la vie privée meurt donc avec l'individu. Les droits sur la propriété, par contre, transcendent sa mort. Après avoir débattu des procès précédents, le tribunal soutint que le droit de Lugosi d'exercer un contrôle sur la valeur publicitaire de son nom, son apparence, sa représentation et sa personnalité, devait être reconnu et considéré comme distinct de son droit à une vie privée. Le tribunal mit un terme au débat sur le personnage de « Dracula » en concluant que le copyright d'Universal ne lui laissait quasiment rien d'exploitable commercialement une fois que lui était dessaisi le droit sur l'apparence spécifique de Lugosi. En fait, ce qui possédait de la valeur, c'était l'expression spécifique de Lugosi dans le film. Preuve en était que certains fabricants consentaient à acquitter des droits d'exploitation pour l'utilisation d'un personnage déjà tombé dans le domaine public : « (...) (L')essence même du personnage du Comte Dracula dans le film, Dracula, produit par le défendeur, réside dans les caractéristiques, dans le maquiUage, l'apparence et dans les manières de Bela Lugosi dans ce rôle. Seule la tenue n'est pas créée par l'acteur. En protégeant l'utilisation des caractéristiques, du maquillage, de l'apparence et des manières du personnage de Dracula·, inévitablement ce sont l'apparence et le paraître de Bela Lugosi dans ce rôle que vous protégez. Le personnage effrayant qu'est le Comte Dracula, tel qu'il se trouve dans les films Dracula et La Fille de Dracula, ne peut être dissocié de l'apparence de Bela Lugosi dans ce rôle ». Il n'est guère besoin de dire que Universal fit appel de cette décision. Bien qu'admettant tacitement l'idée que le « droit de publicité » pouvait être un droit sur la propriété, la Cour 91 John David Viera d'appel soutint que Lugosi n'avait en fait détenu que le droit personnel de convertir sa précieuse image en un droit sur la propriété. N'ayant pas exploité, de son vivant, son image par la commercialisation de produits, Lugosi n'avait pas converti son droit personnel en droit sur la propriété. Le droit de conversion avait expiré avec lui en 1956 et ne pouvait être transmis à ses héritiers. Universal était donc le propriétaire de l'expression spécifique du personnage fournie par Lugosi, de l'image médiatique de « Dracula », et ce par défaut. Universal était non seulement libre d'utiliser l'image de Lugosi mais elle avait les moyens d'empêcher que d'autres s'en servent grâce au copyright sur le film. Pour la Cour d'appel, Lugosi aurait dû commercialiser davantage sa propriété, pour pouvoir faire reconnaître son droit de contrôle sur la valeur de son « image-médias ». Position qui perd de sa subtilité dès que l'on en dévoile l'arbitaire. En fait, Lugosi exploita son image de diverses façons (par l'intermédiaire de films et d'un buste en cire). Y-a-t-il un seuil à partir duquel il est possible d'affirmer que son droit sur la propriété s'est cristallisé ? Selon la Cour, le détenteur du copyright possède en réalité des droits sur les expressions du personnage, même s'ils ne sont pas précisément stipulés dans un contrat. Aucune mention n'est alors faite d'une possible revendication par le public de l'image médiatique qu'il a contribué à créer. Finalement, Universal obtient les droits exclusifs sur l'image médiatique de Lugosi aux dépens de ses héritiers et de la société dans son ensemble. La nécessité d'élaborer une loi fédérale sur la personnalité Dans des contextes strictement commerciaux, il n'y a aucune raison de traiter les images d'individus utilisés comme produits autrement que comme des images de produits. « A qui devrait revenir la possession de ces images ? Au créateur.. ». La loi établit une distinction entre l'individu « privé » et trois catégories d'individus « publics » : celle des gens célèbres, celle des personnes involontairement connues (par exemple, les victimes de crime) et celle des stars, ce dernier groupe relevant d'une industrie. Qui devrait posséder les images médiatiques des stars ? Le public qui les « crée », les producteurs qui les exploitent, ou les acteurs qui les incarnent ? Le public a-t-il le droit de savoir quelque chose à propos des stars ? Bien sûr, mais à condition que l'image de la star fasse partie d'un livre, d'un film, des informations (et non d'une publicité figurant sur un emballage de chewing-gum, par exemple). Ceci crée des problèmes complexes d'évaluation. L'homme d'affaires ou le producteur doivent-ils être autorisés à exploiter nos désirs et nos besoins psychologiques de projection à l'aide de ces ersatz que sont les images médiatiques ? Le spectateur ou le consommateur a-t-il le devoir moral de ne pas projeter son existence intérieure sur des images médiatiques externes ? A toutes ces questions il n'est possible de répondre qu'en se référant aux valeurs fondamentales de notre société et à notre préférence pour une expression affranchie et sans entrave. 92 La propriété des images : l'exemple américain Une chose est sûre, on ne devient pas star involontairement. Le statut de star est tout autant le résultat d'un travail acharné que de la chance. Le prix qu'une star doit payer pour sa célébrité est une amputation de son droit à une vie privée. Parce qu'elle relève de l'intérêt du public, une vie de star devient un sujet d'intérêt public, elle est susceptible d'être racontée. Lorsqu'elle s'efforce d'empêcher la réalisation de documentaires portant sur son existence, Elisabeth Taylor tente de conserver et son statut de star et sa vie privée, de gagner sur les deux tableaux à la fois. Les interprétations judiciaires de la loi actuelle, se basant sur des précédents, ne permettent pas de mettre fin à la controverse sur les images médiatiques. Il y a dans les images une dimension personnelle et une dimension de propriété. Il est nécessaire de compléter le discours juridique à l'aide d'une construction théorique qui règle l'allocation de la valeur économique tout en assurant l'intégrité de la personne, en proposant une échelle capable de différencier les utilisations d'images personnelles (entraînant des problèmes de vie privée et de notoriété) de celles posant la question des concessions de propriété. Une telle loi définirait tout d'abord les images personnelles et les distinguerait des images médiatiques, les intérêts à défendre étant vraiment de nature différente : les premières, ressortissant à une liberté individuelle assurée par le Premier amendement ; les secondes, essentiellement, à des intérêts commerciaux passibles de lois sur la propriété. Une loi sur la personne allouerait initialement les deux catégories de droits évoquées à l'individu représenté par l'image, et définirait en même temps les droits des médias à un accès à ces images qui n'entrerait pas en contradiction avec les intentions du Premier amendement. Cela signifierait qu'en l'absence d'un consentement, d'une renonciation valide, ou d'un privilège dans le cas d'une image personnelle, ou d'un contrat dans le cas d'une concession de publicité, une copie de l'image d'une personne (nous y incluons son nom, le récit de sa vie, et ses caractéristiques autres que visuelles) serait sujette au contrôle de cette personne, au nom de l'intégrité individuelle et de la personnalité juridique. Si la loi supposait que la propriété de l'image médiatique reste celle de la personne représentée, le discours juridique disposerait alors d'une base sérieuse pour pouvoir trancher les litiges concernant les allocations de propriété. Ce point de départ conceptuel fait aujourd'hui défaut. Les statuts à créer devraient traiter des problèmes de propriété car une image est souvent construite par un ensemble d'« auteurs ». Une solution consisterait à exiger qu'un requérant (par exemple un studio de cinéma) passe explicitement un contrat avec le porteur de l'image. Il s'agit d'une pratique courante, par exemple, entre les acteurs et leurs agents. Les droits sur l'image médiatique seraient sécables, divisibles et proportionnés comme le sont les droits sur les films aujourd'hui, lorsqu'un réalisateur ou une star se réservent tel pourcentage sur la totalité des gains. Un système d'enregistrement s'avère nécessaire si l'on veut établir qu'il y a concession de propriété. L'un des avantages d'une allocation régie par la loi serait que, dans le cas d'un personnage comme « Dracula », les droits du porteur de l'image fassent l'objet d'un examen plus juste puisque il serait a priori supposé que la personne représentée, et non le détenteur du 93 John David Viera copyright, puisse tirer profit de la valeur acquise par l'intangible image médiatique née de l'interprétation d'un personnage. Une fois que l'image médiatique serait déclarée propriété intellectuelle par la loi, se poserait alors le problème de la transmission aux héritiers. Le contrôle et la propriété des images médiatiques feraient partie de l'ensemble de la succession d'un individu. Lors du procès Lugosi, le juge Bird, de la Cour suprême de Californie, propose une analogie avec le copyright, en soutenant que le « droit de publicité » devrait être gérable et contrôlable durant la vie de l'auteur et les cinquante années au-delà. Cet argument semble raisonnable même si il lui a été opposé le fait qu'il conduit à restreindre l'entrée dans le domaine public ; les arguments en faveur du domaine public doivent généralement leur existence à la confusion entre la renommée d'une célébrité et Y exploitation de l'image d'une célébrité. La législation proposée aurait à différencier entre la disponibilité publique des « célébrités » et les usages à des fins d'exploitation ou de commercialisation de la célébrité. Il est difficile de distinguer ces deux éléments car une personne célèbre a tendance à affirmer que toute forme d'utilisation exploite la valeur commerciale de l'image médiatique. En élaborant trois catégories d'images « illustres » (celles d'actualité, celle de héros culturels, et, enfin, celles qui représentent des célébrités), la société peut accorder aux deux premières un statut juridique de domaine public, préservant ainsi les droits traditionnels des médias sur les images de personnes illustres. Elle réserverait, par contre, le statut de propriété à celles des images de célébrités qui sont fabriquées. Si, en tant que membres d'une société, nous nous soucions vraiment des droits qui échoient au public, il faut reconnaître qu'une loi sur la personne pourrait servir de base à un système contraignant d'obligations réglementant l'usage de l'image médiatique des célébrités5. Ainsi, personne ne serait privé de la possibilité d'utiliser de telles images, et leurs créateurs et fabricants, bien que démunis de ce droit de contrôle absolu dont bénéficient les « propriétaires » d'images, recevraient un juste dédommagement en contrepartie de leurs efforts. John David VIERA NOTES * Traduction de « Images as Property » (ch. 7), extrait du recueil Image Ethics, publié sous la direction de Larry Gross, John Stuart Katz et Jay Ruby. New York, Oxford University Press, 1988. 1. Cf. Le texte de Warren et Brandeis, « The Right to Privacy », Harvard Law Review, p. 193 (1980). 2. A ce propos, lire W. Presser, Law of Torts (4 e éd., 1971), pp. 822-830. 3. En français dans le texte. 4. Voir « Court Reduces Carol Burnett's Award for Libel », Los Angeles Times, July 19, 1983. Une grande partie de la saga de Burnett contre le National Enquirer a fait l'objet d'articles dans le Los Angeles Times, Aug. 31, 1981, p. 19. 5. Une licence obligatoire signifie que l'utilisateur a le droit d'exploiter l'image aussi longtemps que des royalties sont versées au propriétaire de l'image. 94