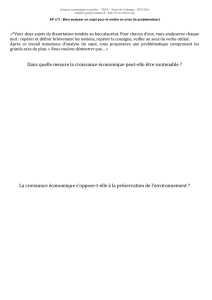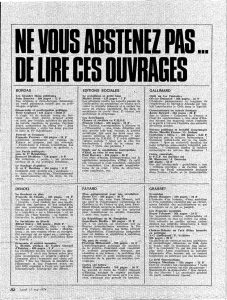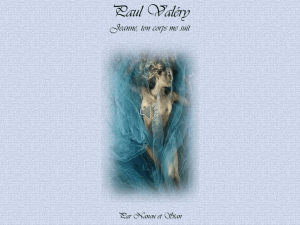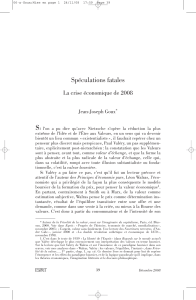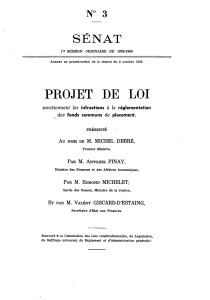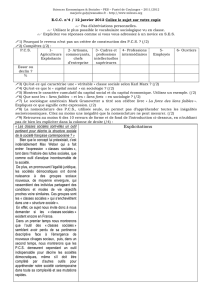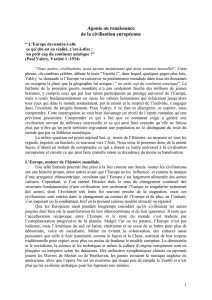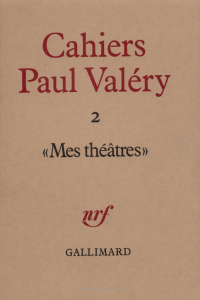1 Histoire et construction du vivre ensemble1 Patrick Garcia, maître

1
Histoire et construction du vivre ensemble1
Patrick Garcia, maître de conférences en histoire à l’université de Cergy-Pontoise –IUFM de
Versailles.
Chercheur associé à l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS)
« Organiser le passé en fonction du présent, c’est ce qu’on pourrait nommer la fonction sociale
de l’histoire » écrivait Lucien Febvre ajoutant aussitôt que « cet aspect […] des activités
historiennes [est] un peu inquiétant peut-être2. » Envisager l’histoire comme moyen de favoriser
le vivre ensemble relève pleinement de cette « inquiétante » fonction sociale qui subordonne la
connaissance historique à d’autres fins que la connaissance elle-même. Cela dit, d’évidence, la
question se pose et n’a cessé de se poser. Encore faut-il remarquer que si on a souvent voulu
utiliser l’histoire pour renforcer le sentiment de former un groupe, l’exact contraire – taire le
passé pour assurer la cohésion dans le présent – a aussi été préconisé avec une semblable
assurance. La réponse ne s’impose donc pas et suggère d’interroger non seulement ces deux
positions antagoniques mais aussi l’histoire ainsi mobilisée.
L’histoire ciment de la nation
La figure par excellence du recours à l’histoire pour construire une identité commune est bien sûr
celle de l’histoire nationale. Cette caractéristique commune aux historiographies nationales a été
particulièrement prégnante en France, pays hanté depuis la Révolution française par le spectre de
la guerre civile. C’est pour conjurer un nouveau déchirement que les gouvernements qui se
succèdent après 1815 insistent de façon croissante sur l’importance de la connaissance de
l’histoire et confèrent un rôle cardinal à son enseignement même si, de façon récurrente sous la
Restauration et aux premiers temps de l’Empire, la crainte se manifeste que le cours d’histoire
n’introduise à l’école les « querelles des partis »3. Cette réserve reste vive à l’égard de
l’enseignement de l’histoire contemporaine qui intègre les programmes en 18634. Mais pour
l’essentiel c’est le sentiment d’un besoin d’histoire qui prévaut. Ainsi pour François Guizot, le
futur ministre de l’Instruction publique de Louis-Philippe, « la société, pour croire à elle-même, a
besoin de ne pas être née d’hier5 » tandis que celui de Louis-Napoléon Bonaparte, Victor Duruy,
y trouve « une grande vertu d’apaisement. [Car l’histoire] montre par toutes ses leçons que si
l’absolu se trouve dans la vérité scientifique, la politique est, comme la loi, une affaire de
convenance entre les choses à faire et les choses déjà faites ; que même s’il faut compter, sans les
subir, avec les passions, les préjugés, la plus grande des forces c’est la fermeté dans la
1 Article publié dans la revue : Thèmes canadiens, automne 2008, p. 52-55.
2 Lucien Febvre, « Vers une autre histoire » (1949), Combats pour l’histoire, Agora/Pocket, 1992, p. 438.
3 Cf. notamment Patrick Garcia et Jean Leduc, L’enseignement de l’histoire en France de l’Ancien Régime à nos jours, Armand
Colin, collection « U », réédition 2004.
4 On retrouve une crainte identique en 1982 quand les programmes sont de nouveau poursuivis « jusqu’à nos jours »,
borne terminale abandonnée en 1945.
5 François Guizot, Du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère actuel, Paris Ladvocat, 1820.

2
modération6. » La défaite devant la Prusse en 1870 suivie de l’insurrection de la Commune de
Paris interprétées comme les symptômes d’une défaillance du sentiment national accentuent
l’urgence que se constitue une historiographie nationale qui ne soit pas, selon le diagnostic de
Fustel de Coulanges, une « guerre civile en permanence » qui « nous » livre d’avance à l’ennemi et
vienne au contraire cultiver le patriotisme qui à ses yeux n’est pas « l’amour du sol » mais
« l’amour du passé, […] le respect pour les générations qui nous ont précédés7. » C’est à cette
tâche que s’attellent les historiens méthodiques et pour l’enseignement, tout particulièrement,
Ernest Lavisse. Ce dernier définit alors ce qui va devenir la finalité majeure de cet enseignement
jusqu’à la fin des années 1960 : « expliquer que les hommes qui, depuis des siècles, vivent sur la
terre de France, ont fait, par l’action et par la pensée, une certaine œuvre, à laquelle chaque
génération a travaillé ; qu’un lien nous rattache à ceux qui ont vécu, à ceux qui vivront sur cette
terre ; que nos ancêtres, c’est nous dans le passé ; que nos descendants, ce sera nous dans l’avenir.
Il y a donc une œuvre française, continue et collective : chaque génération y a sa part, et, dans
cette génération, tout individu a la sienne8. » L’histoire ainsi produite entend pacifier le passé en
l’orientant et du même coup en lui donnant un sens : le développement de la nation dont chaque
étape, chaque épisode a été nécessaire. Roman de la continuité, elle a donc pour fonction de faire
prévaloir ce qui est commun, de produire un sentiment d’unité, d’inventer une histoire tendue
vers le rayonnement de la France à laquelle chacun peut s’intégrer puisque la France – c’est du
moins la conviction de ses élites – parle le langage de l’universel, s’identifie par ses idéaux à
l’universel.
La tentation de l’oubli
Il est pourtant une façon radicalement différente d’envisager la construction du commun :
l’éradication du passé. La forme politique en est connue, c’est l’amnistie dont on doit l’invention
aux Athéniens. Aristote rapporte dans La constitution d’Athènes comment ceux-ci, après la chute de
la dictature des Trente en 404, décidèrent pour sortir de la guerre civile que le premier citoyen qui
rappellerait les violences qui avaient traversé la cité et en témoignerait publiquement rancune
serait mis à mort sans jugement et il précise : « Il en fut ainsi : cet homme mort, personne ne
réveilla plus les vieilles haines ». Sans s’accompagner d’effets aussi radicaux, l’oubli volontaire
apparaît donc comme une autre façon de promouvoir le vivre ensemble. En même temps que
retentissent les exhortations à connaître, enseigner et aimer le passé Ernest Renan le rappelle :
« L’oubli, je dirais même l’erreur historique sont un facteur essentiel à la création d’une nation9 ».
En effet si l’histoire peut conduire à la mise en valeur, voire à la fabrication d’un légendaire
commun dont l’idéaltype pourrait être « nos ancêtres les Gaulois », elle est aussi remémoration de
6 Victor Duruy, « Instruction relative à l’enseignement de l’histoire contemporaine dans la classe de philosophie des
lycées impériaux », 24 septembre 1863, L’histoire et la géographie dans l’enseignement secondaire, Textes officiels, T1 1795-
1914, réunis et présentés par Philippe Marchand, INRP, 2000, p. 297.
7 Fustel de Coulanges, « De la manière d’écrire l’histoire en France en Allemagne depuis cinquante ans » (1872), in
François Hartog, Le XIXe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges, Points- Seuil, 2001, p. 408.
8 Ernest Lavisse, article « Histoire », in Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie, 1885.
9 Ernest Renan, « Qu’est-ce qu’une nation ? », 1882.

3
tragédies, d’injustices et de crimes au risque de raviver les plaies et d’entretenir les différends.
Cette mise en doute de la fonction pacificatrice de la connaissance historique et de son
enseignement a connu un regain après les deux conflits mondiaux dès lors que l’échelle
considérée n’était plus celle de la nation mais l’Europe dans son ensemble. On connaît la diatribe
de Paul Valéry écrite après les tueries de la Grande Guerre : « L’Histoire est le produit le plus
dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré. […] Il fait rêver, il enivre les peuples, leur
engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente
dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les
nations amères, superbes, insupportables et vaines10 ». Le même sentiment traverse la réflexion
du Conseil de l’Europe quand il faut envisager après 1945 ce que doit être un enseignement de
l’histoire qui rende justice à chacun des peuples européens et qui soit le gage d’un avenir commun
et d’une paix durable. En 1950 un rapport destiné au secrétariat général soutient – après s’être
interrogé « Comment donc enseigner l’histoire sans trop être illusionniste ni trop nocif ? » – que
l’enseignement d’« une histoire des civilisations, surtout artistique et technique paraît la moins
dangereuse. […] Un tel enseignement, qui se ferait surtout par l’image, demanderait aux enfants
un plus faible effort intellectuel et prendrait un temps bien moindre que l’histoire politique
actuelle. Et les heures ainsi gagnées seraient consacrées à l’enseignement d’une langue étrangère
européenne dès les petites classes, car le principal effort d’un enseignement européen doit être
avant tout linguistique11. » Cette position n’est pas très éloignée de celle du président Valéry
Giscard d’Estaing quand il décide en 1975, pour construire l’Europe et favoriser le
rapprochement franco-allemand, de cesser de commémorer le 8 mai 1945 tandis que la place
traditionnellement dévolue à l’enseignement de l’histoire est remise en cause12.
Reste que cette option ne rencontre guère la faveur de l’opinion publique. Connaître l’histoire
demeure créditer le plus souvent d’une valeur essentielle, elle apparaît même comme une garantie
d’avenir. Loin de suivre l’orientation un temps préconisée, le Conseil de l’Europe invite a minima
les États à expurger les manuels scolaires des stéréotypes xénophobes avant de poser à partir de
1994 les linéaments d’une politique européenne de la mémoire dont l’enseignement de l’histoire
serait le fer de lance13. De même bien malgré lui, c’est « l’ère de la commémoration » (Pierre
Nora) qu’ouvre Valéry Giscard d’Estaing en lançant l’année du patrimoine (1980) et en signant à
la veille de sa défaite électorale le décret de panthéonisation de René Cassin et ses positions en
matière de politique de la mémoire et d’enseignement de l’histoire contribuent grandement à son
isolement puisqu’elles se heurtent à un front commun qui regroupe la totalité des forces
politiques à l’exception de la sienne. Enfin ajoutons, qu’en France comme dans le reste du
monde, il est désormais peu d’amnisties qui ne soient rapidement rejetées et ressenties comme un
déni.
10 Paul Valéry, « De l’histoire », Regards sur le monde actuel, 1931.
11 Rapport du 8 août 1950, archives du Conseil de l’Europe.
12 Patrick Garcia, « Valéry Giscard d’Estaing, la modernité et l’histoire » in Claire Andrieu, Marie-Claire Lavabre,
Danielle Tartakowsky (dir.), Politiques du passé. Usages politique du passé dans la France contemporaine, Aix-en-Provence,
Presses universitaires de Provence, 2006, p. 119-132.
13 APCE Recommandation 1283 (1996) relative à l’histoire et à l’apprentissage de l’histoire en Europe.

4
Une histoire plurielle ?
Loin du modèle de l’amnésie, c’est plutôt celui d’une histoire plurielle, délibérément dissonante et
qui ne masquerait aucune aspérité qui se fraie son chemin en France dans l’enseignement et les
gestes publics comme dans la réflexion et les propositions du Conseil de l’Europe14. L’histoire est
alors pensée comme un vecteur essentiel de reconnaissance et celle-ci comme le garant de la
possibilité d’un vivre ensemble. De ce point de vue le geste de Jacques Chirac quand il reconnaît
le 16 juillet 1995, lors de son discours commémoratif de la rafle du Vel’ d’Hiv qui vit l’arrestation
de plus de treize mille de Juifs vivant à Paris et leur remise aux autorités allemandes par la police
française, la responsabilité de la France – et non plus du seul régime de Vichy – fait, pour la
France, césure. Elle participe plus largement au plan mondial d’un nouveau regard sur l’histoire
surdéterminé par la mémoire – auquel celle de la Shoah sert de matrice – où les justifications
traditionnelles des États en fonction de leurs intérêts et de leurs logiques propres se trouvent
comme démonétisées face à l’affirmation de principes supérieurs pensés comme universels qu’on
peut identifier sous la thématique des droits de l’homme15.
Cette conception nouvelle n’est pas sans difficulté ni ambiguïté. En premier lieu elle impose un
retour sur toutes les pages sombres de l’histoire nationale – celles précisément que le roman
national éludait, euphémisait quand il ne les justifiait pas – tant de façon publique par des
déclarations, des cérémonies voire des lois et que par leur inscription dans l’enseignement. Mais
c’est généralement l’émotion soulevée, la mobilisation de ceux qui se font les porteurs d’une
mémoire déniée qui fixe le tempo de son inscription dans l’espace public de telle sorte que la
quête à la reconnaissance peut conduire à une sorte de « concurrence des victimes » (Jean-Michel
Chaumont), une guerre des mémoires voire à des « abus de mémoire » (Tzvetan Todorov). En
outre la condamnation de la « repentance » par des hommes politiques (Philippe Seguin, Nicolas
Sarkozy) ou des intellectuels français (Pascal Brückner), la réaffirmation en contrepoint de la
fierté nationale (Max Gallo16), leur écho dans l’opinion, traduisent aussi les tensions sinon le
désarroi que provoque ce nouveau regard porté sur l’histoire. Le passé n’est décidément pas un
long fleuve tranquille.
En second lieu cette approche présuppose que l’acte de reconnaissance – le plus souvent
symbolique – vaudrait réparation et permettrait de retisser le lien collectif. Mais est-ce si sûr ?
Qu’est-ce qui peut venir clore le sentiment d’avoir été victime ? Il n’existe pas en la matière de
« solde de tout compte » et, si le déni pèse sur la collectivité comme un fardeau, la reconnaissance
ne le lève pas ipso facto : les vertus thérapeutiques de l’histoire ne doivent pas être exagérées. La
reconnaissance publique des crimes d’État, des tragédies qui ont marqué l’histoire, leur
14 La doctrine en est fournie par Robert Stradling, La multiperspectivité dans l’enseignement de l’histoire : manuel pour les
enseignants, Conseil de l’Europe, 2003.
15 Lire en dernier lieu Antoine Garapon, Peut-on réparer le passé ? Colonisation, esclavage, shoah, Odile Jacob, 2008.
16 Qui, après avoir été l’un des principaux acteurs de la contestation de la politique mémorielle de Valéry Giscard
d’Estaing puis secrétaire d’État et porte-parole du troisième gouvernement de Pierre Mauroy sous la présidence de
François Mitterrand, est l’un des rédacteurs des discours historiques de Nicolas Sarkozy et l’un de ses conseillers en
la matière.

5
enseignement sont certes une condition nécessaire mais elles ne sont pas suffisantes pour
dépasser le passé.
Peut-être faut-il alors mieux distinguer les registres ? L’affaiblissement du cadre national comme
la prise en compte effective du processus de construction du discours historique appellent à tous
les niveaux – recherche et enseignement – l’essor d’une position réflexive qui prenne en compte
l’histoire de l’histoire et l’histoire de la mémoire. Il s’agit là d’une tâche professionnelle qui relève
pleinement des historiens et des enseignants d’histoire.
La question du vivre ensemble ne me semble pas être de même nature. Ce qui permet le
dépassement des rancœurs, des amertumes, des chagrins ne relève ni d’une pratique de l’histoire
ni d’une épistémologie : c’est l’anticipation d’un avenir commun. Longtemps l’histoire s’est écrite
du point de vue de l’avenir. C’est ce qui assurait sa cohérence. Si la nostalgie ne peut être de mise
on peut néanmoins penser que la réaffirmation de projets collectifs forts à des échelles adaptées
au monde contemporain est une condition pour que les effets de la nécessaire reconnaissance se
fassent sentir et qu’au lieu du ressassement advienne cette « juste mémoire », souhaitée par Paul
Ricœur, propice au vivre ensemble. C’est de l’ouverture de nouveaux horizons d’attente que
dépend notre rapport collectif au passé et au présent.
1
/
5
100%