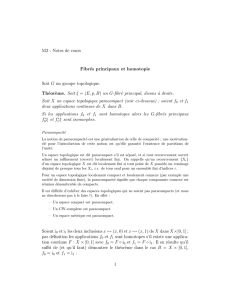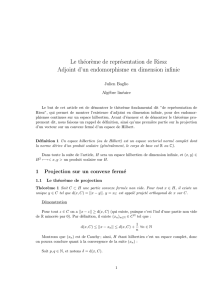Cours de logique mathématique

Cours de logique math´ematique
Martin Hils
15 janvier 2013

Table des mati`eres
1 Compter `a l’infini 3
1.1 Le Th´eor`eme de Cantor et le Th´eor`eme de Cantor-Bernstein . . . 4
1.2 Notions d’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Op´erations sur les ordres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Ordinaux ............................... 7
1.5 Arithm´etique ordinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.6 Axiome du choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.7 Cardinaux............................... 13
1.8 Op´erations sur les cardinaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.9 Cofinalit´e ............................... 16
2 Calcul des pr´edicats 19
2.1 Langages et structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Termes et formules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.3 S´emantique .............................. 23
2.4 Substitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.5 Formules universellement valides . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.6 D´emonstrations formelles et th´eor`eme de compl´etude de G¨
odel . 29
3 Premiers pas en th´eorie des mod`eles 36
3.1 Quelques th´eor`emes fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.2 La m´ethode des diagrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.3 Expansions par d´efinitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.4 ´
Elimination des quanteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.5 Corps alg´ebriquement clos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.6 Le th´eor`eme d’Ax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4 R´ecursivit´e 49
4.1 Fonctions primitives r´ecursives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.2 La fonction d’Ackermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.3 Fonctions partielles r´ecursives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.4 Fonctions calculables par machine de Turing . . . . . . . . . . . . 54
4.5 Fonctions universelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.6 Ensembles r´ecursivement ´enum´erables . . . . . . . . . . . . . . . 62
1

4.7 ´
Elimination de la r´ecurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5 Mod`eles de l’arithm´etique et th´eor`emes de limitation 67
5.1 Codage des formules et des preuves . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.2 Th´eories d´ecidables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.3 Arithm´etique de Peano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.4 Les th´eor`emes de Tarski et de Church . . . . . . . . . . . . . . . 75
5.5 Les th´eor`emes d’incompl´etude de G¨
odel .............. 76
6 Th´eorie axiomatique des ensembles 79
6.1 Les axiomes de Zermelo-Fraenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6.2 Axiome du choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.3 La hi´erarchie de von Neumann et l’axiome de fondation . . . . . 86
6.4 Quelques r´esultats d’incompl´etude, d’ind´ependance et de consis-
tancerelative ............................. 89
2

Chapitre 1
Compter `a l’infini
Dans ce premier chapitre, les notions d’ensemble et d’entier sont prises dans
leur sens na¨
ıf. La th´eorie des ordinaux et cardinaux, due `a Cantor (fin du 19e
si`ecle) sera d´evelopp´ee du point de vue na¨
ıf.
Voici les deux principes de la Th´eorie des ensembles na¨
ıve :
–Extensionalit´e : Deux ensembles contenant les mˆemes ´el´ements sont ´egaux.
–Compr´ehension (globale) : Pour toute propri´et´e (raisonnable) P, la collec-
tion {a|av´erifie P}est donn´ee par un ensemble.
C’est le second principe qui est probl´ematique.
Antinomie de Russell. Soit a={x|x6∈ x}. Alors a∈assi a6∈ a.
Grˆace `a cette antinomie montrant que la Th´eorie des ensembles na¨
ıve est
contradictoire, des fondements rigoureuses de la Th´eorie des ensembles (et par
cons´equent de la math´ematique en g´en´erale) ´etaient devenues n´ecessaires.
Dans le dernier chapitre de ce cours nous traitons le syst`eme d’axiomes
ZFC (axiomes de Zermelo-Fraenkel plus l’axiome du choix) ; la plupart de ces
axiomes consisteront en une forme restreinte du principe de compr´ehension.
Nous y verrons que les notions et r´esultats de ce premier chapitre restent valides
en Th´eorie axiomatique des ensembles, en n’utilisant que le syst`eme d’axiomes
ZFC.
Notation. Si A, B sont des ensembles, A∪B,A∩Bet A\Bd´esignent la r´eunion,
l’intersection et la diff´erence d’ensembles, respectivement. Si (Ai)i∈Iest une
famille d’ensembles, on note sa r´eunion par Si∈IAi={x|x∈Aipour un i∈
I}, et son intersection par Ti∈IAi.
Nous ´ecrivons A⊆Bsi Aest une partie de B, et A⊂Bsi Aest une partie
propre de B. L’ensemble des parties de Aest not´e P(A).
3

1.1 Le Th´eor`eme de Cantor et le Th´eor`eme de
Cantor-Bernstein
L’existence d’une fonction injective / surjective / bijective entre deux en-
sembles sera utilis´ee comme moyen pour comparer leur «taille ». Nous com-
men¸cons avec deux premiers r´esultats qui vont dans ce sens.
Th´eor`eme 1.1.1 (Cantor).Soit Aun ensemble. Il n’existe pas de surjection
de Asur P(A).
D´emonstration. Soit f:A→ P(A) une appliction. On consid`ere l’ensemble
B={x∈A|x6∈ f(x)}.
Pour tout x∈Aavec f(x) = B, on a x∈Bsi et seulement si x6∈ B. Donc B
n’est pas dans l’image de f.
Th´eor`eme 1.1.2 (Cantor-Bernstein).Soient Aet Bdeux ensembles, f:A→
Bet g:B→Adeux injections. Alors il existe une bijection h:B→A.
D´emonstration. On peut supposer que Aest une partie de Bet que l’application
fest donn´ee par l’inclusion. (Il suffit de remplacer gpar f◦get Apar f(A).)
Soit C={gn(x)|n∈N, x ∈B\A}. On pose h(c) = g(c) pour c∈Cet
h(x) = xpour x∈B\C.
D´efinition. Soient Xet Ydeux ensembles. On dit que Xet Ysont ´equipotents,
not´e X∼Y, s’il existe une bijection entre Xet Y; on dit que Xest subpotent
`a Y, not´e X4Y, s’il existe une injection de Xdans Y.
Dans cette terminologie, le th´eor`eme de Cantor-Bernstein dit que si X4Y
et Y4X, alors X∼Y.
Exercice 1.1.3. Montrer qu’il existe une bijection entre Ret P(N).
1.2 Notions d’ordre
D´efinition. Un ordre partiel <sur un ensemble Xest une relation binaire (c.-
`a-d. donn´ee par une partie de X×X) qui est transitive (si x<yet y < z alors
x<z) et antir´eflexive (x6< x). Si de plus <est une relation connexe (pour tout
x, y ∈Xon a x<y,x=you y < x) on dit que <est un ordre total.
On note x≤ypour x<you x=y, puis x>ypour y < x, et x≥ypour
y≤x.
Si Y⊆X,y∈Yest un plus petit ´el´ement si pour tout y0dans Y,y≤y0.
C’est un ´el´ement minimal si pour tout y0dans Y,y06< y. On d´efinit de mˆeme un
plus grand ´el´ement et un ´el´ement maximal. Un minorant de Yest un ´el´ement
de Xqui est ≤`a tous les ´el´ements de Y. Une borne inf´erieure de Yest un plus
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
1
/
98
100%